ADIEU, CAVALERIE !
La Marne, Bataille gagnée ... Victoire perdue
De la mobilisation jusqu'au 9 septembre 1914
![]()
De la mobilisation jusqu'au 9 septembre 1914
Ce livre écrit par le Général Chambe, est à l'origine de la création de notre association (qui s'appelait, à sa création : "Sur les pas du Lieutenant Chambe"), édité chez Plon en 1979, 65 ans après les événements, ce témoin oculaire donne un point de vue original sur la bataille. En 1983, notre association a reconstitué, lors d'une randonnée équestre de quinze jours, les déplacements du Lieutenant Chambe lors de la 1re Bataille de la Marne. (Randonnée présentée sur notre site Internet dans la rubrique : QUI SOMMES NOUS, CE QUE NOUS AVONS FAIT, CE QUE NOUS FAISONS ET CE QUE NOUS ALLONS FAIRE ) Ces déplacements du IIe Corps de Cavalerie sont décrits dans le livre " Adieu, Cavalerie !". A l'époque le Général Chambe, auteur du livre, et sa fille avaient soutenu et encouragé notre initiative, nous les remercions de leur soutien.
En 2004, nous souhaitons rendre, à nouveau, un hommage au Général Chambe, c'est pourquoi nous reproduisons fidèlement son ouvrage
"Ceci n'est pas le procès de la cavalerie mais celui de la façon dont cette arme ardente et magnifique a été engagée, ou plutôt n'a pas été engagée à la bataille de la Marne, faute d'avoir eu à sa tête un chef jeune et dynamique digne d'elle."
AVANT-PROPOS
Ce livre, j'ai longtemps hésité avant de l'écrire, hésité pendant plus de soixante années. C'est peut-être le dernier que j'écrirai. Mais je ne veux pas disparaître sans l'avoir écrit. Je l'ai promis.
Je l'ai promis à mes camarades, aux jeunes officiers de cavalerie que nous fûmes en 1914. Je l'ai promis à nos chevaux.
Le lecteur ne manquera pas de se poser deux questions. La première : Pourquoi avoir si longtemps hésité avant de rédiger cet ouvrage ? La seconde : Pourquoi avoir finalement décidé de rompre le silence ?
A ces deux questions je vais répondre clairement.
Réponse à la première : - La victoire de la Marne a eu un immense retentissement. Elle a couvert de gloire l'armée française, c'est-à-dire la France elle-même. Ce fut plus qu'une victoire militaire ce fut celle d'une nation tout entière, celle d'une race.
Au seuil de la défaite, l'armée française, que le monde entier jugeait anéantie, s'est redressée dans un incroyable sursaut, a repris l'offensive et battu en rase campagne l'armée allemande, réputée la première de l'univers.
La France moribonde, condamnée et déjà couchée par tous dans la tombe, s'était relevée au bord même de la fosse, les pieds dans le sang, les cadavres et les ruines. Elle avait crié dans un effrayant défi que ce n'était pas vrai, qu'elle était toujours vivante, toujours debout, qu'elle refusait de mourir et allait battre l'ennemi !
C'était l'âme française qui avait reparu, l'éternelle âme française, toujours la même, trop souvent légère et imprévoyante mais qui, aux soirs les plus sombres de son histoire, se révélait indomptable et farouche.
Au spectacle du choc gigantesque de la Marne, le monde avait été saisi d'angoisse, de ferveur, puis d'admiration. Que la Marne eût été une grande victoire française ne se discutait plus. C'était un fait acquis, classé, proclamé dans toutes les langues, dans tous les manuels d'histoire de toutes les nations de la terre.
Alors que signifiait d'en rouvrir aujourd'hui le dossier ? Pourquoi remettre l'Histoire en question ? Pourquoi risquer de ternir l'or de l'auréole de la victoire de la Marne ?
Il ne fallait pas toucher à la Victoire de la Marne ! Et au nom de qui ? Au nom de quoi ?
L'hésitation était permise. J'ai hésité.
Réponse à la deuxième question : - Et puis, je me suis rassuré. On pouvait tout dire aujourd'hui sur la Marne. Le monument était si solide, si définitivement cimenté qu'il n'y avait aucun risque de lui porter atteinte. Il était à toute épreuve.
L'adversaire lui-même n'avait-il pas pris soin d'apporter sa caution à la validité de l'édifice ? La Direction Suprême allemande, au lendemain de la défaite, en relevant de son commandement et en envoyant en non-activité le général von Kluck, chef de la Ière armée, celle d'aile droite sur laquelle on comptait pour remporter la victoire. Elle l'avait tenu pour responsable du désastre.
Von Kluck s'était défendu en phrases lapidaires, qu'on n'a pas oubliées. Elles resteront comme le plus bel hommage qu'on ait jamais rendu à l'armée française. Il s'était écrié :
- "Et puis qu'avez-vous à me reprocher, nous sommes tous responsables de la défaite ! Car, qu'après une retraite infernale de douze jours, avec les effroyables souffrances endurées, il y eût au monde un seul soldat encore capable de se relever et d'attaquer au son du clairon et que ce soldat fût le soldat français, cela on ne nous l'avait jamais appris dans aucune de nos académies de guerre."
La gloire de la victoire de la Marne a résisté non seulement à l'usure du temps mais aussi au choc des terribles événements qui se sont produits depuis. Ces événements auraient pu la faire disparaître sous un voile de deuil, l'effacer sans appel. Elle a cependant résisté à l'effondrement militaire français de 1940, à l'écroulement de tout un peuple pris d'épouvante. La défaite de 1940 n'a effacé ni la Marne, ni Verdun, ni le Onze Novembre. Leurs noms sont restés inscrits en lettres flamboyantes au fronton de la France. Le monument s'avère indestructible.
Ainsi, la preuve est faite aujourd'hui qu'il est possible de faire connaître sans inconvénient la vérité sur la manière dont furent conduites certaines des opérations de la bataille de la Marne, en particulier celle de la dernière phase, à Sissonne, les 13 et 14 septembre. L'Histoire a droit à la vérité.
La Marne a été une incontestable victoire, c'est entendu et c'est vrai, mais elle a été une victoire, elle n'a pas été la victoire, la victoire qu'elle aurait pu et dû être, c'est-à-dire décisive.
Bien avant la guerre de 1914, von Schlieffen avait élevé à la hauteur d'un axiome l'affirmation qu'une nouvelle guerre entre l'Allemagne et la France se limiterait au résultat de la première bataille. Etant donné l'immensité des forces en présence et les terribles effets de destruction de l'armement moderne, il ne pourrait en être autrement.
Sur ce point, stratèges, sociologues, économistes et philosophes français et allemands étaient tous d'accord. Ce n'était pas tellement une erreur de jugement.
Cela a bien failli se vérifier en septembre 1914. La bataille des frontières (de fin août) et la bataille de la Marne, que l'on a voulu décomposer en deux batailles, n'en formaient qu'une seule. C'était la même.
Les quatre années qui ont suivi n'ont été que la conséquence d'une bataille pas finie, d'une victoire inachevée, avortée. Tout aurait dû se terminer dans les plaines de Laon et de Saint-Quentin après l'affaire de Sissonne.
Napoléon a écrit dans ses préceptes : La guerre de cavalerie est affaire de lieutenants. Rien n'est plus vrai. Ses généraux de cavalerie Murat, Lassalle, Exelmans, Curély, Kellermann, avaient tous l'âge de lieutenants, celui de la folle témérité, du goût du risque et du coup d'œil. Qui ose gagne ! En avant et tant pis pour qui tombe ! étaient leurs slogans favoris, lancés à tue-tête dans la tempête de la charge. Tout hussard qui à trente ans est encore vivant n'est qu'un jean-foutre ! criait Lassalle, debout sur les étriers, sabre haut, lorsqu'il fut tué d'une balle au front, à Wagram, à la tête de sa brigade de légère. Il avait trente-deux ans. Il avait droit à cette mort.
Si le 14 septembre 1914, le corps de cavalerie Conneau avait été non aux ordres d'un général trop âgé mais d'un lieutenant, ou d'un sous-lieutenant, n'importe lequel, il eût sûrement été engagé et à fond ! C'eût été alors une impérissable victoire. Et non l'humiliation de recevoir un ordre de retraite, d'avoir à revenir sur son contre-pied alors qu'il était parvenu à se glisser à plus de trente kilomètres dans le dos d'un ennemi complètement pris à revers lequel ne s'en doutait même pas. La surprise eût été totale.
Ce sera là le sujet de cette étude et sa démonstration.
Il fut un temps où le cheval régnait en maître au sommet de l'armée.
La cavalerie était la reine des batailles. Par sa vitesse elle permettait les manœuvres les plus brillantes, les plus inattendues, parfois décisives. Elle inspirait une terreur permanente au fantassin, qui, ayant lâché son coup de fusil, se voyait culbuté avant même d'avoir eu le temps de recharger son arme, opération qui jusqu'à l'apparition du chassepot comportait six mouvements, en quatre temps réglementaires de chacun une minute. En admettant que la pluie ne vint pas noyer la poudre du bassinet, ou le froid paralyser les doigts du malheureux lignard.
Ce temps n'est plus. Le cheval de guerre n'est plus. Le fusil à tir rapide, la mitrailleuse, le canon se chargeant par la culasse, le char d'assaut, l'avion d'attaque au sol lancé en strafing, la tranchée avec ses réseaux de barbelé se sont ligués contre lui. Ils l'ont fait disparaître.
Le cheval de guerre, notre cheval des temps anciens, notre cher cheval aux yeux sombres et aux naseaux de velours, n'avait, lui, pour se défendre, que toujours ses mêmes armes, inchangées depuis l'origine du monde : ses quatre jambes aux sabots sonores, sa poitrine généreuse, sa robe alezane ou bai-brun, sa crinière emportée par le vent, son hennissement de combat qui jetait l'épouvante dans les rangs de l'infanterie. La partie n'était plus égale. Les autres avaient tout reçu - lui, rien.
Lorsque avait éclaté la guerre de 1914 et avant même qu'elle eût commencé, la cavalerie apparaissait déjà comme une arme périmée. Tout le monde le savait. Il aurait fallu être bien inintelligent pour ne pas le comprendre.
Alors pourquoi Français et Allemands avaient-ils quand même conservé tant de régiments de pure cavalerie à cheval ? Pourquoi s'étaient-ils entêtés ?
Là encore, il y a deux raisons, deux réponses à donner :
La première parce qu'il est difficile de se défaire d'un état d'esprit installé depuis des siècles et qui date de la plus lointaine antiquité.
Depuis que le monde était monde, on s'était toujours battu à cheval. Il était impensable que cela pût ne pas continuer. Aucun état-major de nations appelées à devenir belligérantes n'avait pris sur lui de décréter qu'étant donné la puissance de l'armement moderne le rôle du cheval de guerre était terminé et qu'en conséquence la logique exigeait qu'on supprimât purement et simplement la cavalerie.
Non, aucun état-major, ni d'un côté ni de l'autre, même parmi ceux ralliés aux idées nouvelles les plus avancées, n'avait consenti à prendre une position aussi catégorique, aussi tranchée. La sanction appartiendrait à l'avenir, elle se dégagerait d'elle-même des premières opérations de la nouvelle guerre. On verrait alors...
La seconde raison se parait - pourquoi ne pas le dire ? - d'une sorte de dilettantisme, de sentimentalisme, non seulement de la part des cavaliers mais aussi de la part de la foule. La cavalerie avait amassé tant de gloire sur tant de champs de bataille, sa légende était si brillante, si noble, le côté image d'Epinal était pour elle si ancré dans les esprits que l'opinion publique se fût émue et eût violemment réagi à la seule annonce que la cavalerie pourrait être supprimée.
Quant aux cavaliers eux-mêmes, aussi bien du côté français que du côté allemand, ils nourrissaient une rivalité historique réciproque d'où la haine, certes, n'était pas exclue, mais non plus l'estime et l'admiration.
Ils ne demandaient qu'à reprendre le dialogue interrompu, le 16 août 1870, sur le plateau de Ville-sur-Yron (De Mars-la-Tour, pour les Allemands.), où dix-huit régiments de cavalerie tant français que prussiens s'étaient entrechargés et sabrés dans une mêlée furieuse à l'arme blanche.
D'un côté comme de l'autre, ils caressaient secrètement la pensée - l'espoir - que malgré tout ce que l'on pouvait dire des effets destructeurs de l'armement moderne, ils trouveraient bien, eux, des occasions de se rencontrer, seuls à seuls, en dehors des limites de la bataille des autres, et de vider leur querelle sur le terrain, les yeux dans les yeux, le sabre et la lance à la main, comme jadis.
Telles étaient les vraies raisons, les raisons profondes pour lesquelles, le 3 août 1914, allaient s'affronter côté français quatre-vingt-neufs régiments de cavalerie à cheval, cuirassiers, dragons, chasseurs et hussards (sans compter les chasseurs d'Afrique, les spahis et les goumiers marocains de l'armée d'Afrique), côté allemand, dans l'armée impériale de Guillaume II, un nombre égal d'escadrons de cuirassiers blancs, de dragons, de uhlans, de chevau-légers et de hussards de la Mort.
Cependant personne ne se faisait d'illusions, la cavalerie, à moins d'un hasard miraculeux, ne serait pas appelée à jouer un rôle décisif dans la bataille.
- Et pourquoi pas ? disaient les optimistes irréductibles.
Il arrive qu'à la guerre l'inattendu, même l'invraisemblable, peut se produire. Une erreur, une faute de l'adversaire peut provoquer l'événement. Un instant d'inattention, de fatigue, de découragement peut survenir, créant l'accident de parcours. Alors, malgré son insuffisance d'armement, c'est l'heure de la cavalerie. Elle sort de ses fontes l'arme éternelle qu'elle a jalousement gardée au cours des siècles et qui lui a si souvent servi : la surprise. Avec la surprise tout devient possible. Les armes les plus récentes, les plus perfectionnées sont abandonnées, jetées au fossé par les troupes débandées, sujettes à la panique.
Le génie du chef de cavalerie est de discerner cet instant fugitif et de savoir découpler au bon moment ses escadrons.
Or, cet instant fugitif, providentiel, a sonné pour la cavalerie française au soir du 13 septembre 1914. Devenue anachronique, condamnée de toute façon à disparaître, la cavalerie a eu dans la main l'atout majeur lui permettant non seulement de finir en beauté mais de terminer son existence par un coup de maître sur un ciel d'apothéose dont la clarté ne se fût jamais effacée.
Il lui a simplement manqué d'avoir eu, ce soir-là, un chef jeune et dynamique, apte à saisir le cheveu de l'occasion qui passait comme l'éclair devant ses yeux. Il lui a manqué d'avoir eu le grand chef de cavalerie qu'eût mérité cette arme magnifique dont l'âme éprise de panache était de pur acier et se prêtait aux actions les plus audacieuses. Ne pas l'avoir eu a été un grand malheur pour elle, davantage encore pour la France.
L'Histoire doit demeurer l'Histoire, la Vérité la Vérité.
Tel est l'objet de ce livre dédié aux cavaliers de ce temps-là, mes camarades, les derniers chevaliers de France, dédié aussi à nos chevaux, au cœur ardent et qui ont tellement souffert pendant cette campagne de 1914.
Tous, cavaliers et chevaux, ont été frustrés de leur gloire suprême. Le grondement de tempête de leur charge dernière eût retenti jusqu'au fond des âges dans les pages de l'Histoire de France.
R. C.
LA DEPRIMANTE NUIT D'EPERNAY
Nuit du 2 au 3 septembre.
10 h du soir.
A la clarté des quelques réverbères restés allumés, Epernay, surencombré de troupes, offre un aspect insolite. La majeure partie du corps de cavalerie Conneau est là, répartie au hasard dans la ville, avec deux de ses trois divisions, leurs groupes d'artillerie, leurs chasseurs cyclistes, les fourgons hippomobiles de leurs trains régimentaires et leurs bagages. Plusieurs milliers de chevaux sont ainsi massés, tant bien que mal, à même les rues, tout sellés, mais débridés. Ils sont attachés par les rênes ou la longe-poitrail partout où l'on a pu trouver de la place.
Tout a été utilisé, les colonnes de fonte des lampadaires, les bancs, les tables et les chaises des terrasses des cafés abandonnés en hâte, les enseignes et les becs-de-cane des magasins, les crochets des volets et les balcons des rez-de-chaussée, les bêtes montées sans façon sur les trottoirs.
Mes chevaux figurent parmi les privilégiés. Ils sont parqués à l'intérieur d'un petit jardin public, près de la gare. Ils en ont profité pour brouter consciencieusement les fleurs aux saveurs inconnues des géraniums et des sauges des massifs jusqu'alors si bien entretenus. Il faut savoir, aux pires moments des guerres, ne pas laisser passer les bonnes occasions qui s'offrent. Tout est permis à la guerre.
Ensuite, ils ont bu au seau de toile à la borne-fontaine voisine, puis, à grands coups de nez, mangé leur avoine dans la musette-mangeoire attachée à la têtière. Maintenant, ils dorment, l'encolure basse.
Tous les chevaux du corps de cavalerie dorment ainsi debout, les naseaux près de terre. Les lances, restées fixées aux selles par le crochet porte-lance, côté hors montoir, se dressent, verticales. Cela forme, à la clarté diffuse de la lune à son premier quartier, comme une étrange forêt, une forêt indéfinie au long des rues, une forêt vivante, car, au souffle de la respiration des bêtes endormies, les lances oscillent et s'entrechoquent avec un mystérieux murmure. Forêt menaçante aussi, avec toutes ces pointes d'acier qui étincellent aux rayons de la lune.
Une impression de force se dégage de cette masse d'hommes et de chevaux, de canons muets mais prêts à tonner. Le corps de cavalerie est l'a, au cantonnement d'alerte. Au premier signal, les chevaux seront rebridés, les sangles resserrées, les cavaliers en selle ; les unités seront reformées. Dix secondes y suffiront. Défense de s'éloigner, ordre de rester sur place, derrière les chevaux, chaque homme gardant sa carabine.
Tableau extraordinaire, vision saisissante qui ne durera que quelques heures et que l'Histoire ne saura retenir. Il faudrait la plume d'un Chateaubriand pour le décrire, le pinceau d'un Meissonnier, d'un Detaille, le crayon d'un Raffet, pour le fixer pour l'avenir. Hélas, la bataille de la Marne n'aura ni son Chateaubriand, ni son Meissonnier, ni son Detaille, ni son Raffet (On doit en effet regretter que la guerre de mouvement de 1914 n'ait pas eu de peintre d'histoire militaire assez inspiré pour en tirer quelques tableaux d'envergure dignes d'elle. A défaut de pouvoir restituer son atmosphère et ses dimensions, on aurait pu espérer qu'à tout le moins se seraient révélés quelques peintres notoires pour en fixer les principaux épisodes. Il n'en a rien été. Espoir déçu. ).
Je n'ai pas voulu quitter mes hommes. Je reste toujours avec eux lorsque l'heure est incertaine, les nouvelles déprimantes. Les visages sont préoccupés, inquiets. Je me suis efforcé de rassurer tout le monde, de trouver des arguments : On nous a débarqués ici sûrement dans le but de protéger la retraite de nos armées, mais cette retraite est volontaire. Elle est tellement importante, qu'il ne peut s'agir que d'une vaste manoeuvre. C'est comme en Lorraine. On n'a laissé pénétrer les Boches que pour mieux les encercler.
On les a bien arrêtés en Lorraine, non ? C'est nous qui les avons arrêtés, c'est pourquoi on nous appelle ici. C'est la même manœuvre, c'est évident ! On compte sur nous, alors on sera un peu là !
Mes hommes me croient-ils ? Bien sûr qu'ils me croient ! Pour les cavaliers, l'officier (qui monte si bien à cheval !) c'est un peu le Bon Dieu.
Cependant, autour de nous l'exode des habitants d'Epernay se propage et s'accélère. La ville se vide. Tout à l'heure, à la gare, le dernier train en partance vers le sud a été pris d'assaut. Ceux qui n'ont pu y trouver place s'organisent à présent pour partir quand même, avec des voitures à cheval, des bicyclettes, des charrettes à bras, des brouettes, ou, s'il le faut, avec des bagages sur le dos. Les lueurs d'incendie sur l'horizon du nord et les récits de la sauvagerie allemande apportés par les réfugiés, plus ou moins véridiques, sèment l'angoisse.
A quelques pas, mon sous-officier de peloton, le maréchal des logis Souquet, discute avec une femme accompagnée de deux jeunes enfants. Elle est distinguée, bien mise, visiblement de bonne condition. Coiffée d'un chapeau de paille noir, elle a un sac de montagne lié aux épaules. Je l'entends dire :
- C'est comme ça que vous les laissez passer ! Vous êtes tous des lâches !
- Ça n'est pas nous, nous arrivons de Lorraine !
A mon approche, elle s'écarte, tenant par la main le plus jeune des enfants, l'autre portant une valise. Ils vont prendre la route, à pied. Tandis qu'elle s'éloigne, elle répète à chaque pas :
- Des lâches... des lâches... des lâches...
- Ça, c'est pire que tout ! me dit Souquet, un sanglot dans la voix.
Il a raison, c'est pire que tout. Une vision qui ne s'effacera pas...
11 h du soir
Toujours pas d'ordres...
Il s'agit quand même de se mettre en quête d'un coin où aller dormir, ne serait-ce qu'une heure. Dormir ? Il fait très froid. Le ciel est clair. Il y aura sûrement de la gelée blanche dans les trèfles au point du jour. J'entends avec étonnement deux de mes hommes en émettre entre eux la probabilité. Ce sont deux cultivateurs limousins, fils de métayers. S'intéresser à de si minces choses en ce moment ! Chassez le naturel, il revient au galop...
Pour moi, je ne puis surmonter mon inquiétude, mon impatience. Mais que faisons-nous ici à ne pas bouger ? Chaque heure qui passe est cependant précieuse ! Reims brûle là, tout près, à moins de vingt-cinq kilomètres. Le bruit court que la cathédrale est en feu. Non, c'est impensable, les brutes, les vandales ! Et la vague de l'invasion continue d'avancer ! Elle va atteindre la Marne à Château-Thierry. L'ennemi à Château-Thierry, Reims abandonné ! Une simple marche de nuit et les Allemands peuvent être ici avant le jour. Nous n'avons même pas un réseau de grand-garde !
Mais où est Conneau, notre commandant en chef ? Où est-il ? Que fait-il ? Que pense-t-il ? Quelles instructions a-t-il reçues du Grand Quartier Général ? On ne le voit pas ! Que de temps perdu ! Cette inaction est grave !
Evidemment, je ne connais rien de la situation générale, mais nous en savons tous suffisamment, pour penser qu'il n'y a pas une minute à perdre ! L'ennemi avance, lui, en ce moment. Il ne s'arrête pas, tous les renseignements des réfugiés concordent. Et nous, nous nous morfondons ici, sans rien faire, au cantonnement d'alerte !
J'en arrive à douter du général Conneau. Est-il bien le général de cavalerie dont nous avions rêvé au départ ? Il devrait au moins réunir ses commandants de division, ses brigadiers, ses colonels, leur parler.
Notre colonel, le colonel Gailhard-Bournazel, ne sait rien ! Personne ne sait rien... L'inaction, le silence... Quoi qu'il en soit, il n'y a qu'à attendre...
Je décide d'aller m'asseoir au milieu de mes hommes, le dos appuyé au mur des immeubles, les jambes allongées sur le trottoir, le calot enfoncé jusqu'aux oreilles, le casque posé à terre, à portée de la main. Le froid me tiendra éveillé. Et l'amertume aussi.
Me voici installé, côte à côte avec le maréchal des logis Souquet, le brigadier Vialle, devant nos chevaux. Le garde d'écurie va et vient à pas lents. Vialle et Souquet s'endorment rapidement. Je vais avoir tout loisir de revivre par la pensée les péripéties de ce premier mois de guerre. C'est vrai, 3 août-3 septembre, exactement un mois.
Dans la nuit du 3 août, à minuit, nous nous embarquions à la gare des Bénédictins, salués par les casquettes des employés, derniers témoins, très émus, de notre départ :
- Au revoir, les enfants ! Et vive la France !
Tout s'était bien passé. Les exercices d'embarquement des chevaux, regardés par tous - officiers et cavaliers - comme une assommante corvée, en temps de paix, s'étaient néanmoins souvent répétés, hivers comme étés. Ils avaient porté leurs fruits. La preuve avait été faite qu'ils étaient bien nécessaires.
Et depuis ?...
Depuis, ayant débarqué, aujourd'hui, vers 9 heures du soir, en catastrophe, en gare d'Epernay, nous étions venus échouer dans cette ville, assis sur les trottoirs, au clair de lune. C'était à peine croyable. Après seulement trente jours ! D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel dramatique enchaînement d'événements nous a conduits jusqu'ici.
Au départ, le 20e dragons (mon régiment) faisait, avec trois autres régiments, les 10e, 15e et 19e dragons, organiquement partie de la 10e division de cavalerie indépendante. Le rôle assigné, à la mobilisation, à cette division, était de rejoindre sans délai la 2e division de cavalerie de Lunéville, afin d'assurer avec elle la couverture de la concentration de la IIe armée (général de Castelnau) en Lorraine, sous les murs de Nancy. Rôle qu'elle avait rempli de son mieux durant les deux premières semaines.
L'ESPRIT DE CHEVALERIE
Au cours de cette période, la cavalerie française avait incontestablement pris l'ascendant sur la cavalerie allemande, à la faveur des nombreuses et brèves rencontres qui s'étaient produites entre reconnaissances et détachements de découverte. Les cavaliers allemands, au lieu de faire face, refusaient le combat et fuyaient devant nous.
Non par lâcheté, mais par ordre, par mise en application d'un règlement méthodique et intelligent : tandis qu'une partie du détachement restait à cheval, ayant l'air de fuir, elle attirait sous le feu de l'autre partie dissimulée au combat à pied, laquelle attendait sans risques et nous fusillait à coup sûr.
C'était, certes, un manque révoltant de l'esprit de chevalerie traditionnel dans la cavalerie, mais - il fallait le reconnaître combien efficace !
Témoin, l'affaire de notre infortuné camarade, le lieutenant des Etangs, du 15e dragons (le régiment frère) qui dormait aujourd'hui ,
avec presque tout son peloton, dans le petit cimetière de Chézelles. Nous avions ainsi appris à mépriser la cavalerie allemande. Pas toujours cependant. Il y avait aussi des chevaliers chez elle. Nous en avions eu plusieurs exemples dont un précisément chez nous, au 20e dragons. Il nous avait beaucoup impressionnés :
Le sous-lieutenant Verny.
Le 10 août, le sous-lieutenant Verny, du 1er escadron, frais émoulu de Saint-Cyr (il avait rejoint le 20e le jour même de la mobilisation) était en reconnaissance sur la frontière, aux abords de la forêt de Parroy. Il avait emmené avec lui une douzaine de ses cavaliers, dont le maréchal des logis Dartigues. Comme il suivait la lisière de la forêt, son éclaireur de terrain était revenu sur lui au galop, haletant, l'avertir qu'un parti de cavalerie ennemi venait au pas à sa rencontre, sans se douter de rien. Un repli de terrain ne permettait ni aux uns ni aux autres d'encore s'apercevoir. Verny, ayant alors commandé Lance main ! En bataille, avait, lui-même, mis le sabre à la main et fait prendre le trot.
Quand les chevau-légers bavarois avaient enfin découvert les dragons français, deux cents mètres encore les séparaient. L'officier allemand, surpris, avait tout d'abord eu le réflexe de faire demi-tour avec ses cavaliers (dont l'effectif était d'environ un demi-peloton, comme du côté Verny). Mais il s'était aussitôt ressaisi et avait décidé de faire tête. Il avait ramené ses hommes, eux aussi rangés en bataille, au galop face aux Français. Les dragons avaient pris à ce moment le galop de charge. Verny seul à deux longueurs en avant. Lanciers contre Lanciers, le choc ne pouvait qu'être terrible. Il le fut en effet. Hommes et chevaux, culbutés, avaient tous roulé sur le sol.
Verny était indemne. Couché sur l'encolure, la pointe du sabre en avant, il avait évité de justesse celle de l'officier allemand dont il avait transpercé la poitrine. Pas un dragon n'avait été touché. A l'inverse, les chevau-légers avaient eu plusieurs tués, d'autres blessés. Tout le détachement ennemi avait été mis hors de combat et fait prisonnier, hommes, chevaux et armement. Un tel succès était le bénéfice de l'instruction française pour l'emploi des armes. Nos cavaliers étaient entraînés à se tenir tassés derrière la tête du cheval, tenant à droite la lance basse, très basse et bien horizontale, à hauteur de la ceinture de l'adversaire. Et surtout pas la pointe en oblique en l'air ! Nous l'avions tant de fois répété, ressassé, démontré !
J'ai entendu, plusieurs heures après le combat, le colonel interroger un dragon, considéré comme le héros de la rencontre. A lui seul, il avait tué trois chevau-légers. Le premier à la lance, au moment du choc. Précipité à terre comme tout le monde, il s'était relevé et avait entendu le maréchal des logis Dartigues appeler à l'aide, en train de lutter corps à corps avec un cavalier allemand et en grand danger d'avoir le dessous. Alors, décrochant sa carabine à la grenadière, tout approvisionnée, il avait, à bout portant, fait sauter le crâne de l'adversaire de Dartigues. Et de deux. A ce moment, le seul chevau-léger rescapé, ayant réussi à sauter sur un cheval et allant s'enfuir au galop, il l'avait abattu à trente mètres d'une balle dans le dos.
Ce dragon s'appelait Arsène Létang. Il avait son nom inscrit au crayon sur son couvre-casque. Je l'avais lu. Tandis que le colonel le félicitait, il se tenait devant lui, tout gêné, tout timide et frêle comme une fille. Un tueur, lui !
La guerre est une chose horrible...
Tandis que Dartigues ramenait triomphalement le détachement,. avec les prisonniers survivants ou blessés, sur les chevaux allemands. tenus en main et la moisson de lances, le sous-lieutenant Verny s'était occupé du lieutenant de chevau-légers qu'il avait mortellement blessé. Ayant requis sur place des paysans âgés travaillant dans les champs, il l'avait fait transporter avec d'infinies précautions à la mairie du village voisin : Emberménil. Il avait veillé lui-même à son transport
, et refusé de le quitter tant que le médecin-capitaine du 20e dragons
prévenu, ne serait pas venu lui prodiguer les premiers soins.
Beau et blond comme un Siegfried, cet officier se nommait von Schmidt. Il avait, comme Verny, une âme de chevalier. Il pouvait encore parler et s'exprimait dans un impeccable français.
- Je vais mourir. je suis catholique romain comme sans doute vous, monsieur ?
Il avait tiré un chapelet de sa poche.
- Nous allons en dire une dizaine ensemble, voulez-vous, monsieur ? Serrons-nous la main. Je ne pouvais souhaiter plus belle mort. Celle que je souhaitais, de la main d'un héros comme vous dans une rencontre de cavalerie. Adieu, monsieur ! Gardez mon épée en souvenir de moi, je vous la remets. Sachez qu'elle est digne de vous.
Les témoins de la scène, le médecin-capitaine et les paysans qui avaient transporté le blessé, n'avaient pu, comme Verny, retenir leur émotion.
Puis le lieutenant von Schmidt avait remis à Verny tous ses papiers, les photos qu'il portait sur lui et donné l'adresse de sa mère demandant qu'on les lui fît parvenir par l'intermédiaire de l'ambassade d'Allemagne en Suisse. Ce que lui promit Verny. Et qui fut fait. Avec une lettre de Verny à sa mère, lui apprenant les circonstances de la mort héroïque de son fils.
Transporté à l'hôpital militaire de Lunéville, le lieutenant von Schmidt était mort dans la soirée, malgré tous les soins dont il avait été entouré. Verny était revenu le voir, alors qu'il était encore vivant. L'aumônier était à son chevet, le réconfortant.
Le lendemain, comme je félicitais Verny, il m'avait interrompu : - Tais-toi ! Tu ne sais pas comme c'est dur d'avoir tué quelqu'un comme ça, à l'arme blanche et de rencontrer ensuite son regard !
Comme la cavalerie française, la cavalerie allemande avait aussi ses chevaliers.
Ce jour-là, le sous-lieutenant Verny n'avait plus, lui-même que deux mois à vivre. Le 8 octobre, il serait le premier officier du 20e dragons tué à l'ennemi. En voici les circonstances :
Depuis la fin de la bataille de la Marne, si malencontreusement terminée le 14 septembre, une nouvelle phase de la guerre s'était ouverte. L'histoire la retiendrait sous le nom de Course à !a mer. Au cours de cette période, les deux adversaires s'étaient efforcés de se battre mutuellement de vitesse, afin de déborder l'aile ennemie (la droite allemande pour les Français, la gauche française pour les Allemands).
Le haut commandement ne pouvant s'en remettre complètement à l'aviation pour le renseigner, le rôle dévolu aux jeunes officiers de cavalerie - la plupart sous-lieutenants, au tempérament ardent - avait été plus que jamais d'exécuter des reconnaissances audacieuses, pour parvenir à (selon la formule tactique consacrée) " déterminer le contour apparent de la zone tenue par l'ennemi
La cavalerie française y avait fait merveille avec son enthousiasme habituel, non sans risques ni pertes. C'était là que le sous-lieutenant Verny, héros d'Emberménil, toujours intrépide, devait trouver une mort glorieuse.
La veille, mercredi 7 octobre, l'auteur de ce livre avait été envoyé, non loin du village de Ransart (en Artois) sur la lisière d'une forêt dénommée bois d'Adinfer, présumée tenue par l'ennemi. C'était à vérifier.
Devant la forêt s'étendait un long glacis absolument nu planté de betteraves, très dangereux à traverser à cheval, vu de toutes parts. Ayant laissé les quelques dragons qui l'accompagnaient à l'abri dans un repli de terrain l'officier avait continué seul, à cheval. Ce qui était imprudent. Arrivé à moins de deux cents mètres de la lisière, il avait été accueilli par une volée de balles. L'une d'elles avait perforé la bombe de son casque, lui coupant les cheveux au ras de la tête. Sa jument avait eu l'encolure traversée par une autre en avant du garrot. L'officier avait eu le temps d'apercevoir des uniformes gris occupés a travailler à un épaulement en bordure du bois d'Adinfer. Il avait été manqué de justesse par un tireur d'élite, sans doute muni d'un fusil à lunette. Il revenait de loin.
Le lendemain jeudi 8, le général commandant la 10e division avait envoyé une nouvelle reconnaissance au même endroit, pour voir si l'ennemi occupait toujours le bois d'Adinfer, travaillant à en fortifier la lisière.
L'auteur de ce livre, appuyé par le colonel du 20e dragons, jugeant cette reconnaissance inutile et dangereuse, avait expressément déclaré qu'il était évident que l'ennemi tenait toujours le bois d'Adinfer, puisqu'il y travaillait. Le général Grellet avait maintenu son ordre.
C'était au tour de Verny de partir en reconnaissance. Son camarade l'avait bien mis en garde :
- Mon vieux, fais très attention, prends garde ! Il y a en face un sniper qui tire bougrement bien c'est très malsain ! Tu as vu pour moi ? Vas-y à pied, en rampant dans les betteraves, on ne te verra pas.
Verny, à cette évocation de faire du plat ventre dans les betteraves, avait remercié d'un sourire, sans répondre. Il était très promotion de la Grande Revanche, casoar et gants blancs. Ramper n'était pas son genre. Il avait préféré faire comme son ancien, mettre ses hommes à l'abri et continuer seul, à cheval.
Mais lui, la première balle l'avait frappé au cou, à la carotide. Il avait eu la force de revenir à cheval, au milieu de ses hommes, son col blanc gainé de sang vermeil. Il avait encore pu faire signe à son maréchal des logis qu'il voulait lui parler seul à seul : il pouvait péniblement s'exprimer :
- Dartigues je meurs... Je suis chrétien... Je veux mourir en état de grâce... Pas le temps de me confesser... pas possible... C'est à vous que je vais le faire... dire mes péchés... Vous irez les répéter à un prêtre, le premier rencontré, au premier village... Il comprendra... Promettez et écoutez !
Il était mort à cheval, soutenu par son sous-officier en larmes. Il avait été ramené ainsi dans les lignes françaises toujours à cheval, maintenu en selle par deux de ses hommes.
Avait-il eu le temps d'avoir une pensée pour le lieutenant von Schmidt, cet autre héros, tué de sa main le 10 août à Emberménil ?..
Dans la nuit même, il avait été enterré devant tout son peloton et les officiers du 20e dragons, dans le cimetière du petit village de Ransart ; sa confession ayant été transmise au curé de la paroisse.
C'était la mort d'un preux... à l'âge de vingt ans.
QUI SOMMES-NOUS ? D'OU VENONS-NOUS ? OU ALLONS-NOUS ?
Incapable de dormir, - il fait vraiment trop froid - je revis dans tous leurs détails ces si proches souvenirs.
Et depuis que s'est-il passé ?
En Lorraine, la concentration de la IIe armée du général de Castelnau était maintenant terminée. Le 16 août, sans perdre un jour, elle avait pris l'offensive et franchi la frontière. Offensive de diversion, à l'aile droite du dispositif d'ensemble, sur laquelle Joffre comptait, tandis qu'appliquant le fameux Plan XVII, il prononcerait l'offensive principale au centre avec ses IIIe armée (général Ruffey) et IVe armée (général de Langle de Cary) spécialement renforcées dans ce but.
La 10e division de cavalerie, mise alors à la disposition de la IIe armée, l'avait accompagnée dans son action offensive dans le couloir lorrain de la région des Etangs entre Metz et Strasbourg.
Les 15e et 20e corps, engagés en premier échelon, s'étaient bientôt heurtés à un front continu, puissamment fortifié dès le temps de paix, avec tranchées bétonnées, casemates et épaulements d'artillerie. Les champs de tir avaient été soigneusement repérés, jalonnés, les hausses préparées. Une telle organisation avait demandé de longs mois de travail, preuve surabondante de la volonté de l'Allemagne de provoquer et de déclarer cette guerre. Deux autres facteurs avaient encore joué en défaveur de l'armée Castelnau, comme d'ailleurs pour toute l'armée française :
D'abord le S.R. français n'avait pas signalé l'existence de fronts fortifiés, pas plus qu'il n'avait découvert celle d'un corps de réserve frère jumeau de chaque corps actif, portant le même numéro que le sien et qui serait engagé dès le premier jour en même temps que lui. C'était une terrible lacune dans l'évaluation des effectifs ennemis auxquels aurait affaire le commandement français dès la première heure de la campagne. L'erreur pouvait aller du simple au double ! Simplement.
A cette grave ignorance s'était ajoutée l'adoption dans toute l'armée française de la trop célèbre doctrine dite de l'offensive à outrance, attribuée au colonel de Grandmaison (Le colonel de Grandmaison s'est fait héroïquement tuer en s'élançant à l'assaut à la tête de ses hommes.), professeur de tactique à l'Ecole de guerre. Défendable sur le plan stratégique, elle était hors de toute raison sur le plan tactique avec la terrible puissance de feux de l'armement moderne.
Malheureusement imbue et à fond de cette doctrine, l'infanterie des 15e et 20e corps, méprisant le feu des mitrailleuses et de l'artillerie, s'était ruée à la baïonnette avec un entrain superbe contre les ouvrages fortifiés. Son élan avait été brisé sur place par des nappes de balles et des rafales d'obus infranchissables. Des bataillons entiers, sans qu'ils eussent même vu l'ennemi, avaient été, officiers et sous-officiers en tête, fauchés avec leurs pantalons rouges (cet imbécile anachronisme) comme coquelicots dans les blés, sur le glacis ensoleillé des champs soigneusement dégagés de leurs javelles par l'ennemi., pour ne pas gêner son tir, les hausses ayant été calculées à l'avance L'armée française dès les premiers combats perdait ce qu'elle avait de meilleur. C'était à pleurer.
La retraite avait dû être ordonnée.
La 10e division de cavalerie avait reçu le baptême du feu le 18 août, anniversaire de Saint-Privat, en 1870. Prise sous une violente canonnade sur le polygone de la garnison allemande de Sarrebourg (lui aussi soigneusement jalonné) les schrapnells avaient été bien ajustés mais heureusement débouchés trop haut. Elle avait néanmoins rempli son rôle de flanc-garde. Ses pertes avaient été sans comparaison avec celles de l'infanterie, mais cependant sérieuses.
Puis, elle s'était déployée sur la Vezouze, en rideau, pour couvrir la retraite de la IIe armée. C'était depuis des temps immémoriaux, la mission traditionnelle de la cavalerie, selon les circonstances : exploiter la victoire, ou protéger la retraite.
Nous avions connu des moments difficiles et même d'angoissantes épreuves. Allions-nous réussir à contenir l'ennemi, toujours prêt à déborder nos ailes ?
Le kronprinz de Bavière, commandant la VIe armée allemande, jusqu'alors appuyée aux camps retranchés de Metz et Strasbourg, était judicieusement resté sur la défensive. La IIe armée française ayant été décimée et la victoire remportée à bon compte (ses fantassins et ses artilleurs avaient dû connaître de faciles et substantielles jouissances) il avait alors passé à la contre-offensive. Son infanterie avait avancé l'arme à la bretelle, sans rencontrer d'autre résistance que celle de nos carabines et des salves meurtrières de nos volants (Terme amical et admiratif pour désigner les batteries d'artillerie de 75 rattachées organiquement aux grandes unités de cavalerie. Chaque division possédait ainsi un groupe de 75 à trois batteries de quatre pièces, soit au total 12 pièces, ce qui était bien insuffisant. La cavalerie est première responsable de cette pauvreté. Son arme de prédilection et la plus efficace, affirmait-elle à toute occasion, était l'arme blanche, le sabre et la lance, seule digne d'elle. Elle n'en demandait pas d'autre ! C'était là une grande erreur et pécher par orgueil. On mesurera son mépris pour les armes à feu quand on saura qu'en fait de mitrailleuse, elle ne possédait en tout et pour tout, par brigade, qu'une unique section de mitrailleuse à deux pièces - modèle Saint-Etienne -, section qui était affectée à tour de rôle tantôt à l'un tantôt à l'autre des deux régiments de la brigade. Mais, là encore, cette indigence ridicule était imputable à la cavalerie elle-même. Avait-on jamais vu, en temps de paix, un seul de ses directeurs en réclamer davantage ? A la mobilisation, à la brigade à laquelle j'appartenais et qui devait s'illustrer sous le nom de brigade des Quinze-Vingts (15e et 20e dragons, la section de mitrailleuses se trouvait être affectée au 15e dragons. Le régiment l'avait gardée. Aujourd'hui, la section était réduite à une seule pièce, l'autre ayant été détruite par un obus de plein fouet, avec son attelage à cheval, lors du violent combat de Prancoville, le 24 août. Il y avait de cela huit jours, elle n'avait pu être encore remplacée. Au plus fort de l'action, le commandant de section, le lieutenant de Vauchaussade de Chaumont, avait été tué glorieusement, en dirigeant le tir de ses pièces.).
Le fort d'arrêt de Manonvillers avait bien mêlé à la partie la rude voix de sa grosse artillerie et réussi quelques coups au but spectaculaires, mais que pouvait-il faire isolément ? Dépassé par le flot de l'invasion, il n'aurait qu'à s'enfermer dans ses défenses, faire le hérisson et attendre des jours meilleurs. A moins de désespérer de tout, la contre-attaque française aurait bien son heure, alors il reprendrait ses tirs contre les colonnes de l'ennemi à son tour en retraite et serait dégagé. C'était bien ainsi que les choses se passeraient. Nancy inviolé, Lunéville avait été perdu mais serait repris, ainsi que Blâmont et toute la partie de la Lorraine investie.
Pour le moment on n'en était pas encore là, mais en bonne voie de l'être.
Rupprecht de Bavière, se croyant vainqueur, s'était heurté au Grand-Couronné, mais sans succès. Castelnau l'avait repoussé et regardé avec satisfaction s'enfoncer plus au sud, en Lorraine. Rupprecht avait commis à l'aile gauche la même erreur que von Kluck à l'aile droite. Contrevenant aux ordres de la Direction Suprême de von Moltke (Neveu du grand Moltke de 1870, mais loin d'en avoir la valeur.), il s'était estimé capable de poursuivre plus avant la IIe armée française jugée sur ses fins, de l'anéantir et d'ouvrir une brèche par la trouée de Charmes. Alors il réaliserait la percée et ferait irruption sur les arrières du corps de bataille français, après avoir réussi à enrouler son aile droite (Le fameux aùfrollen, le vieux rêve stratégique allemand. Joffre voulait, lui, attaquer au centre et enfoncer le front ennemi).
Programme ambitieux. D'abord la IIe armée, malgré ses pertes était très vivante. Castelnau l'avait bien en main. On attirerait le prétentieux kronprinz de Bavière loin de ses bases de Metz et de Strasbourg, où sa défensive avait été payante, on l'emmènerait en rase campagne et on le battrait en terre française, quelque part entre la Moselle et la Colline inspirée.
Chargée de ralentir et d'user l'avance de l'ennemi en le forçant à se déployer pour combattre, la 10e division de cavalerie avait eu à livrer de violents combats, à Franconville et à Rozelieures. Le général de Castelnau l'avait félicitée pour être parvenue, à l'aide de ses faibles moyens de feu, à stopper pendant vingt-quatre heures, comme il le lui avait demandé, la poussée non pas d'un, comme on l'avait cru au début, mais bien de deux corps d'armée (ainsi que l'avait révélé l'identification des prisonniers).
Ainsi, la part prise par la cavalerie aux opérations qui allaient finalement aboutir à la victoire de Lorraine avait-elle été importante et glorieuse. En particulier la brigade des Quinze-Vingts. Les 15e et 20e dragons pourraient inscrire sur leurs étendards les noms de Franconville et de Rozelieures, non sans avoir subi de sensibles pertes.
Il leur fallait maintenant se refaire. La victoire défensive étant acquise, Rupprecht de Bavière en retraite vers le nord (Lunéville, Blâmont, Avricourt et le fort de Manonvillers allaient être libérés et le terrain repris jusqu'au canal de la Marne au Rhin), la 10e division de cavalerie avait été mise au repos le 29 août sous les murs de Nancy. Elle allait pouvoir combler ses vides, recevoir de ses dépôts des renforts en hommes, chevaux, armement et équipement.
Ce 29 août, le 20e dragons avait été mis au cantonnement, à la nuit tombante dans un faubourg de Nancy, aux portes mêmes de la ville, à Tomblaine, sur le bord de la Meurthe. Ce repos durerait trois jours. Les chevaux enfin dessellés avaient reçu les soins nécessaires sous la surveillance des vétérinaires. Beaucoup commençaient à présenter des blessures sur le dos. On avait pu ainsi les mettre à l'eau jusqu'aux genoux et aux jarrets dans un gué de la Meurthe. Quelle volupté pour nos braves chevaux ! Certains se roulaient dans l'eau, les quatre fers en l'air et prétendaient ne pas se relever.
Béatitude du repos pour les bêtes et les hommes. Personnellement, j'avais pu prendre un vrai bain et coucher dans un lit. J'avais pu aussi me faire couper les cheveux chez un coiffeur professionnel de Nancy. La cuisine des officiers avait été organisée dans les dépendances d'une filature. Autre béatitude, s'asseoir à une table et manger dans une assiette. Nous avions été royalement reçus et installés. N'avions-nous pas été les sauveurs de Nancy ?
Les hommes, eux aussi bien sûr, avaient eu leur content. Il importait de remettre le peloton en ordre, de lui redonner une apparence de bonne tenue. Les hommes avaient pu se déshabiller, se baigner dans la Meurthe, même ceux qui n'y tenaient guère. Mais j'étais là ! Les cheveux trop longs avaient été coupés par le perruquier du peloton, les boutons recousus et les manquants remplacés, les jambières recirées et reluisantes.
Je tenais énormément à la bonne figure de mon peloton, hommes et chevaux. J'avais lu les célèbres carnets du capitaine Coignet et m'étais nourri de ses conseils et avis : le moral d'une troupe (surtout de cavalerie) dépend de sa bonne ou mauvaise tenue. Une troupe qui n'est pas fière de sa tenue ne saurait se bien conduire au feu.
J'avais, au départ, obligé mes hommes (bien que ce ne fût pas prévu par les règlements) à emporter dans leur paquetage le nécessaire pour les soins de propreté et d'entretien pour hommes et chevaux. Evidemment, l'exiguïté du paquetage ne permettait pas à chaque cavalier de se munir de tous les objets indispensables. J'y avais pourvu par la solution de la répartition, exigeant que dans chaque escouade un homme eût dans ses sacoches un bouchon de chiendent et un autre l'étrille, un autre une trousse sommaire avec fil noir et fil rouge, aiguilles, boutons de rechange pour tuniques et culottes, un troisième du savon minéral pour les aciers (mors de bride, mors de filets, étriers, fourreaux de sabres et éperons), un quatrième un nécessaire à chaussures avec brosses et cirage noir, enfin un cinquième pâte à cuivre et chiffons pour les fleurons des brides et les poignées de sabre, etc.
Certes, je n'étais pas riche, mais en prévision des grandes manœuvres de l'été, j'avais tout de même fait quelques dépenses - oh ! pas beaucoup - pour munir mon peloton de tous les objets ou ingrédients que ne pouvait me fournir le magasin de l'escadron. De même pour les médicaments de première nécessité : aspirine, teinture d'iode
, coton et compresses. Cela allait servir pour la guerre.
Je n'étais pas une exception et la plupart des officiers du régiment en avaient fait autant.
Ainsi, dans mon peloton chaque escouade était-elle munie de l'indispensable pour pouvoir vivre en vase clos.
Ceci nous avait précieusement servi au repos à Tombaine. A l'heure des opérations et des combats, le souci de la tenue avait passé naturellement au second plan, on n'y prenait pas garde. Mais à présent, en période de calme et à la lumière crue du jour, l'aspect de la troupe, cavaliers et chevaux, était pitoyable - pour moi, insoutenable, inadmissible !
A l'arrivée au cantonnement, j'avais passé une rapide inspection de mon peloton, les hommes pied à terre, à la tête des chevaux, selle avec paquetage et couverture à cheval posée à terre devant le cavalier. Un coup d'œil m'avait suffi. Mais quel triste coup d'œil !
- Rompez ! avais-je dit aussitôt. Rentrez les chevaux, les paquetages ! Et dans une minute rassemblement ici, autour de moi, tête nue et sans armes ! J'ai à vous parler.
Le peloton réuni, j'avais mis les hommes au repos et leur avais tenu à peu près le langage suivant :
- Je vous aime bien, vous vous êtes bien battus, vous avez reçu le baptême du feu et fait belle figure. Je suis fier de vous, mais entendons-nous, fier de vous moralement, pas du tout fier de vous physiquement en ce moment ! Regardez-vous, regardez votre tenue, vos uniformes déchirés, vos harnachements, vos étriers rouges de rouille, vos jambières pleines de boue séchée, vos perruques, vos barbes, pour les rares d'entre vous qui en ont, pas rasées depuis un mois ! Pour moi, vous m'avez vu, je me rase tous les matins, où qu'on soit. Ça me dégoûterait d'être tué ou blessé pas rasé !
" Regardez-vous ! Vous êtes tous dégueulasses ! Vos chevaux sont dégueulasses ! Tout est dégueulasse ! Le peloton est dégueulasse ! Mais, Bon Dieu, ça va changer ! Nous sommes ici pour au moins trois jours, à ce qu'on dit. Alors, vous allez recevoir des visites, les habitants de Nancy vont venir vous voir, c'est sûr, les femmes les premières, pour vous féliciter, vous acclamer, vous embrasser. Vous avez quand même de drôles de gueules pour des sauveurs de la patrie !
(A cette évocation de visites féminines, les hommes s'étaient mis à doucement glousser. C'étaient de braves types ! Oui, je les aimais bien et ils m'aimaient bien.)
" Ce soir, à six heures, revue générale, les hommes à la tête des chevaux sellés, je veux tout revoir. Vous avez toute la journée devant vous, pour tout remettre en ordre, tout astiquer !
" Au travail ! Et que ça brille ! Que ça saute ! Rompez ! "
Le soir, à la revue, tout avait été propre, briqué. Le peloton était transformé, rasé, rajeuni. On se serait cru en temps de paix, dans quelque ville de garnison plutôt qu'en temps de guerre. Cependant, le canon tonnait encore au loin par intermittences. On harcelait les troupes en retraite du prince héritier de Bavière. Le dimanche 30, certains d'entre nous avaient été, à pied, entendre la messe à Nancy. Quelle détente !
Le lundi 31 après-midi, deux grandes nouvelles nous étaient parvenues coup sur coup, toutes deux officielles : notre 10e division. avec deux autres divisions, allait constituer un corps de cavalerie, le 2e corps de cavalerie, sous les ordres de notre propre général, le général Conneau. (Le 1er corps se trouvait dans le Nord, aux ordres du général Sordet.)
Autre grande nouvelle : ce corps aussitôt formé et rassemblé, serait embarqué sans délai par voie ferrée de l'autre côté de la forêt de Haye, à douze kilomètres. Destination inconnue, secrète. Points d'embarquement pour la 10e division : Neuves-Maisons et Chaligny. Train prévu pour le 20e dragons, dans la nuit du 1er au 2 septembre, à Chaligny. Se tenir prêts. Les trains se succédaient sans interruption. Le temps pressait.
Le capitaine de Langlois, commandant le 3e escadron (le mien) m'avait envoyé, en éclaireur, reconnaître notre quai d'embarquement à Chaligny. Très sommaire, pas de longrines, ni de rampes d'embarquement. Il faudrait faire, à même le ballast, des rampes de rondins et de terre battue (certaines avaient été construites par nos prédécesseurs, mais aussitôt effondrées après usage.) Il faudrait hisser les chevaux, se débrouiller ! Et faire vite !
Le temps pressait ? Que signifiait ?...
La journée du mardi 1er septembre s'était passée en préparatifs, à refaire et boucler les paquetages, à remplir d'avoine les bissacs de toile cachou... et à discuter de notre destination probable. On s'était perdu en conjectures.
LA GRANDE ILLUSION
A Chaligny, j'avais appris que beaucoup de trains de cavalerie étaient déjà partis et que nous embarquerions vers minuit, ou même vers la fin de la nuit, à l'aube. L'encombrement des gares de Neuves-Maisons, de Bayon, et de Chaligny était très grand. Il n'était pas possible d'organiser les départs plus rapidement, faute de moyens.
La brigade de Contades ( 17e et 18e chasseurs), détachée de la division de Lunéville et affectée à la 10e division (laquelle manquait de cavalerie légère et passait ainsi à six régiments) avait embarqué la veille à 10 heures du soir, à Pont-Saint-Vincent.
Finalement, notre escadron (le 3e) avait pu être acheminé seulement aujourd'hui 2 septembre à 10 h 15 du matin, après avoir attendu que les 1er et 2e escadrons nous eussent précédés. Les trains ne pouvaient compter que peu de wagons.
Nous avions roulé à faible vitesse, à destination de Bar-le-Duc, Châlons-sur-Marne, Epernay, Château-Thierry, nous avaient dit les employés. Au-delà, ils ne savaient plus où nous irions...
Dans le compartiment réservé aux officiers, avaient pris place le capitaine de Langlois, commandant l'escadron, le lieutenant en premier de l'Hermite, le lieutenant Desjobert (assurant chaque jour la liaison entre le 20e dragons et l'état-major de la 10e D.C.), le sous-lieutenant Gougis et moi-même.
Les suppositions faisaient l'objet principal de notre conversation. Nous ne savions rien de la situation générale. Nous avions, en Lorraine, été coupés de tous renseignements. Que se passait-il sur le reste du front, en particulier dans le Nord ? Les communiqués officiels du G.Q.G. étaient étrangement avares. Ils parlaient seulement de violents et très durs combats sur les frontières de Belgique et du Nord-Est. Nous en avions déduit que le front de bataille devait se situer quelque part entre Maubeuge, Mézières et Luxembourg.
Selon le capitaine de Langlois, si Joffre avait créé un second corps de cavalerie pour l'enlever aussitôt de la droite du corps de bataille pour le virer à la gauche, à la faveur d'un secret hermétique, c'était qu'il nourrissait un grand dessein. La preuve en était qu'on nous faisait roquer loin en arrière du front, par voie ferrée. Par voie ferrée, cela signifiait qu'il était urgent de nous transporter vite et loin. Sans doute s'agissait-il de nous jeter par surprise dans le dos de l'ennemi par un vaste arc de cercle. Nous allions alors passer par le nord, Dieu savait où, par la Belgique, peut-être jusque par Maastricht, pour nous rabattre ensuite par Aix-la-Chapelle, et même plus loin par Cologne, sur les derrières de l'ennemi, le couper de ses bases, de ses lignes de communications et y jeter le désordre.
- Bien joué ! nous étions-nous écriés.
Nous n'avions pas douté un instant que le capitaine de Langlois n'eût raison. C'était l'évidence même ! Nous étions partis pour une magnifique aventure ! Trois divisions de cavalerie, cela faisait tout de même du monde ! Si nous pouvions faire irruption dans le dos de l'ennemi, quelle pagaille ! La cavalerie allait jouer un grand rôle comme jadis sous Napoléon. Pourquoi n'irions-nous pas écrire de nouveaux Austerlitz et de nouveaux Iéna ! Cette perspective nous avait portés au comble de l'excitation. Nous étions parés moralement et physiquement à accomplir de formidables chevauchées !
Mais que faisait ce train ? En fait de vitesse, il n'avançait pas ! Il se traînait ! Déjà, le soir tombait et nous venions à peine d'atteindre la Meuse. Si notre allure avait été normale au début, elle était devenue très faible maintenant et d'incompréhensible manière. Le train faisait du sur place, s'arrêtait parfois en pleins champs. La locomotive sifflait, réclamant la voie libre. Partout s'éternisaient des feux rouges.
Et puis soudain, une inquiétude :
Que signifiaient ces mouvements insolites qu'on voyait sur les routes ? Ces voitures, ces charrettes, surchargées de bagages, accompagnées de civils âgés, de femmes, d'enfants marchant à pied, encombrant les chemins ? Ces convois venaient tous de la même direction. Ils descendaient du nord. Ils offraient l'aspect de colonnes de réfugiés fuyant l'invasion. Nous avions déjà vu ça en Lorraine, au moment de l'abandon de Blâmont, de Lunéville et de la forêt de Mondon.
Il en avait fallu davantage pour éteindre notre optimisme jusqu'au moment où le train s'était arrêté à un petit passage à niveau, en pleine campagne. Des réfugiés campaient au bord du chemin, faisant du feu. Nous les avions interrogés. Ils venaient des environs de Rethel.
- Rethel ! Mais quoi ? C'est tout près ! Les Allemands ne sont quand même pas à Rethel !
- Que si qu'ils y sont ! Ils marchaient sur Reims ! - Mais l'armée ? On se bat ? Où se bat-on ?
- On ne sait pas. On n'a rien vu. Le maire est venu nous dire de partir. On sait pas où sont les Français. Les Allemands arrivent de partout. Ils brûlent tout dans le Nord.
Le train était reparti. Il faisait grand-nuit maintenant.
Nous nous étions rassis sur la banquette, sombres mais pas encore consternés. Ainsi, les Allemands avaient traversé la Meuse ! Mais par où ? Qui les avait laissés passer ? Mais avec nous ça allait changer ! Notre grand mouvement tournant allait tout remettre en question...
A Châlons-sur-Marne, arrêt ! Sur le quai, une foule de civils s'entassait, dans le vacarme. Enfin un uniforme ! Un commandant à képi à bandeau blanc. Un commissaire de gare.
- Monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Nous arrivons de Lorraine. On ne sait rien.
Il avait eu un geste désabusé :
- Ça ne va pas bien. C'est la retraite. Les nôtres ont déjà passé. Ils sont plus au sud, plus bas que Vitry, que Saint-Dizier. Les Allemands, dit-on, approcheraient de Reims. On ne cherche pas à les arrêter. Je n'en sais pas plus long.
- Mais nous ? Où allons-nous ? Geste d'ignorance :
- Je ne sais pas... Je ne sais même pas si vous pourrez passer plus loin ? Je crois qu'on va vous débarquer à Epernay. L'ennemi descend vers la Marne.
Une fois encore le train était reparti.
Cette fois, nous avions été atterrés. Dans notre compartiment obscur, dont un employé, en gare de Châlons, avait tout de même allumé le plafonnier à bec Auer, nous n'avions pas osé nous regarder. Nous avions été assommés par la terrible révélation : l'invasion déferlait au cœur de la France !
Alors c'était pire que 70 ! Le grand rêve était fini. Finie, la magnifique manœuvre par le Nord, par Maastricht ! Tout s'écroulait... - Moi, je crois qu'on ira plus loin qu'Epernay, avait dit Desjobert. On passera ! On continuera je ne sais pas par où, mais on continuera ! Peut-être par Paris, par Beauvais et plus loin sur la droite de l'ennemi. Il ne peut tout de même pas être partout ! Il y a bien un bout ! On le tournera ! On est fait pour ça !
- Dieu vous entende ! avait conclu le capitaine de Langlois. Dieu ne nous avait pas entendus. Il avait pour nous d'autres desseins. A Epernay, nous avions reçu le coup d'assommoir final :
- Tout le monde en bas ! On débarque ! - Quoi ? ... On débarque ?
- Et en vitesse ! Il y a d'autres trains derrière vous.
La gare était noire de monde. La population éperdue, en proie à la panique, prenait d'assaut un train à destination de Troyes. Ce serait le dernier vers le sud. Des femmes pleuraient, criaient.
Mettant le comble au désordre, un train de blessés était arrivé de Reims. On avait débarqué un grand nombre de malheureux fantassins blessés, certains aux uniformes couverts de sang. Attendant de les transporter on ne savait où (l'hôpital d'Epernay était déjà plein), on les déposait à même le ciment du quai, ou sur un peu de paille. Agenouillées parmi eux, des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul s'empressaient, leur donnaient à boire. Leurs cornettes, aux grandes ailes blanches, palpitant aux courants d'air, faisaient invinciblement songer aux terribles tableaux de 1870. Vision de défaite.
- Allez en vitesse ! Débarquez !
- Mais c'est impossible ! Les wagons de chevaux ne sont même pas en gare, ils sont en queue sur le ballast. On n'a rien pour débarquer. Et on n'y voit rien, on est dans le noir ! Où sont les rampes ?
Le capitaine, commissaire de gare, à képi à bandeau blanc, s'était affolé :
- Des rampes, où voulez-vous que j'en prenne ? Allez, débarquez, je vous dis ! Débrouillez-vous ! Faites sauter les chevaux ! D'autres l'ont fait avant vous ! Vous avez deux trains derrière vous ! Allez, en bas ! C'est la guerre !
La jument Pâquerette.
Il avait fallu obéir. Les chevaux avaient dû sauter en contrebas, à la lumière de rares réverbères et des lampes d'écurie. Beaucoup s'y refusaient, se cabraient. Il fallait que deux hommes se tenant par la main au-dessous de leur croupes les obligeassent à sortir du wagon.
C'était à cet instant que s'était passé dans mon peloton un triste accident : la jument Pâquerette, une excellente bête, douce comme un agneau, s'était fracturé une jambe de devant, prise entre deux rondins. Le canon était ballant, brisé en deux. Il n'y avait rien à faire, la pauvre bête était perdue. Il allait falloir l'abattre sur place.
Comme par hasard, cela arrivait au cavalier de 1re classe Sermadiras, un des meilleurs du peloton, celui qui peut-être aimait le mieux son cheval. Il adorait sa Pâquerette, la soignait comme ses yeux, ne la quittait pas, trouvait le moyen de la faire boire même lorsqu'il n'y avait pas d'eau, allant lui en chercher au loin dans son seau de toile. Il couchait toujours derrière elle, lui parlait, la caressait. C'était ce qu'il aimait le plus au monde.
Le maréchal des logis Souquet était venu me chercher pour me faire constater le désastre :
- Venez voir, mon lieutenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le cavalier Sermadiras le suivait, en larmes.
J'avais vu. C'était irrémédiable.
- Souquet, emmenez Pâquerette un peu à l'écart. Il faut l'abattre. Prenez deux hommes avec des carabines et qu'ils tirent à bout portant derrière l'oreille. Elle ne souffrira pas. Contre un mur. Prenez garde aux accidents ! Attention aux balles !
Sermadiras avait éclaté en sanglots.
- Non, mon lieutenant ! C'est pas vrai ! J'aime mieux être tué moi-même !
- Allons, Sermadiras, ne dis pas de bêtises ! Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire. On ne peut emmener ta pauvre Pâquerette. Elle souffre beaucoup d'ailleurs, il faut arrêter ça ! Dis-toi qu'elle meurt au champ d'honneur. Ce ne sera pas la seule ! Un peu plus tôt, un peu plus tard, tu sais... Nous aurons peut-être tous notre tour. Allons, du courage !
Le cavalier Sermadiras étouffait ses sanglots dans son mouchoir. - Oui, mon lieutenant... mon lieutenant...
Il y a des moments où il est très dur d'être le chef, de savoir que faire et décider.
Une inspiration m'était venue :
- Ecoute, Sermadiras, tu ne nous quitteras pas. Tu ne retourneras pas au dépôt, parce que tu es démonté. Prends ta selle, ton paquetage, ton harnachement. Tu auras désormais comme monture ma seconde monture à moi, la jument Baronne. Je te la donne.
La jument Baronne était une excellente jument de pur sang que j'avais entraînée en courses et avec laquelle j'avais gagné un military, au mois de mai dernier à Lyon. Ma première monture, nommée Ma-Zaza me suffirait (Au début de la guerre il avait été décidé que - de même qu'aux grandes manœuvres - l'officier chef de peloton emmènerait une seconde monture, afin de ne jamais risquer d'être démonté. Cette seconde monture serait tenue en main par un cavalier du peloton, sans selle ni paquetage, c'est-à-dire nue, à la disposition permanente de l'officier. Cette pratique avait dû être assez rapidement abandonnée par suite des pertes en chevaux et des difficultés d'en maintenir l'effectif. Elle ne l'était pas encore lorsque j'avais offert ma seconde monture, la jument Baronne, au cavalier Sermadiras, pour le consoler de la mort de Pâquerette.) . Elle était également une magnifique jument bai-brun, de pur sang, très grande et très solide, avec laquelle j'avais été sélectionné pour représenter la 10e division de cavalerie au fameux raid international Bruxelles-Louvain qui devait se courir au mois d'août ( 1914) et au cours duquel j'aurais eu à me mesurer avec des officiers de cavalerie britanniques, russes, italiens, belges et... allemands.
Bruxelles-Louvain, quel symbole cela allait devenir !
Détail pittoresque, en prévision de ce raid et des courses du Dorat, où je devais la monter le dimanche 2 août, j'avais fait ferrer Ma-Zaza par le maître maréchal-ferrant du régiment avec des fers anglais ultra-légers, d'alliage spécial.
Le jour de la mobilisation le maître maréchal avait voulu déferrer Ma-Zaza et la referrer avec des fers ordinaires réglementaires. Je l'en avais empêché. Inspiration heureuse. Après le premier mois de campagne en Lorraine, alors que tous les chevaux de mon peloton et peut-être du régiment - avaient déjà dû être referrés, Ma-Zaza avait toujours ses fers en très bon état. Elle allait faire encore avec eux toute la bataille de la Marne et au-delà.
- Va demander Baronne de ma part à Durousseau, avais-je dit au cavalier Sermadiras. Tu la selleras avec la selle de Pâquerette et tu reprendras ta place dans l'escouade du brigadier Viacroze.
Ainsi avait été fait.
Me séparer de Baronne, la faire rentrer dans le rang était un sacrifice. Mais j'aimais mes hommes. A l'énoncé du nom de Baronne, à l'idée de recevoir la jument de l'officier, les yeux du cavalier Sermadiras avaient brillé à travers ses larmes. C'était ma récompense.
Ce douloureux accident avait éloigné ma pensée de la situation générale. Elle y revenait à présent. Mes souvenirs de Lorraine, les heures que nous venions de vivre, l'appréhension mêlée d'espoir de celles qui nous attendaient, m'avaient tenu éveillé. Plusieurs fois je m'étais relevé et avais fait les cent pas. J'avais rencontré de l'Hermite. Il m'avait invité à venir partager avec le capitaine de Langlois, Desjobert, Gougis et lui une voiture de déménagements, vide et abandonnée, qu'ils avaient découverte dans une rue adjacente :
- Mon vieux, ce n'est pas une offre de riches que je te fais, mais de clochards, on y pèle de froid ! Tu vois, je ne peux plus y tenir ! J'avais décliné l'invitation :
- Merci, j'aime mieux me réchauffer aux rayons de la lune, le dos contre mon mur !
J'avais repris ma place, entre Vialle et Souquet, les jambes allongées sur le trottoir. Non sans avoir fait un tour dans le jardin public derrière nos chevaux, où veillait un nouveau garde d'écurie. Le cavalier Sermadiras et mon ordonnance Durousseau dormaient côte à côte, assis sur un banc du jardin, derrière les juments Baronne et Ma-Zaza. Sermadiras avait recouvré son calme. Son sommeil était paisible.
MISSION : COUVRIR LA RETRAITE DE LA MARNE
3 septembre, 8 h du matin.
Aussi invraisemblable que cela soit, nous sommes toujours au même endroit, sans ordres. Tout à l'heure, vers 6 heures, la canonnade s'était réveillée. Elle s'était assoupie, puis tue durant la nuit. Au bruit, elle paraît provenir de la même distance qu'hier au soir, mais plus à gauche, c'est-à-dire plus au sud.
Sans doute vers Château-Thierry, apprécie le capitaine de Langlois. On doit chercher à empêcher les Allemands de traverser la Marne ?
Mais comment savoir, aucun de nous n'a de carte de la région. Evidemment les lots de mobilisation, s'ils avaient été riches en cartes des frontières, des territoires limitrophes et d'Allemagne jusqu'au Rhin, n'en comportaient aucune de la Marne et des environs de Paris. Comment supposer, à moins d'être défaitiste (abominable mentalité si honnie par l'armée) que les opérations pourraient se dérouler ici, au cœur de la France !
De l'Hermite, avisant un homme âgé (un des rares habitants restés chez eux) en train d'ouvrir au rez-de-chaussée ses volets, l'avait interpellé :
- Hé, dites-moi, monsieur, on est bien ici dans le département de la Marne ?
- Naturellement, Epernay c'est dans la Marne. Vous ne le saviez pas, non ?
- Si, bien sûr. Alors, vous devez avoir un almanach, un calendrier des postes ?
- J'ai celui du département.
- C'est celui qui m'intéresse. Pourriez-vous me permettre de le consulter ?
Le vieillard était rentré dans sa demeure, puis en était ressorti, le calendrier à la main. L'Hermite s'était penché avidement.
- Vous permettez, monsieur ?
Mais sans attendre de réponse, il avait arraché la dernière page ; elle portait, comme tout calendrier des P.T.T., la carte sommaire du département, puis il avait rendu le calendrier à son propriétaire, éberlué mais souriant.
- Merci, monsieur, vous rendez un grand service à l'armée ! Que Dieu vous garde !
- Une idée de génie, L'Hermite ! avait apprécié le capitaine de Langlois.
De génie en effet, il suffisait d'y penser ! Ce serait avec cette carte rudimentaire, mais très précieuse, que nous allions faire la première partie de la bataille de la Marne. Ce serait mieux que rien.
Mais voici que survient le lieutenant Desjobert. Il arrive de liaison auprès de l'état-major de la 10e division.
- On va monter à cheval, annonce-t-il. La mission du corps de cavalerie est de couvrir la retraite, de ralentir à tout prix l'ennemi, l'armée en retraite est déjà à trente kilomètres plus au sud. Les hommes n'en peuvent plus. Il va falloir tenir et arrêter l'ennemi sur les coupures de terrain principales, le plus longtemps possible.
- Alors où ? Sur la Marne ?
- Pensez-vous ! Les Allemands ont pris Château-Thierry hier au soir, ils sont en train de passer la Marne. On n'a pas eu le temps de faire sauter les ponts. La voie ferrée de Paris est coupée. Plus question de grand mouvement tournant. Couvrir la retraite, se sacrifier si nécessaire, c'est tout.
Desjobert a un sourire triste et désabusé.
- Mais où ? Où va-t-on ? insiste le capitaine.
- On va suivre le colonel, il a des instructions. On lui a donné une carte Michelin. Il sait où l'on va. J'ai entendu parler d'un patelin qui s'appelle Orbais.
- Mais le général, le général Conneau, où est-il ?
- Il a couché ici, cette nuit. Tenez, voilà son escorte !
De l'autre côté du jardin public, passe à cheval un pittoresque détachement, de la valeur d'un demi-régiment. Ce sont des spahis marocains, culottes kaki, le chèche sable serré en turban sur le front, burnous roulés sur les troussequins, d'une hauteur démesurée.
Nos dragons debout s'empressent à les regarder défiler. Grand succès de curiosité. Ils n'en ont jamais vu. Les Marocains rient de toutes leurs dents blanches, dans leurs faces brûlées de soleil, fiers de l'intérêt qu'ils suscitent. Ils montent très court, genou plié, le sabre courbe (Celui de la cavalerie légère, dit officiellement bancal. Seuls, les spahis le portent ainsi sous la cuisse, sous le quartier gauche de la selle côté montoir. Les hussards et les chasseurs le portent, fixé par deux bélières, côté aussi montoir, comme la latte droite de la cavalerie de ligne, dragons et cuirassiers.) à plat sous la cuisse.
Pour une escorte de général c'est assez pagailleux. Je note au passage, liées sur des sacoches, des volailles mortes, emplumées, sur d'autres un lapin, un moulin à café et, pendue à une poche à fers
, une lèchefrite. Beaucoup de chevaux sont gris, ce qui est assez peu indiqué pour faire campagne.
En tête, marche en guise d'étendard, tenue par un cavalier au sommet d'une hampe, une queue de cheval noire surmontée d'un croissant.
Ce désordre dans la tenue fait contraste avec celle de nos dragons (en particulier de ceux de mon peloton) propres, astiqués, remis à. neuf.
Mais où est le général ? Toujours pas de général Conneau. Le bruit, court qu'il serait en voiture.
- Evidemment. Sacré grand chef, il a droit maintenant à une auto.
- D'autant plus qu'il en a vraiment besoin pour ses liaisons avec le G.Q.G. et les armées voisines.
- C'est égal, pour la première fois que son corps de cavalerie est rassemblé, il pourrait bien marcher avec nous et à cheval ! murmuré-je. Au moins on le verrait !
- Allons, Chambe, ne faites pas le mauvais esprit ! Ce n'est pas votre genre ! sourit le capitaine de Langlois.
Mais je vois bien qu'il est de mon avis.
A 8 h 30 retentit enfin, répété par les trompettes, le commandement A cheval ! tant attendu ! Puis, Derrière moi, par quatre !... Marche !
Nous rompons, 10e division en tête. Derrière nous, l'immense forêt des lances s'est animée et mise en branle. Les grandes unités se sépareront aux prochains carrefours importants. Elles n'ont pas toutes la même destination, paraît-il.
Il fait un temps superbe. Nous nous dirigeons vers le sud-ouest, à en croire le soleil et la petite boussole qui ne me quitte pas. Sur une borne kilométrique nous lisons : " Orbais, 24 kilomètres ! " Orbais est marqué sur la carte de l'Hermite. Le colonel sait où il va, nous a-t-on dit. Il est muni d'une carte Michelin. On le voit la consulter souvent en la déployant sur le pommeau de sa selle.
- Mince de riche ! gouaille l'Hermite.
- Jaloux ! lui lance en riant le capitaine de Langlois.
II fait déjà très chaud. Nous accomplissons l'étape à raison de deux kilomètres au trot, un kilomètre au pas. Comme aux grandes manœuvres. Les pieds de nos chevaux soulèvent un nuage de poussière blanche incroyable (En ce temps-là, les routes ne sont pas goudronnées. Aucune. Même pas les nationales. Le goudron et l'enrobé ne sont pas encore inventés. C'est d'une grande importance sur le plan militaire car par temps sec. comme aujourd'hui, le moindre mouvement de troupe est décelé par la poussière qu'il soulève. Ainsi de l'arrivée de Blücher à Waterloo, fiévreusement scrutée par Napoléon croyant à celle de Grouchy.) . Cela fait un peu image d'Epinal, avec nos casques, nos lances et nos culottes rouges.
Cependant une violente canonnade roule derrière la chaîne de collines, à notre droite. Nous l'estimons à quinze ou vingt kilomètres. Cela serre le cœur. Que se passe-t-il là-bas ? Les nôtres sont peut-être en difficulté et nous ici nous sommes bien tranquilles, comme indifférents. Cette canonnade ne nous concerne pas.
Où est le règlement de jadis faisant obligation à un chef, où qu'il se trouvât et quelles que fussent les circonstances, de marcher au canon. Priorité absolue : marcher au canon ! Certes, c'était un peu simpliste et souvent une erreur. Abandonner la mission originelle reçue, pour courir sur un autre point de la ligne de bataille pouvait avoir de graves conséquences. Cette obligation était aujourd'hui périmée et à juste raison supprimée, sauf cas extrême. Mais cela justifiait-il notre inaction présente ?
Vers 1 heure, la canonnade est devenue intermittente, on sent qu'elle va s'éteindre. Quelle en a été l'issue ? Ah ! savoir, savoir ! Nous continuons de suivre la route et traversons successivement de grosses agglomérations, Ablois, Mareuil-en-Brie. Notre marche est coupée d'arrêts parfois prolongés, dont l'un pour faire boire les chevaux et donner l'avoine. L'intendance, au cours de la nuit, à Epernay, a réussi à assurer le ravitaillement des hommes et des bêtes. C'est une performance.
Le soir tombe. Nous avons depuis longtemps atteint et dépassé Orbais. Sur une borne je lis : Montmirail 10 kilomètres. Montmirail !
A cent ans d'intervalle la campagne de France va-t-elle recommencer ? Que Dieu nous garde de son dénouement !
Mais soudain, sur un ordre du colonel Gailhard-Bournazel, on abandonne la route et on avance à travers champs en colonne de pelotons, c'est-à-dire chaque peloton en bataille sur deux rangs, l'officier en tête, au pas. Va-t-on au combat ? Notre mission n'est-elle pas de nous interposer entre l'ennemi qui avance et nos armées en retraite ? Or, nous ne faisons rien ! Nous ne servons à rien ! Voici une nuit et une journée entières perdues depuis que nous avons débarqué. Nous sommes toujours dans une inaction totale. N'est-il pas écrit en tête de notre règlement de cavalerie qu'un chef peut commettre une erreur, n'avoir pas su apprécier une situation, avoir pris une décision maladroite, mais que seule l'inaction est infamante. Je me rappelle très bien cette phrase impérative, elle m'a toujours frappé et ne m'a jamais quitté. Je l'ai toujours présente à l'esprit. Elle est magnifique.
Alors ne sommes-nous pas nous-mêmes, en ce moment, en situation d'infamie ?
Allons, ne critiquons pas toujours ! Nous ne connaissons ni la situation générale, ni les ordres. Les deux autres divisions sont peut-être engagées, ou sur le point de l'être, à un autre endroit et le général Conneau est sans doute avec elles ? Nous manœuvrons par échelon et la 10e division doit être réserve à cheval ? Ce sera notre tour demain d'être déployés en rideau, au combat à pied. Nous agirons alors (C'est bien ainsi que les choses se sont passées. C'est la 8e division de cavalerie (général Baratier) qui, sur l'ordre du général Conneau, combat à Château-Thierry et retarde l'ennemi.) .
Notre colonne, toujours au pas, contourne un village. J'en demande le nom aux habitants accourus ? Ils sont dans l'angoisse. - Ici, c'est Corrobert. Alors les Allemands arrivent, dites ? - Je ne sais pas. On vient pour tâcher de les arrêter !
- Les nôtres sont passés ici depuis hier. Ils n'en peuvent plus. Ils jetaient leurs sacs !
C'est vrai. Que de sacs avons-nous vus abandonnés dans les fossés des routes et maintenant épars dans les champs !
- Mais ni fusils, ni cartouchières. C'est l'essentiel ! Ce sont toujours des combattants, fait remarquer le capitaine de Langlois. - Pied à terre ! Les capitaines au colonel !
L'ordre est transmis de la tête à la queue de la colonne.
On arrive, paraît-il, dans la zone de stationnement prévue pour y passer la nuit. Le 20e dragons doit cantonner au village de Fontenelle, sur la route de Château-Thierry à Montmirail. Le lieutenant de Montmorin y est envoyé en reconnaissance, pour voir si le régiment peut y tenir en entier. Sinon, on bivouaquera en grand-garde ici, dans les champs. Il fait un temps toujours superbe. La lune monte déjà sur l'horizon.
Le colonel a appelé Montmorin. Il lui montre sur sa carte le village de Fontenelle :
- Voyez, c'est à deux kilomètres, là, droit devant vous, de l'autre côté de cette forêt. Il faut contourner la pointe de la forêt, contre cet autre village qu'on voit d'ici. C'est Artonges. Il y a depuis Artonges un chemin très facile jusqu'à Fontenelle. Les habitants vous diront. On ne bouge pas d'ici. On vous attend.
Le 20e dragons ne cantonnera pas à Fontenelle. C'est bien simple, les Allemands viennent d'y arriver. La reconnaissance Montmorin, sans défiance, a été accueillie par une volée de balles, tirées de loin heureusement. Aucune perte !
Nous avons entendu la fusillade, très inquiets jusqu'au retour de la reconnaissance. Le lieutenant Calixte de Montmorin Saint-Hérem est l'un des plus brillants officiers du régiment. Il est simple, sans façons, toujours de bonne humeur et apprécié de tous. Pour moi, c'est peut-être mon meilleur ami. Nous ne sommes pas du même escadron, lui du 1er, moi du 3e, mais c'est sans importance. Nous avons vite compris que nous étions du même bois, que nous avions la même façon de penser, de juger et le même idéal.
Il est marié, sa femme est charmante, très douce et très blonde, ils ont deux jeunes enfants. Leur foyer m'a accueilli comme si j'étais de la famille. Au cours des dix mois qui viennent de s'écouler (j'ai été affecté au 20e dragons le 1er octobre 1913), que de fois j'ai été convié à dîner ou déjeuner chez eux, seul, sans protocole, en frère !
Le jour de la mobilisation, faisant les dernières emplettes dans les magasins (tous ouverts bien que ce fût un dimanche) Gougis et moi, nous avions rencontré Mme de Montmorin, occupée à faire aussi pour son mari les suprêmes achats. En nous voyant, elle avait voulu sourire mais ses yeux s'étaient emplis de larmes. Elle n'avait pas cherché à les cacher.
En nous quittant, elle m'avait longuement serré la main. Je n'avais pas oublié ses paroles :
- Cher Chambe, je suis heureuse de vous avoir revu avant le départ. Je prierai tous les soirs la Sainte Vierge pour vous ! Pendant toute la guerre ! Ne faites pas de folies ! Au revoir !
C'est alors que j'avais mesuré tout ce qu'il y avait peut-être d'inhumain, d'égoïste dans la joie qui me gonflait le cœur et que je cherchais à ne pas montrer. Cette heure que j'avais tant souhaitée combien d'autres l'avaient redoutée ! J'étais seul en cause, moi, et la guerre j'étais fait pour ça ! J'étais très jeune et j'avais le plus beau grade de l'armée française, sous-lieutenant !
Or, voilà que ce soir Montmorin avait failli être tué... Cela m'avait porté à réfléchir. Je revoyais en pensée ce 2 août (il y avait un mois de cela), le pauvre sourire de Mme de Montmorin, son visage inondé de larmes.
Et cela ne faisait que commencer. Ce n'était qu'un début. Combien de temps allait durer cette guerre ?... Combien pourraient se flatter d'en revenir ?
PAGES DE MON CARNET DE GUERRE REPRISE DE L'OFFENSIVE
J'ai conservé mon carnet de guerre. Chaque soir j'en écrivais plusieurs pages. Il arrivait à Montmorin d'y ajouter parfois quelques lignes. Il m'est aujourd'hui très précieux pour écrire ce livre, par ses précisions de noms, de lieux et de dates, la relation des faits écrite sur l'heure avec son atmosphère.
J'y retrouve qu'à la suite de cette alerte de Fontenelle, il y a au 20e dragons un instant de flottement, d'incertitude sur la conduite à tenir. L'ennemi est là, tout près, à deux kilomètres. On ne l'a donc pas contenu depuis le franchissement de la Marne. On lui a laissé le champ libre. C'est cette canonnade que nous avons entendue et qui s'est arrêtée vers 1 heure de l'après-midi. Les nôtres avaient cessé de résister.
L'ennemi va-t-il pousser plus avant durant cette nuit ? Ou stationner, lui aussi ? Desjobert revient de liaison auprès de la division, avec des instructions. Enfin ! Et ces instructions sont, pour une fois, écrites.
Ordre de se replier sur Montmirail et d'y bivouaquer dans les rues pendant trois à quatre heures, au maximum, à l'abri d'un réseau de vedettes. On fera manger les chevaux et les hommes puis on: repartira avant le jour. On franchira le Petit Morin, sans détruire les ponts. On repassera sur la rive droite à Verdelot, face à Vieils-Maisons. La mission de la 10e division est de contenir à tout prix l'ennemi au combat à pied sur la ligne Vauchamps (autre nom de victoire en 1814), Montmirail, Vieils-Maisons. La 4e division sera déployée à notre gauche, au combat à pied. La 8e en réserve à cheval ,
dans la boucle du Petit Morin, rive gauche, prête à passer rive droite.
Enfin, un ordre clair ! Mais celui de la brigade ?
En fait d'ordres de détail nous restons plusieurs heures, pied à terre dans les chaumes, sans savoir que faire ? Allons-nous rester là jusqu'au jour, en paquet ? Quelle belle cible pour l'artillerie ennemie !
Enfin une vedette à cheval vient porter un papier de la 10e brigade de dragons au colonel. Nous remontons à cheval. Il paraît que nous allons pour quelques heures à Montmirail, car tout le régiment doit traverser le Petit Morin.
Il est 10 h du soir lorsque nous y arrivons. La lune est déjà au sommet du ciel. Je suis si fatigué, n'ayant pas fermé l'œil depuis le départ de Nancy, que je me surprends à dormir en selle, bercé par l'allure souple de Ma-Zaza. C'est incroyable, je dors même au trot enlevé. Je ne suis pas le seul.
Montmirail est encombré d'une foule apeurée d'hommes, de femmes et d'enfants portant ou charriant dès bagages, comme à Epernay. Poussant une véritable clameur, ils se hâtent de quitter la ville. Parmi eux, hélas, de très nombreux soldats français, à l'uniforme dépenaillé. Ce sont des traînards, des éclopés, des égarés, fantassins, cavaliers démontés, artilleurs sans canons, la plupart entassés dans de nombreux fourgons militaires, de voitures d'ambulance à croix rouge, aux équipages épuisés, de quelques camions automobiles réquisitionnés. D'autres soldats, faute d'y avoir trouvé place, vont à pied
, accrochés à la carrosserie de tous ces véhicules disparates. D'autres encore marchent en tenant à la main des bicyclettes ramassées ou volées au cours de la retraite. Il leur est impossible de les utiliser, tant la foule est compacte. Augmentant le désordre, des groupes d'animaux, que leurs propriétaires s'efforcent de soustraire à l'ennemi
, chevaux de labour, vaches, moutons, chèvres et porcs, se bousculent au milieu de coups de fouet, de beuglements, de hennissements, de bêlements, d'aboiements de chiens et de cris d'exhortation.
Toute cette cohue s'engouffre, ou cherche à s'engouffrer, comme dans un entonnoir, dans la seule rue, étroite, tortueuse et à pente très raide, descendant vers l'unique pont qui permet de franchir la rivière au fond de la vallée abrupte : le Petit Morin.
Tout cela au milieu de cris, de vociférations, de bagarres pour chercher à passer avant les autres.
C'est le premier contact que nous prenons avec des éléments d'armées ayant combattu en Belgique et sur la frontière du Nord.
Elles battent en retraite depuis maintenant dix jours. Nous voyons enfin ceux que nous venons protéger.
L'impression est épouvantable. Est-ce donc ce qui reste de notre armée française, si belle en temps de paix ? Les premiers combats ont suffi à la mettre à genoux, à la vaincre, à la détruire ?
Non ! Je sais bien que ce que nous voyons devant nous ne sont que des débris, des détritus, l'écume d'une armée en retraite ! Ça ne compte pas !
J'avise un sous-officier, un sergent d'infanterie mieux tenu que les autres. Il est du 12e de ligne. (Je connais. Garnison Tarbes.) - De quelle armée êtes-vous ? Quelle est cette armée ? Savez-vous ?
- 18e corps. Ve armée. - Quel général ?
- Général Lanrezac, quand j'ai été blessé. A présent, je ne sais plus, il a été relevé de son commandement.
Je suis impressionné. Un général d'armée relevé de son commandement, donc battu ? ... Ça va mal !
Nous mettons pied à terre aux premières maisons de Montmirail, les chevaux à l'anneau italien, tout sellés. Il faut très peu d'hommes pour les garder, les autres restant disponibles, pour les faire boire et manger et enfin penser à eux-mêmes et se reposer. Hommes et bêtes en ont bien besoin. Dans la cavalerie, la chronologie des soins à donner est impérative : - les chevaux - les armes - les hommes.
Le cavalier ne doit penser à lui-même qu'après avoir soigné son cheval et nettoyé ses armes.
L'intendance n'a pas pu suivre.
Ici, je cite textuellement quelques passages de mon carnet de guerre :
Le régiment bivouaque sur une sorte de place, les chevaux attachés à l'anneau italien. A force de recherches on trouve pour eux un peu d'avoine mais pas de foin (De Montmorin. (Encore lui. C'est sur son initiative que se fait le ravitaillement.). Les hommes mangeront le dernier repas froid emporté ce matin. On vient nous chercher. Dans un orphelinat voisin (enfants évacués) les religieuses restant ont tenu à préparer pour les officiers un bouillon, un morceau de pain et de fromage. Pauvres sœurs, elles f ont des prodiges pour nous offrir à manger ! Mais c'est égal, nous touchons à peine à leur repas, le cœur serré.
Des rues monte un bruit sourd. Un roulement continu de voitures qui descendent vers le Petit Morin, pour le traverser avant le jour. C'est une longue rumeur de foule, une cohue en désordre. Et l'ennemi est à Fontenelle, à quatre kilomètres ! ! !
11 h 30. Nous nous jetons abrutis de sommeil sur des lits dans le dortoir de l'orphelinat. Vingt-cinq minutes à dormir. On doit repartir à minuit.
Vendredi 4 septembre. Minuit.
La mère supérieure a pris l'engagement formel de nous réveiller à minuit moins cinq :
- Messieurs les officiers, c'est l'heure !
Est-ce possible ! Il me semble que je viens de fermer les yeux il y a une seconde ! Et il y a vingt-cinq minutes ! J'étais tombé comme une masse. Un sommeil noir... un sommeil de mort...
A la pâle clarté de la lune encore très haut dans le ciel le régiment monte à cheval. Je dors encore dans ma selle. Nous quittons Montmirail.
Le lamentable défilé des retardataires de la Ve armée achève à peine de passer le Petit Morin. Les dernières voitures descendent encore les pentes à travers les rues tortueuses de Montmirail.
Je n'oublierai jamais ce défilé lamentable, sinistre, ce spectacle hallucinant. J'aurai toujours dans l'oreille cette rumeur sourde dans cette vallée étroite, ces cris de disputes au moment de passer le pont. On sent dans l'obscurité que cette colonne interminable, ce troupeau indéfini, s'allonge, s'allonge au loin, reflue vers l'ouest, vers Paris !
... Avons-nous donc été battus ? Ce n'est pas vrai, pas vrai ! ! !
Le jour est enfin venu sur cette tristesse. Nous ne voyons plus le défilé lamentable ! Nous agissons ! après avoir retrouvé la 10e division, la brigade (général Chêne) repasse sur la rive droite du Petit Morin, en face de Vieils-Maisons. Mission : Enrayer la marche de l'ennemi.
Oui, nous allons arrêter l'ennemi, le retarder en bluffant comme à Franconville, en mettant en ligne quelques canons et quelques carabines.
4 septembre. 2 h du matin.
A peine réveillés, nous montons à cheval. Il fait encore grand-nuit. La lune est descendue sensiblement sur l'horizon de l'ouest. Ses faibles rayons éclairent le paysage autour de nous d'une lumière livide, cendreuse, presque irréelle. Je dors en selle, mais les souffles froids de l'aube me rappellent à la réalité. On n'imagine pas combien le manque de sommeil, au cours d'opérations de guerre, peut devenir une véritable souffrance, alors qu'il importe de rester lucide.
Nous franchissons le Petit Morin et passons de la rive droite à la rive gauche sur l'unique pont devenu enfin dégagé et libre. L'écume de la Ve armée a fini de s'écouler aux pâles rayons de la lune et de gravir la pente d'en face de cette vallée très encaissée. Mais on entend encore sa rumeur confuse, le souffle et les plaintes de ses traînards et de ses bêtes, le cahotement de ses innombrables roues ferrées sur les pierres de la route.
Ah ! que ce bruit s'efface vite et disparaisse, qu'il se perde à jamais dans les ténèbres et dans l'oubli ! Que cette page soit arrachée de l'Histoire de France ! Ce n'est qu'un épisode ! Ce n'est pas vrai que nous ayons été battus, pas vrai que l'ennemi soit parvenu jusqu'ici, au cœur de la France ! Les heures que nous venons de vivre depuis ce débarquement si décevant d'Epernay sont trop affreuses, trop injustes pour que nous puissions les accepter ! Ce cauchemar doit être déchiré ! C'est à nous qu'en reviendra l'honneur !
Montmirail, porte tout de même un nom de victoire ! Ici, dans ce décor, il y a cent ans, pendant l'hiver de 1814, Napoléon n'a-t-il pas battu les Allemands et les Russes, écrasés et sabrés au fond de ces ravins ? Nos arrière-grands-oncles n'ont-ils pas chargé à dix kilomètres d'ici, à Champaubert et à Vauchamps, ces autres noms de victoires, à la tête de leurs escadrons du 10e hussards ? Je me souviens d'un récit de ces temps héroïques écrit par un témoin : le tambour de Montmirail. Ne serions-nous pas leurs héritiers, leurs descendants, ne serions-nous pas dignes d'eux ?
La journée va certainement être très dure, mais qu'importe et même tant mieux ! Nous allons les revoir face à face comme nous les avons vus en Lorraine, car nous allons être cette fois en première ligne. Nous ne resterons pas, ainsi qu'hier, inutilisés et passifs. A notre tour de marcher ! Il est pénible de ne rien savoir, de ne rien comprendre, de n'être tenu au courant de rien !
D'abord, comment se fait-il qu'on les ait laissés passer la Marne, alors qu'hier au soir ils n'étaient même pas encore arrivés à Château-Thierry et que nous, nous nous morfondions toute la nuit à Epernay ? La Marne aurait été cependant plus facile à tenir que ce maigre ruisseau ?
Et puis, où sommes-nous maintenant ? La carte de l'agenda de l'Hermite ne peut plus nous servir ! Nous sortons des limites du département de la Marne. Qu'allons-nous faire ? Notre général de brigade n'a pas l'air tellement sûr de lui-même, ni de la décision à prendre, je le vois discuter avec le colonel Gailhart-Bournazel, au coin d'un pont, sa carte Michelin à la main. Car nous repassons le Petit Morin. Nous revenons sur la rive droite. La rivière faisait en effet un coude, une boucle. Ce village que nous traversons s'appelle, paraît-il, Verdelot. Et cet autre là-haut, en face sur la colline, c'est Vieils-Maisons (nous en avons déjà parlé). L'ennemi, cette nuit, en était déjà tout près, mais il se serait arrêté, fatigué, lui aussi. Allons-nous l'attaquer ? Prendre l'offensive ?
Je vais interrompre ici, momentanément, les pages de mon carnet de guerre et mes souvenirs personnels, comme je le ferai dorénavant souvent au cours de cet ouvrage, afin d'en élargir le sujet et de rappeler, ou apprendre, au lecteur ce que fut la situation générale pendant la bataille de la Marne, la balance des forces en présence, les ordres donnés, les comptes rendus et les renseignements reçus, les décisions prises aux différents échelons, même les plus élevés, toutes choses dont j'étais, bien entendu, dans la plus complète incapacité d'avoir connaissance à ce moment ! Je n'étais qu'un jeune officier, ne commandant qu'un simple peloton de cavalerie, c'est-à-dire l'unité la plus faible de la hiérarchie du commandement, très loin des vues supérieures, mais, par contre, très près de la réalité sur le terrain, à même de la vivre et de la comprendre.
Le témoignage personnel très précis que je vais apporter, une fois placé dans son cadre d'ensemble pour le confronter à la situation générale, va donc permettre de porter un jugement valable sur les opérations de septembre 1914 et de suivre le procès que je compte ouvrir avec ce livre, pour le conduire jusqu'à sa conclusion.
Rappelons tout d'abord, pour éviter toute confusion sur un point d'histoire, les circonstances dans lesquelles prit naissance le corps de cavalerie Conneau. Ce n'est pas le 1er septembre qu'il fut constitué au moment d'être transporté sur un autre théâtre d'opérations, mais dès le 16 août en Lorraine, à la fin de la concentration de la IIe armée du général de Castelnau.
LE CORPS DE CAVALERIE CONNEAU LES FORCES DONT IL DISPOSE
Joffre, pour faire pendant au 1er corps de cavalerie (corps Sordet) à la gauche du dispositif, c'est-à-dire en Belgique, a décidé de créer un second corps de cavalerie, le 2e corps (corps Conneau) appelé, lui, à opérer presque à la droite du dispositif, c'est-à-dire en Lorraine.
Le corps Conneau est alors formé sur place, à l'aide de la 10e division (que commande précisément le général Conneau) de la 2e division de Lunéville et de la 6e division de Lyon, occupées, la première à couvrir la concentration de la IIe armée, la seconde celle de la
1re armée (général Pau, puis Dubail).
Mais cette constitution n'aura été qu'éphémère. Elle n'aura existé que quelques jours sur le papier. Les événements ayant dangereusement tourné dans le Nord, le 1er corps de cavalerie du général Sordet ayant été imprudemment et prématurément dépensé en marches et contremarches aussi épuisantes qu'inconsidérées, s'est révélé incapable, l'heure venue, d'assurer son rôle de protection de nos armées en retraite. C'est pourquoi le généralissime Joffre a décidé de suppléer à cette carence (Dont il est lui-même en partie responsable. II a demandé au corps du général Sordet des efforts tels, qu'ils devaient rapidement entraîner la ruine de ses chevaux. Joffre a droit aux circonstances atténuantes, ayant fait toute sa carrière dans le génie, mais que dire de la responsabilité d'autres officiers généraux issus, eux, de la cavalerie ? Tels les généraux commandant les 1er et 2e corps de cavalerie ? Le sujet en sera traité bientôt dans ce livre.) en amenant en hâte le 2e corps de cavalerie du général Conneau, transporté par voie ferrée, pour l'interposer entre l'aile gauche du dispositif très menacé (Ve armée du général Lanrezac et petite armée anglaise du maréchal French), en retraite précipitée, et les armées allemandes lancées à sa poursuite à marches forcées ( Ire armée von Kluck et IIe armée von Bülow) et bien décidées à l'enrouler (aùfrollen) pour la détruire.
Cependant pour ne pas dégarnir de toute cavalerie les fronts de Lorraine et d'Alsace, le corps Conneau va être transformé le 1er septembre (par ordre général n° 3 193 du G.Q.G.). Il abandonnera et laissera sur place les 2e et 6e divisions et n'emmènera de Lorraine que sa chère et vieille division, la 10e, renforcée toutefois de la brigade de légère ( 17e et 18e chasseurs du général de Contades) enlevée à la 2e division de Lunéville.
La 10e division passe donc de quatre à six régiments. Elle sera rejointe sur le nouveau théâtre d'opérations par les 4e et 8e divisions, prélevées en hâte, comme elle, sur d'autres secteurs du front de bataille.
La 4e division de cavalerie, du général Abonneau se trouve pratiquement sur place, ou à peu près. A la mobilisation, son rôle consistait à se déployer en couverture sur la frontière du Nord, pour couvrir la gauche de la 4e division d'infanterie, constituant elle-même l'extrême aile gauche du corps de bataille dans la région de Montmédy, puis éventuellement de Carignan. Par suite de la tournure prise par les événements, le G.Q.G. a mis cette 4e division de cavalerie aux ordres de la Ve armée, avec mission de la flanc-garder à gauche. Mission qu'elle a remplie jusqu'au 1er septembre. Puis elle est venue à Epernay, le 2 septembre, se mettre aux ordres du général Conneau et faire partie de son corps de cavalerie, suivant les instructions reçues par télégramme.
La 8e division vient de plus loin. Elle arrive d'Alsace, par voie ferrée, comme la 10e. Son chef est le général Baratier. A la mobilisation, elle était déployée le long des Vosges, pour le compte de la 1re Armée, couvrant le 7e corps-frontière et prête à entreprendre avec lui une action offensive en direction de Colmar. Cette action n'aura jamais lieu.
La 8e division de cavalerie a débarqué, comme la 10e en gare d'Epernay, dans la soirée et la nuit du 2 septembre.
Le corps de cavalerie est désormais constitué ; il comprend trois divisions, les 4e et 10e, à six régiments chacune et la 8e, à quatre régiments.
Total, seize régiments à cheval.
Dressons une fois pour toutes le tableau de composition du corps Conneau. On pourra s'y référer et mieux suivre avec son aide le déroulement des opérations.
CORPS DE CAVALERIE CONNEAU
GÉNÉRAL CONNEAU, CHEF D'ÉTAT-MAJOR : LIEUTENANT-COLONEL MAISSIAT
|
4e division de cavalerie : général Abonneau chef d'état-major : commandant Audiat-Thiry |
4e BRIGADE LÉGÈRE (général Réquichot) : 2e hussards et 4e hussards 4e BRIGADE DE DRAGONS (général Dodelier) : 28e dragons et 30e dragons 3e BRIGADE DE CUIRASSIERS (général Monpoly) : 3e cuirassiers et 6e cuirassiers Chasseurs cyclistes : 19e B.C.P. (1 groupe cycliste) Artillerie : 40e R.A.C. (1 groupe de 75) Génie : 9e régiment (sapeurs cyclistes 1 groupe) |
|
8e division de cavalerie : général Baratier |
8e BRIGADE LÉGÈRE (colonel Peillard) : 12e hussards et 14e chasseurs 8e BRIGADE DE DRAGONS (général Gendron, puis le 8 septembre 1914 colonel Guéneau de Montbeillard) : 10e dragons et 18e dragons Chasseurs cyclistes : 15e B.C.P. (1 groupe cycliste) Artillerie : 4e R.A.C. (1 groupe de 75) Génie : 9e régiment (sapeurs cyclistes 1 groupe) |
|
10e division de cavalerie : général Grellet puis à partir du 13 septembre général de Contades |
2e BRIGADE LÉGÈRE (général de Contades) : 17e chasseurs et 18e chasseurs 10e BRIGADE DE DRAGONS (général Chêne) : 15e dragons et 20e dragons 15e BRIGADE DE DRAGONS (général Sauzey) : 10e dragons et 19e dragons
Chasseurs cyclistes : 1er B.C.P. (1 groupe cycliste) Artillerie : 14e R.A.C. (1 groupe de 75) Génie : 9e régiment (sapeurs cyclistes 1 groupe) |
|
Soutien d'infanterie
Aviation |
45e régiment avec S.T.P. automobiles (provenant de la 8e Brigade d'Infanterie du général Mangin, dissoute le 1er septembre 1914)
1escadrille à 6 avions et 1 parc |
COMBATS SUR LES DEUX MORIN
Je reprends ici le texte et les citations de mon carnet de guerre. Notre brigade (10e brigade de dragons (15e et 20e dragons) général Chêne.) est enfin déployée au combat à pied. Mission : enrayer l'avance de l'ennemi par le combat à pied, c'est-à-dire au moyen de nos armes de feux :
Notre escadron (3e) est disposé face au nord-est, près d'un taillis isolé dans de grands chaumes, Mon peloton est réserve à cheval de l'escadron, derrière la lisière de ce taillis, prêt à charger. Les hommes des trois autres pelotons sont dissimulés, accroupis sous les branches, carabine en main. Le capitaine de Langlois en a le commandement.
En avant de nous, les premiers coups de feu de la matinée (ceux des grand-gardes) éclatent. Puis, les premiers fantassins ennemis débouchent de-ci de-là, en voltigeurs. Aussitôt accueillis à coups de carabines. Les balles sifflent. Les grand-gardes se replient.
- J'ai commandé " Lance, main ! ".
Les hommes sont un peu pâles. Allons-nous charger ?
Le canon s'est mêlé de la partie. Quelques obus trop longs ronflent au-dessus de nos têtes et vont éclater avec un bruit sourd à une centaine de mètres derrière nous.
Attention ! Nous avons été découverts par l'ennemi ! Le tir de son artillerie a été immédiatement rectifié. Deux shrapnells éclatent juste sur l'escadron. Affolés, les hommes, qui tenaient les chevaux de main des combattants à pied, n'ont pu retenir les bêtes effrayées. Ils ont tout lâché. Les chevaux, débandés, galopent et fuient dans toutes les directions, à pleine allure. Quelques-uns sont blessés. Désordre indescriptible. Pendant un quart d'heure nous sommes arrosés d'obus et de shrapnells (débouchés heureusement trop haut, comme toujours).
Par miracle, aucun homme, aucun cheval de mon peloton ne sont touchés. Etant à cheval nous sommes cependant les plus exposés, les plus vulnérables.
Sous la protection du tir des combattants à pied, les chevaux sont peu à peu rattrapés, les lances ramassées et replacées aux crochets porte-lance des selles.
J'ai poussé ma jument sous les branches auprès du capitaine de Langlois. Rapide colloque :
- Mon capitaine, voulez-vous que je charge ? - Sur quoi ? On ne voit personne !
- Mais si ! Là, en fourrageurs sur la lisière du taillis. C'est plein de voltigeurs ennemis. Il en sortait de partout tout à l'heure. Ça les ralentirait !
- Vous êtes fou ! Votre peloton serait fusillé à bout portant ! Et pour rien ! Restez en place !
Un agent de liaison survient justement : ordre de retraite générale derrière le Petit Morin !
Tandis que les trois autres pelotons vont remonter à cheval, je reste aux aguets, toujours prêt à charger, pour protéger le mouvement. Je m'attends à voir déferler un rideau d'infanterie ennemie venant ramasser l'escadron surpris en flagrant délit de remonter à cheval. Alors j'aurais la partie belle ! Le terrain en chaume se prête admirablement à une action à cheval, à la lance. Je surprendrais l'infanterie ennemie à courte distance.
Mais rien ! L'artillerie se tait. Pas un coup de feu d'infanterie ! Rien ! Le silence. Le vide.
On nous dira plus tard :
- Il était temps de repasser le Petit Morin, vous étiez complètement tournés par la droite, par les hauteurs boisées !
C'était certainement vrai.
1 h de l'après-midi.
La brigade entière repasse le Petit Morin au pont de Verdelot. Cette retraite est navrante.
Par la faute d'ordres confus, c'est la cohue sur l'unique pont qui nous est réservé. Le général est là. Je verrai toute ma vie son visage bouleversé, livide. Le pont franchi, on le cherche pour lui demander des ordres ! On ne sait où aller.
2 h de l'après-midi.
Le général décide enfin. Imprudemment, toute la brigade a été disposée sur les hauteurs au sud de la vallée, sur un groupe de fermes bien en vue, soi-disant pour déjeuner, avec allées et venues incessantes, attirant l'attention.
Les obus n'ont pas été longs à nous arroser. Tout le monde l'avait prévu, excepté celui qui avait donné l'ordre de rester là. Il a fallu déguerpir de nouveau, non sans pertes. Le brigadier Mathon, de mon peloton, a été mortellement blessé. Je l'ai fait installer dans une brouette pour le transporter sans souffrances à l'ambulance. Malheureusement il est mort avant d'y parvenir. Il avait reçu un éclat d'obus dans la poitrine.
5 h du soir
De l'Hermite et moi, nous avons bien failli être tués par un shrapnell, à côté de la ferme du Colombier. Il a éclaté dans les branches mêmes de l'arbre qui nous abritait, un pommier. Un miracle ! La mort ne veut pas de nous.
9 h du soir
Il fait nuit. Après avoir tiraillé toute la journée et intimidé l'ennemi (vraiment peu mordant) nous montons à cheval pour aller, selon l'ordre de stationnement, cantonner dans un village qui s'appelle Choizy.
Toujours pas de cartes. Il paraît qu'on va nous en distribuer demain, mais elles ne sont toujours pas là !
Il est à noter, comme le signale mon carnet de route, que l'ennemi est peu entreprenant. Il répugne à attaquer de nuit. Après s'être emparé de Château-Thierry, au soir du 2 septembre, il n'a entrepris de traverser la Marne que le lendemain 3, dans la matinée, en plein jour. Il est resté toute la nuit du 2 au 3 à cantonner à Château-Thierry. Vingt-quatre heures après, il s'est arrêté avant d'aborder la coupure du Petit Morin. Il a, cette fois encore, attendu le jour pour nous attaquer. Heureusement ! S'il avait continué de pousser son avance en pleine nuit sur la vallée de Montmirail, il aurait ramassé tous les traînards, tous les blessés, tous les bagages de la Ve armée. Alors quel affreux désordre ! Quelle panique ! Or, aujourd'hui, il en sera de même.
A 9 h du soir, nous décrochons, nous rompons le combat et, sans être le moins du monde inquiétés, sans laisser la moindre ligne de résistance en place.
Il est à noter qu'au cours de cette rude journée, la division nous a laissés en prise avec l'ennemi sans le moindre soutien ! Il y a cependant des batteries d'artillerie, des sections de mitrailleuses et des chasseurs cyclistes à la division !
Nous ne les avons pas vus !
Peut-être sont-ils engagés sur d'autres points, au profit d'autres unités ? ...
Cependant nous n'avons rien entendu. Il est vrai que la ligne est longue.
Nous nous éloignons vers le sud, pour aller paisiblement cantonner dans le village de Choisy-en-Brie, qui nous a été assigné. Tout le corps de cavalerie est ainsi réparti sur un éventail très ouvert prêt à tenir au point du jour une nouvelle ligne de défense et contenir la poussée de l'ennemi. La nuit sera tranquille.
Il paraît pourtant qu'à la suite des batailles de Mons et de Charleroi, la retraite des armées françaises une fois constatée, l'état-major allemand avait ordonné d'entamer la poursuite et de la conduire
, sans désemparer, de nuit comme de jour. Et ce fut bien ainsi que se passèrent les choses durant la première semaine. Sept jours et sept nuits de combats incessants. Il avait fallu parfois de violents coups de boutoir pour ralentir et refouler un ennemi grisé par sa victoire.
C'était ainsi que le 29 août, cette Ve armée, que nous protégeons en ce moment, avait dû faire tête à Guise, sur l'Oise. Elle y avait remporté un succès si net sur un régiment de la garde du Kaiser et les Hanovriens du 10e corps allemand que les hommes, se sentant vainqueurs, ne voulaient plus reprendre la retraite le lendemain, prétendant continuer d'aller de l'avant, se sentant capables de battre l'ennemi et de le rejeter hors de France. Le moindre succès et le moral remonte !
C'était à partir de la double coupure de l'Oise et de l'Aisne que la poursuite de l'ennemi avait paru faiblir. Elle s'était en effet sérieusement ralentie. Les armées allemandes lancées à la poursuite de notre Ve armée (Ire armée, von Kluck, IIe armée, von Bülow, IIIe armée, von Hausen.) n'attaquaient plus de nuit. Elles cantonnaient jusqu'au lendemain dans les villages rencontrés. Mais pendant le même laps de temps, c'est-à-dire pendant la nuit, les troupes françaises continuaient, elles, de marcher, ne s'arrêtant que le strict minimum (deux à trois heures) pour l'indispensable repos. L'ennemi était-il à ce point fatigué (La raison de ces arrêts n'était pas due à l'excès de fatigue. La lecture des pages suivantes du carnet de guerre de l'auteur de ce livre projettera sur ce point une lumière crue. Les troupes allemandes s'arrêtaient toutes les nuits, pour s'adonner au pillage et à de dégradantes beuveries. Le spectacle qui attendait les futurs vainqueurs de la Marne allait être ahurissant. Des centaines de milliers, des millions même de bouteilles (de champagne de préférence) jonchaient à perte de vue les routes. Les soldats enfonçaient la nuit les portes des caves, s'enivraient jusqu'au jour et repartaient le lendemain - tant bien que mal - pour l'étape, surchargés de bouteilles qu'ils buvaient tout en marchant, puis les jetaient vides sur le bord de la route. Les exécutions sommaires d'ivrognes d'une balle dans la nuque par les officiers et les sous-officiers ne pouvaient arriver à endiguer ces scènes de beuverie. Ces soldats ivres morts étaient, aux termes du règlement militaire allemand, justement considérés, étant devenus impropres au combat, comme des déserteurs. Les troupes françaises allaient, au cours de leur contre-offensive victorieuse, ramasser des milliers de prisonniers pris de boisson (à Château-Thierry par exemple et à Reims). Mais ce serait singulièrement dénaturer la vérité que de donner à penser que la victoire a été remportée sur des troupes éprouvées par trop de libations. Les troupes allemandes se sont magnifiquement battues et la victoire de la Marne a été extrêmement dure à remporter. C'est en plaisantant qu'on a pu dire que les Français avaient eu avec eux un allié autrement efficace que les Anglais... le champagne.) ? On pourrait le penser, à constater l'effort énorme fourni par certaines unités du 4e corps actif aile droite de la Ire armée allemande qui, au début, avaient accompli deux étapes successives de chacune cinquante-cinq kilomètres, exclusivement à pied !
Nous serons sûrement tranquilles cette nuit. On dessellera même les chevaux. Les malheureuses bêtes en ont tellement besoin !
Samedi 5 septembre.
Debout au point du jour, chevaux ressellés, ayant bu et mangé avoine et foin.
Les reconnaissances rentrent. Celle du sous-lieutenant Gougis rend compte que devant nous l'ennemi a repris sa marche, et qu'elle s'est heurtée à ses premiers coureurs. Ceux-ci seront bientôt signalés.
La mission du 20e Dragons est de tenir par le combat à pied le village de Choisy-en-Brie, où nous sommes et avons passé la nuit. Ordre de tenir fermement Choisy. Le 4e escadron garnit de combattants la lisière nord du village.
Tout le 3e escadron est réserve à cheval de la 10e division. Cette fois, nous recevons en soutien la section de mitrailleuses
du 11e Dragons (8e brigade de dragons de la 8e division). Tout le corps de cavalerie est donc en ligne.
Hâtivement nous mettons Choisy en état de défense, barrons les rues à l'aide d'énormes charrettes emplies de paille (La paille arrête bien les balles.)
Les dernières reconnaissances rentrent. L'ennemi arrive en force, tout près. Le maréchal des logis Simon, excellent sous-officier du 4e escadron, est tué.
Le peloton de Montmorin, installé sous les toits de l'auberge où nous avons passé la nuit, ayant enlevé des tuiles pour se ménager des lucarnes, a ouvert un feu intense sur les uniformes gris qui dévalaient des pentes en face de nous. Le spectacle était réjouissant.
La section de mitrailleuses du 11e dragons tire à longues rafales. Le vacarme est assourdissant. Les pertes de l'ennemi sont lourdes. A 12 h, nous évacuons Choisy-en-Brie par ordre. Il paraît que le corps de cavalerie est débordé par la gauche. Nous, nous tenons la droite. Toute la matinée, depuis 6 h, nous avons reçu un déluge d'obus. Ah ! les misérables, on ne les arrêtera donc pas ! Ils savent se battre ! Leur artillerie avance partout en rideau, pilonne la défense, l'aveugle, la détruit. L'infanterie n'avance qu'ensuite, à peu de frais. L'ennemi use parfaitement de la liaison entre les armes. Artillerie d'abord, ensuite infanterie. Nous, nous ne savons pas ! Pas dans la cavalerie en tout cas. Toujours cette obsession de l'arme blanche (Je recopie ici encore une fois textuellement le texte du règlement de 1912 traitant du procédé de combat de la cavalerie. Le voici : " La cavalerie agit par le mouvement. L'attaque à cheval et à l'arme blanche. qui seule donne des résultats rapides et décisifs, est le mode d'action principal de la cavalerie. Le combat à pied est employé dans les circonstances tactiques où l'attaque à cheval est momentanément impossible. " Un tel aveuglement une telle ignorance de la part de nos états-majors sont affligeants ! Ce n'était pas la peine d'avoir créé une Ecole supérieure de guerre ! On se croirait encore au premier Empire.) ! Beaucoup de progrès à faire !
C'est égal, cela me fait une impression pénible d'évacuer ce village de Choisy. Un village de France encore qu'ils vont piller, souiller de leur présence !
Tenir serait folie ! Les shrapnells pleuvent. Le bruit est effroyable ! Les escadrons se retirent par échelons, sans subir de pertes. Derrière nous, Choisy abandonné disparaît dans la fumée des
obus. Les Allemands n'y sont pas encore. Leur artillerie continue de l'abrutir de projectiles. Dans quelques instants leur infanterie y pénétrera sans aucun risque. C'est leur tactique. Elle est juste. Ces gens-là savent se battre. Ils ont l'organisation du combat, il faut le reconnaître. Ceci d'ailleurs augmentera notre mérite quand nous serons vainqueurs. Car nous le serons ! ! ! Sûrement ! ! !
3 h du soir
Nous venons de traverser l'Aubétin en plusieurs colonnes. On a fait sauter les ponts derrière nous. Pourquoi ? C'est puéril ! L'Aubétin est un ruisseau.
Nous descendons encore plus au sud, près d'un petit village, nommé Champcenet, où nous mettons pied à terre. On nous distribue enfin des cartes au 1/80 000 d'état-major, une par officier. Quelle joie de comprendre enfin où l'on est !

Dispositifs français et allemand (gauche française et droite allemande) se faisant face le 5 septembre 1914, vielle de la contre-offensive offensive française.
PREMIER CONTACT AVEC LA RETRAITE TROUPES EXTENUEES
L'escadron remonte à cheval et parcourt encore mille cinq cents mètres, pour aller finalement faire halte à Courchamp, autre petit village situé sur la grand-route, à quatre kilomètres ! On a beau être confiant et gonflé à bloc, cela donne tout de même le vertige...
Le capitaine m'envoie tenir seul avec mon peloton le petit hameau de Rupéreux, le mettre en état de défense et résister en cas d'attaque de nuit par l'ennemi. Ce hameau est à une croisée de routes, à trois kilomètres de Villiers-Saint-Georges. Se méfier du bois. Nous couvrons Provins et l'ennemi peut tenter de s'en emparer avant la nuit.
J'arrive à Rupéreux vers 6 h du soir. Il me semble apercevoir du rouge, du bleu dans un chemin creux entre des haies. Stupéfaction, ce sont des fantassins français ! Nous avançons vers eux. Quatre soldats d'infanterie, dont un sous-officier, reconnaissable à la sardine d'or usagée de sa manche, sont assis là, contre le talus, capotes déboutonnées, ouvertes, képis sur les nuques, en train de plumer des volailles trouvées dans les maisons désertes. Là comme ailleurs, les habitants ont fui.
J'aborde le groupe. Les hommes ne se dérangent pas, semblant ignorer ma présence. Alors je les interroge. Qui sont-ils ? De quel régiment ? D'où viennent-ils ? Que font-ils dans ce village ? Où sont leurs officiers ?
Sans se lever, le sergent me répond :
- On est du 18e, le reste du bataillon. Les officiers, y en a plus.
Tous tués en Belgique. Juste deux qu'y a encore, le capitaine de la 6e et un lieutenant. Tenez, les v'là !
Toujours sans se lever, sans cesser de plumer sa volaille, sans lâcher son couteau de poche, le pouce pointé par-dessus l'épaule, il me désigne deux silhouettes qui arrivent à pas lents. Un capitaine en effet et un sous-lieutenant, à en croire les fragments de galons noircis de leurs tuniques.
Descendu de selle, les rênes de ma jument passées au coude, je me présente correctement au capitaine. Je cite mon grade, mon nom, mon régiment.
J'ai en face de moi un homme à la physionomie sans réaction, sans un sourire, une physionomie comme absente, inerte, indifférente. Indifférente aussi sa poignée de main, sans force, sans conviction.
- Mon capitaine, je viens pour tenir au combat à pied ce petit village et protéger votre retraite.
- Si vous voulez ! Vous pouvez bien faire tout ce que vous voudrez ! Protéger quoi ? Et pour quoi faire ? Tout est perdu.
Je réprime un haut-le-corps. Je me rends compte que j'ai affaire à un homme démoralisé, exténué, vidé. Mais tout de même tenir de tels propos devant ses hommes !
II ajoute :
- C'est pire que 70 ! On est trahis !
Quelle pitié ! Je suis à un doigt de le frapper, de le secouer par les épaules. Je me contente de lui crier :
- Non, mon capitaine, nous serons vainqueurs ! Vainqueurs ! Cette fois, il sourit d'un pauvre sourire ironique et me fait signe : - Venez !
Nous nous éloignons. Il veut me montrer d'autres groupes de ses hommes vautrés par terre, hâves, dépoitraillés, n'ayant même pas envie de manger et dormant comme des pierres, là où ils sont tombés d'épuisement :
- Regardez, mon pauvre ami, vous vous rendez compte ? Ça fait douze jours qu'on marche. On a fait trois cents kilomètres, peut-être quatre cents, je ne sais plus, avec du ravitaillement seulement deux fois, pas plus... On est à bout ! Vous êtes à cheval, jeune homme, vous ne vous rendez pas compte... Mais nous !
" Et puis, on nous a jetés, sur des tranchées bétonnées. ON nous a tous fait tuer. Exprès ! Je vous dis qu'on est trahis ! C'est pas vrai de faire attaquer comme ça ! Tous les officiers et les sous-officiers sont tués, tous mes amis, mes camarades, vous ne vous rendez pas compte, non ! C'est pas vrai, non, de voir tuer autour de vous en quelques minutes tous les gens qu'on aime. Et sans avoir vu l'ennemi ! Je n'ai pas vu un seul Allemand, moi qui vous parle !
Sa voix est près de se briser...
Je n'ai pas, bien sûr, noté sur mon journal toutes les phrases que m'a dites ce capitaine, mais je ne les ai jamais oubliées. Elles m'entraient dans le cœur comme autant de coups de poignard. Et je peux encore aujourd'hui les répéter presque textuellement.
A Rupéreux, je venais de recevoir une terrible révélation. Celle d'Epernay n'était rien en comparaison. Quoi, c'était ça, notre armée française ? C'était ça, cette armée que nous protégions, pour lui permettre de battre en retraite sans être attaquée dans le dos, pour lui donner le temps de se reposer, de se refaire, de recevoir des renforts et de reprendre le combat ! C'était ça ? Une armée de vaincus ? Un troupeau ? Il ne s'agissait pas de rechercher les responsabilités, de maudire, comme faisait ce capitaine. Seul comptait le fait. Et le fait était là !
Si toute l'armée française, d'un bout à l'autre de la ligne, était dans l'état où nous voyions les débris de cette compagnie du 18e il était fou de conserver le moindre espoir.
Ayant appartenu au 10e hussards à Tarbes, qui faisait lui-même partie du 18e corps d'armée de Bordeaux, je connaissais bien le 18e d'infanterie, à Pau. Sa caserne s'élevait au fond de l'esplanade de la Haute-Plante. Le fronton en portait en grandes lettres de bronze, de près d'un mètre, ses titres de noblesse, l'exclamation admirative de Napoléon, à la bataille d'Eylau : BRAVE 18e, JE TE CONNAIS !
C'était un fier régiment qui tenait à sa réputation. Ses défilés sous les armes étaient célèbres. La foule l'applaudissait. Et le revoir ainsi...
Une inspiration m'était venue :
J'avais, comme tous, rapporté de Lorraine mon plein bidon de l'excellente eau-de-vie de mirabelles du pays. J'y avais à peine touché. Il me battait le flanc. L'ayant ouvert, j'en versai une large rasade dans mon quart de fer blanc et le tendis au capitaine :
- Allez, mon capitaine, buvons à la santé du 18e ! BRAVE 18e, JE TE CONNAIS !
Stupéfait de m'entendre faire cette citation, le capitaine avait élevé le quart à hauteur de ses yeux comme pour une prière et il l'avait vidé d'un trait. Le sous-lieutenant possédant un quart, je l'avais également servi. Moi, je boirais au goulot. Tous trois, nous avions le même geste :
- Au 18e ! A la victoire de la France ! Le capitaine avait paru rasséréné.
- Maintenant excusez-moi, mon capitaine, nous avons du travail avec mes hommes !
En moins d'une heure, nous avions transformé Rupéreux en cantonnement d'alerte, crénelé les murs, percé les toits de meurtrières, découpé à la scie articulée des lucarnes de tir dans les volets fermés, ouvert les portes de derrière dans les jardins, reconnu les itinéraires de devant par lesquels pourrait survenir l'ennemi et les avions dégagés de tous arbustes et broussailles. Nos chevaux ayant bu et brouté l'herbe, nous les avions attachés à la corde, à l'abri des maisons.
Le capitaine nous avait regardés faire, muet. Le sous-lieutenant (Avocat de profession à Pau, mais officier de réserve au 18e, il avait réclamé - et obtenu - de partir avec les unités de l'active dont tous les jeunes officiers étaient ses amis et camarades.) m'avait pris à part :
- N'en veuillez pas, monsieur, au capitaine de ce qu'il a pu dire tout à l'heure. Il est exténué. Il a quarante-sept ans et a fait toute la retraite à pied. Tant qu'il a eu son cheval, il a fait monter dessus les hommes les plus fatigués. Lui, jamais ! Je suis sûr qu'il n'a pas dormi deux heures par nuit. Il n'a pas cessé d'exhorter ses hommes à marcher, à continuer : " Pour la France, mon petit ! Pour la patrie ! On les aura, les Boches ! " Il a vu tomber tous ses amis. Les pertes ont été terribles. Il a dépassé les limites. Ses nerfs ont craqué. Il est au bout du rouleau, je vous assure. Nous n'avons pas de traînards à la compagnie, ils ont tous leur fusil et leurs cartouches. Les sacs, ils ont été chargés dans les voitures du train régimentaire, jusqu'au jour où il faudra les reprendre. Ils sont là. Mais je vois que vous avez une carte ? Nous, on n'en a pas. Nous ne savons même pas où nous sommes. On lit les noms sur les routes. On est à quatre kilomètres de Provins ? Provins, c'est sur la Seine ?
- Non, la Seine, c'est plus bas, à vingt kilomètres plus bas, à Bray-sur-Seine.
- Alors encore vingt-quatre kilomètres à faire ! C'est à 3 h du matin qu'on doit repartir ! C'est terrible ! Je ne sais pas si on pourra les faire...
Le capitaine s'est rapproché. Il revient vers nous.
- Voilà le capitaine. Il faut absolument qu'il dorme ! Dites-le lui !
Alors je l'aborde et le salue :
- C'est fait, mon capitaine, tout est paré. Ne vous occupez de rien ! Dormez ! Dormez tous ! Nous sommes là pour tenir le village. Les Boches peuvent venir, on les recevra ! On vous réveillera s'il le faut.
Le capitaine, avec son regard d'halluciné, le regard d'un homme qui va s'écrouler, me serre la main, longuement :
- Merci, mon jeune camarade, merci ! Ça nous a fait du bien de vous rencontrer. Mais ce n'est pas fini. J'ai bien peur que tout soit perdu. On n'est plus des hommes. Comment y croire maintenant ? Regardez-nous ! Autant dire des morts.
Tandis qu'il parle, j'ai débouché son bidon sans qu'il y prenne garde et vidé dans le sien le contenu du mien, tout ce qui me reste d'eau-de-vie de mirabelles. Il s'en apercevra bien en cours de route.
- Au revoir, mon capitaine, bonne nuit !
LES MORTS SE RELEVENT
Nuit du 5 au 6 septembre.
La nuit a été parfaitement calme. Mon réseau de vedettes a fonctionné régulièrement d'heure en heure. Aucune alerte.
A 3 heures du matin, ont stridé les sifflets d'infanterie. Je les ai entendus se remuer, s'appeler, se réunir, se former, partir. J'avais passé la nuit sur un matelas jeté sur le plancher, près de la fenêtre d'une chambre, à l'étage de la première maison. Je me suis rendormi jusqu'à l'aube. Moi non plus, je n'en pouvais plus. Quand je suis descendu, il faisait clair de lune. J'ai constaté que le village était vide
, avec de loin en loin dans les chemins creux, des feux qui achevaient de s'éteindre avec leurs braises rougeoyantes. Plus un fantassin du 18e ! Plus un homme. Ils étaient tous repartis. Pauvres gens ! A 6 heures est arrivé au grand trot une estafette à cheval, que m'envoyait le capitaine de Langlois. Ordre de rejoindre tout de suite l'escadron lequel a cantonné à La Bretonnière, dans les faubourgs de Provins. Le temps de resseller et en route ! A 10 heures du soir, voyant qu'il ne se passait rien, j'avais pris le risque de faire desseller et panser les chevaux, laver et masser les dos. C'était irrégulier en cantonnement d'alerte, je sais. Mais c'est comme ça qu'on ruine ou qu'on conserve ses chevaux.
J'avais joué à pile ou face et gagné. Le cheval, c'est plus précieux que tout !
Quand nous arrivons à La Bretonnière, l'escadron est déjà rassemblé à cheval. Les pelotons de l'Hermite, Desjobert et Gougis ont rallié. Ils étaient comme moi disséminés aux avant-postes.
Grande nouvelle ! Incroyable nouvelle ! On attaque ! On reprend l'offensive ! La retraite de la Marne est terminée. Je cite ici textuellement mon carnet de guerre, sans en changer un mot, comme toujours, car il est pris sur le vif et restitue fidèlement l'atmosphère de joie et d'enthousiasme de cette époque :
On reprend l'offensive ! C'est fantastique ! Fantastique ! Franchet d'Espérey vient d'en donner l'ordre, ordre merveilleux d'audace, de précision, de patriotisme enflammé (Comme on le verra plus loin, le corps de cavalerie Conneau a été, dès sa constitution, mis à la disposition du général Franchet d'Espérey, le nouveau chef (Lanzerac a été relevé de son commandement) de la Ve armée. La situation de cette armée constamment menacée d'être enveloppée (aufrollen) par von Kluck, inquiète vivement Joffre.) !
On risque gros. Pourra-t-on réussir ? Je pense aux troupes lamentables, que j'ai vues, hier au soir, à Rupéreux. Elles sont éreintées. Si l'on échoue, ce sera la contre-attaque victorieuse immédiate de l'ennemi. Ce sera la fin ! Tant pis, j'ai confiance, confiance ! On reprend l'offensive, l'offensive ! ! ! Quelle fête !
Le régiment, pour le moment, reste en position d'attente, prêt à agir. Il ne peut rien faire, en effet, de lui-même. Il reste rassemblé pied à terre, dans un grand chaume, attendant la rupture du front. Alors on va voir ! ! !
Toute la journée se passe ainsi. Canonnade terrible d'un bout à l'autre du front.
- 7 h du soir, retour au même cantonnement, La Bretonnière. Excellentes nouvelles : l'ennemi surpris a légèrement plié. Notre offensive l'a dérouté. En certains points il a été enfoncé. La suite à demain !
Lundi 7 septembre.
Départ 6 h. Nous quittons La Bretonnière avec l'espoir de n'y pas revenir, car aujourd'hui celui de faire un bond en avant est largement permis.
Rassemblement dans les champs au sud du village de Champcenet (Béatitude d'avoir une carte et de savoir où l'on est !). Vers 7 h, quelques coups de canon, puis plus rien, silence complet, impressionnant. Nous avons l'impression que l'ennemi, qui nous fait face depuis six jours, se retire, bat en retraite.
10 h. - Un avion militaire à cocardes tricolores atterrit tout contre notre division. Le pilote, un officier, cherche le général commandant la division.
Notre heure ne va-t-elle pas sonner ?
L'aviateur confirme l'impression que nous avions. Pour le moment , les renseignements sont certains. Nous les tenons de celui même qui les apporte (Malheureusement mon carnet de guerre ne mentionne pas le nom de cet officier aviateur. Je ne l'ai pas noté sur l'instant. J'ai des raisons de croire qu'il s'est agi du capitaine de Rose (le futur célèbre commandant de Rose).). Notre impression était donc exacte. L'armée allemande bat en retraite. L'ennemi remonte vers le nord. Cela est sûr ! Cette fois enfin on va le poursuivre, ne plus lui montrer nos crinières, mais nos cimiers de casques !
Un officier d'état-major survient (Reconnaissable à son brassard tricolore. Rouge pour une division, bleu pour une brigade.) à cheval. Toujours à l'affût, le capitaine de Langlois l'interroge et nous rapporte des indications précieuses sur la situation générale. Je note ce que j'en ai retenu, sous toutes réserves, bien entendu !
A gauche, Senlis est occupé par les Allemands. L'armée allemande qui depuis le 23 août glisse depuis la Belgique vers Paris est menacée sur son flanc droit par un groupement mixte dont la formation s'achève dans le nord, entre Calais et Anvers, sans doute.
Ce groupement comprendrait 2 corps d'armée belges et 2 corps d'armée français débarqués par voie de mer et un élément anglais, le tout sous les ordres du général Pau (II est remarquable que ce carnet d'un simple sous-lieutenant de cavalerie, écrit sur place et à l'instant même, ait mentionné ce projet astucieux et audacieux. Il fut réellement envisagé par le G.Q.G. français. Mis à exécution, il eût sans doute obtenu les plus heureux résultats. Malheureusement il demeura sans suite, non par manque d'entente entre les hauts commandements français, anglais et belge (comme cela fut dit et écrit à tort) mais par insuffisance d'effectifs à ce moment-là. Ce bruit avait été apporté, ce jour-là, jusqu'à la 10e division de cavalerie, par cet officier qui avait ses entrées au sein du G.Q.G. de Joffre, à Châtillon-sur-Seine. En fait, il fallut limiter ce projet à la contre-attaque de la VIe armée (général Maunoury) mise par Joffre aux ordres du général Gallieni, gouverneur militaire de Paris et commandant les armées de Paris (c'était son titre officiel). Ce fut Gallieni qui, le premier et avec les forces dont il disposait, passa à l'attaque du flanc droit de la Ire armée allemande (von Kluck) imprudemment aventurée vers le sud-est, au lieu de marcher sur Paris. Joffre, convaincu par Gallieni et entraîné par lui, prescrivit alors de passer à la contre-offensive générale, presque contre son gré. Joffre voulait reculer jusqu'à l'Aube et à la Seine pendant deux jours encore, voulant laisser les Allemands " s'enfoncer plus profondément dans la nasse ". " Le fond de la nasse sera pourri d'ici-là ! s'était écrié Gallieni. Les troupes sont exténuées, demain elles seront mortes, attaquons aujourd'hui !" (dernière communication pathétique téléphonique le 4 septembre à 22 heures). Gallieni a été le premier et principal artisan de la victoire de la Marne. Joffre aurait peut-être laissé passer l'occasion mais le mérite d'avoir quand même pris la décision de passer à l'offensive générale ne saurait lui être contesté.)
Un autre tuyau moins sûr serait que, vers Beauvais, s'achèverait aussi la formation d'une nouvelle armée (la VIe). Toutes ces masses se prépareraient à tomber sur le flanc droit et en arrière des armées allemandes.
Dans un rayon plus restreint, la situation où se trouve notre division est la suivante :
Trois divisions de cavalerie (C'est-à-dire tout le corps Conneau.) sont orientées face au nord : la 1Oe division (la nôtre) vers Hilliers, ayant pour axe Courchamps-la Ferté-Gaucher. A sa gauche, la 8e division. Plus à gauche encore, la 4e division vers Beauregard, en liaison vers Dugny avec l'armée anglaise, qui forme ainsi l'extrême gauche du dispositif.
A droite de la 10° division et un peu en arrière, s'étend l'aile gauche de la Ve armée de Franchet d'Espérey, composée du 18e corps du 3e et du 1er. Beaucoup plus loin, à droite, combat une subdivision d'armée (général Foch) composée d'une partie des 20e et 7e corps.
Toute cette masse constitue aujourd'hui le mouvement d'offensive si heureusement amorcé hier.
11 h 30
Ordre de poursuite ! Ordre accueilli avec joie mais aussi avec ,
scepticisme. On nous a déjà trop fait le coup ! L'ordre est, cette fois plus précis. Il dit de SE PREPARER à poursuivre... mais on reste sur place. L'ennemi bat en retraite, oui, mais le poursuivre le ferons-nous, le pourrons-nous ?
La division reste en attente, pied à terre. Le général ne donne toujours par l'ordre de monter à cheval.
12 h 45
A cheval ! Grande fièvre ! Les 4 régiments de dragons et les 2 régiments de chasseurs à cheval de notre division sont aussitôt en selle. Notre artillerie, notre groupe de chasseurs cyclistes, le bataillon du 45e d'infanterie en autobus mis à notre disposition nous doublent et passent devant nous. Le tout toujours aux ordres du général Grellet.
Nous brûlons d'impatience. En avant ! Oui, mais avant au pas ! Nous parcourons trois cents mètres. Pied à terre ! Dix minutes se passent. A cheval ! Trois cents mètres encore au pas. Pied à terre ! Plusieurs heures se passent ainsi. C'est enrageant ! Nous poursuivons au pas. L'infanterie marche devant : Nous derrière elle. Les convois d'infanterie, trains de combat et trains régimentaires, bagages, cuisines roulantes, marchent à notre hauteur. C'est humiliant ! Appeler ça poursuivre : Non !
Interrompons un instant la lecture de ce carnet de route, nous la reprendrons tout à l'heure. Plaçons-nous sur un plan plus général.
Jusque-là, il n'y a rien à dire sur le comportement du corps de cavalerie Conneau, pas de reproches à lui adresser. Depuis que la 10e division (augmentée de la brigade légère de Contades) a été transportée de Lorraine sur le théâtre d'opérations de la Marne, il a correctement rempli son rôle. Ses trois divisions déployées en rideau ont retardé la marche de l'ennemi et protégé la retraite des armées françaises. Il a agi par ses feux au combat à pied, éprouvant d'ailleurs des pertes sérieuses.
Certes, on a pu s'étonner de cette nuit du 2 au 3 septembre passée dans l'inaction dans les rues d'Epernay, tandis que les Ire et IIe armées allemandes marchaient et allaient atteindre la Marne à Château-Thierry. Mais il est juste de reconnaître que le corps de cavalerie était alors de nouvelle création. Sa concentration n'était pas encore achevée et s'opérait dans la difficulté autour d'Epernay. Ses 4e et 8e divisions n'avaient pu encore complètement recoller à la 10e
Certes, cette 10e division a pu s'indigner le 3 au matin d'être tenue dans l'inaction et de n'être employée qu'à accomplir une banale étape de vingt-cinq kilomètres d'Epernay à Montmirail, alors que la canonnade faisait rage sur la Marne près de Château-Thierry. Cette division, brûlant d'être utilisée, ne savait pas que sa sœur, la 8e division, débarquée un jour avant elle à Epernay, avait été aussitôt mise en route en direction de Château-Thierry, avec un bataillon d'infanterie transporté en autobus, avec ordre du général Conneau d'interdire le plus longtemps possible à Château-Thierry le franchissement de la Marne par l'ennemi et, s'il était impossible de tenir à Château-Thierry, de le faire sur les hauteurs du plateau de Nesles (rive gauche) pour retarder la traversée de la Marne (ordre du général Conneau daté de Dormans le 2 septembre à 22 heures).
D'où la canonnade entendue le 3 septembre au matin, vers Château-Thierry.
Pendant ce temps, la 10e division (débarquée à son tour à Epernay, dans la nuit du 2 au 3 septembre) avait été acheminée par Orbais et Montmirail sur la coupure du Petit Morin, afin d'y établir en profondeur une seconde ligne de résistance dès le 3 septembre au soir et d'y recevoir l'ennemi dès qu'il aurait forcé le passage de la Marne, surmonté la résistance de la 8e D.C. et poursuivi sa marche vers le sud.
La 10e D.C. l'avait rencontré le même soir à tombée de nuit, aux avancées de Montmirail, puis contenu toute la journée du 4 septembre. Celle aussi du 5, sur le Grand Morin et l'Aubétin.
On ne pouvait rien reprocher à la cavalerie depuis son débarquement à Epernay. En serait-il de même, à présent que l'armée française était, sur toute la ligne, passée à la contre-offensive ? Nous étions dans le doute. Cette lenteur à poursuivre n'était-elle pas un scandale ?
Nous en discutions âprement entre nous, nous les jeunes officiers. Le capitaine de Langlois cherchait à tempérer notre impatience. Nous ne savions rien de la situation générale. Certes, l'ennemi pliait, il battait en retraite devant nous, mais il n'était pas en déroute. La cavalerie ne peut agir que lorsque la retraite de l'ennemi devient désordonnée et près de lâcher pied. Ce n'était pas encore le cas. C'était pourquoi on attendait.
Et puis, nous ne savions même pas les instructions données par Joffre au général Conneau ! Le C.C.C. (Abréviation de corps de cavalerie Conneau.) était aux ordres directs de Joffre. Le général Grellet exécutait certainement les directives de Joffre à Conneau. Nous ne pouvions pas juger.
L'ETAT D'USURE ET DE RUINE DE LA CAVALERIE IMPUTABLE A SES CHEFS
Nous saurions plus tard (beaucoup plus tard, après la guerre, ceux qui survivraient) que Joffre avait mis le corps Conneau à la disposition, c'est-à-dire aux ordres, du général Franchet d'Espérey, commandant la Ve armée, aile gauche (ouest) du dispositif français. Joffre, généralissime, se dépossédant du corps Conneau pour le prêter à Franchet d'Espérey, avait prescrit à Conneau de se mettre aux ordres du général commandant la Ve armée - afin de la couvrir sur sa gauche et assurer sa liaison avec la droite de l'armée britannique dont le chef était le maréchal French, mais il lui avait aussi prescrit de saisir toutes les occasions d'attaquer et de défaire l'ennemi en retraite.
Ordre improprement rédigé, parce que entaché de dualité de missions. Si l'occasion se présentait, à laquelle des deux missions faudrait-il donner la priorité ? Attaquer et défaire l'ennemi, abandonnant momentanément celle d'assurer la liaison entre la Ve armée et l'armée anglaise, risquant ainsi de laisser se produire entre elles un vide pouvant devenir dangereux en cas de retour offensif de l'ennemi ?
Ou bien, à l'inverse, continuer d'assurer cette liaison quelles que fussent les circonstances et, de ce fait, négliger et laisser échapper l'occasion d'attaquer et de défaire l'ennemi ? Que décider, que choisir ?
Ordres de toute façon malencontreux, cars ils portent en germe la terrible affaire de Sissonne, huit jours plus tard, qui va peser si lourdement sur la suite et l'issue de la guerre.
Joffre, qui avait dans la main le corps de cavalerie Conneau à ses ordres directs, est-il donc embarrassé pour s'en servir ? La cavalerie est une arme versatile, un peu désuète, dont le rôle évolue très vite, au gré des événements. Elle demande à être commandée de près, sur le terrain même, par un chef bien placé pour juger des circonstances. Le G.Q.G. est bien loin et Joffre, qui a fait toute sa carrière dans le génie, préfère sans doute en confier par délégation l'emploi à " ce chef mieux placé que lui pour juger des circonstances ", c'est-à-dire à Franchet d'Espérey, lequel a précisément besoin d'une masse de cavalerie pour le couvrir à gauche et le relier à l'armée de French.
Joffre se doute-il qu'il va précisément priver le chef du corps de cavalerie de sa plus belle arme, sa totale liberté d'action ? Il va le brider, le faire tenir étroitement en rênes par Franchet d'Espérey. Celui-ci va l'utiliser au mieux des intérêts de sa propre armée ? Et ceci à une époque où les transmissions (ordres et renseignements) sont dans les limbes, quasi inexistantes, devenant nulles lorsque augmente la distance entre les échelons du commandement et les combattants. Ce dernier facteur va jouer un rôle énorme dans le drame des 13 et 14 septembre. Car ce sera un drame.
Conneau expliquera que, selon les ordres reçus, il s'agissait pour lui d'aveugler l'hiatus ouvert entre Franchet d'Espérey et French et de surveiller que l'ennemi n'en profitât pas. Il s'en servira pour récuser l'accusation de timidité du corps Conneau prononcée par tous les historiens militaires, en particulier par le général Duffour, professeur à l'Ecole supérieure de guerre.
Conneau va s'en tenir trop souvent au soin d'assurer la liaison franco-anglaise, tout en protégeant le flanc gauche de la Ve armée, plutôt qu'au souci de saisir l'occasion d'attaquer et de faire la percée. Il expliquera que cette obligation de liaison constituait sa mission principale et que d'ailleurs ses chevaux étaient bien trop fatigués pour qu'on pût songer à les utiliser pour une action violente (Aucun danger qu'on entreprît cette action violente, nous avancions au pas et mettions pied à terre tous les quarts d'heure.) .
Le bruit s'était répandu que le général Sordet, chef du 1er corps de cavalerie, avait été relevé de son commandement, pour avoir mis ses escadrons à plat et perdu un nombre énorme de chevaux pour leur avoir simplement imposé des efforts et des fatigues insoutenables. Qui en était responsable ? Joffre lui-même et beaucoup de chefs (même de cavalerie) ignorant la limite de résistance du malheureux cheval.
Cette ignorance sévissait aux échelons supérieurs de la hiérarchie. Pour ces grands chefs, la pensée qu'on était en temps de guerre semblait les avoir plongés dans une psychose étrange, un état de fébrilité qui justifiait pour eux qu'on demandât au cheval des épreuves démesurées et même absurdes.
Elles allaient provoquer en peu de temps l'usure, puis la ruine de la cavalerie. Conneau ne serait pas de ceux-là. Il s'en garderait bien. Il s'en garderait trop...
Le fait que je vais rapporter et auquel j'ai été personnellement mêlé ne s'est jamais effacé de ma mémoire. Il fit naître chez moi un sentiment de réprobation et d'indignation dont je n'avais pas été maître de ne pas le cacher. Ce fait s'était situé dans la cavalerie même, à un échelon déjà suffisamment élevé.
En Lorraine, au cours des premières semaines de la guerre, tandis que notre division assurait la couverture de la concentration sous Nancy de la IIe armée, nous quittions chaque matin avant le jour nos cantonnements de Lunéville et nous nous rendions aux environs, prendre position dans un ravin, à peu de kilomètres de la forêt de Parroy, tout près de la frontière. Ce ravin, chaque jour le même, était tapissé de magnifiques champs de blé, récemment moissonnés, mais dont les javelles non encore relevées (elles ne le seraient jamais) avaient été abandonnées sur place.
Cet endroit avait été choisi par le général commandant la 10e D.C. (Général Grellet.). Une ligne de crête barrant le ciel à peu de distance lui avait paru une sauvegarde suffisante, parce qu'elle nous dissimulait aux éventuels regards des reconnaissances de cavalerie ennemies ayant réussi à s'infiltrer à travers notre réseau de sûreté. Politique naïve de l'autruche la tête dans le sable, car elle dénotait une totale ignorance des possibilités de l'aviation, ignorance quasi générale aux échelons élevés du commandement.
Pis encore, beaucoup de chefs ne pouvaient se défendre d'un fâcheux état d'esprit, une sorte de prévention à l'égard des aviateurs, même du grade d'officier. Pour eux, les aviateurs étaient des sportifs, des manières de casse-cou, de têtes brûlées, ayant choisi la cinquième arme par gloriole ou par attrait de la prime de vol. On ne pouvait les prendre au sérieux. Les renseignements qu'ils rapportaient appartenaient au domaine de la fantaisie. Les aviateurs prétendaient avoir tout vu. Or, on savait bien que d'avion on ne pouvait rien distinguer. Dès qu'on atteignait 1 000 m, tout s'effaçait.
Plusieurs fois déjà, des avions allemands, à croix noire, étaient venus nous survoler, nous dénombrant tout à loisir. Dans ce ravin entièrement nu, nous étions aussi visibles que le nez dans la figure. Il eût été plus intelligent (mais allez donc le demander !) de nous rassembler à l'abri des feuillages de la forêt de Parroy. Nous eussions, nous et nos chevaux, profité du même coup d'une ombre bienfaisante.
Or, ce dernier point était le plus important, le plus grave. En ce début d'août 1914, sous un soleil implacable la chaleur était vraiment torride, 40 ou 50 °C au moins à découvert, sans doute davantage. Et pourtant, pendant plus de dix jours, durant toute la journée, de l'aube au couchant, la 10e division de cavalerie allait être massée au même endroit, pied à terre, sans bouger, sous ce soleil infernal. Pas un arbre. Pas un pouce d'ombre.
La souffrance était si forte, que les cavaliers avaient été autorisés à ramasser les gerbes de blé alentour, pour se constituer, à l'aide de leurs lances croisées, des sortes de huttes de paille pour se mettre à l'abri.
Mais que dire des chevaux ? Ils étaient, eux, condamnés à rester là debout, tout sellés et bridés, le poil marbré de sueur sous l'intenable chaleur augmentée par l'épaisseur de la couverture de laine, dite de cavalerie, pliée en quatre, accablés de surcroît par le poids du lourd paquetage de guerre, si mal étudié dans l'armée française. La température était si brûlante, qu'on aurait pu faire cuire un œuf contre le cuir des selles.
Je souffrais pour mes chevaux. Aidé de mes hommes, je m'étais ingénié à faire confectionner, avec des gerbes unies par des liens de paille tressée, des sortes de grands chapeaux protégeant au moins la nuque et la tête des pauvres bêtes de mon peloton, leur assurant un minimum d'ombre. L'exemple s'était bientôt propagé dans tout le régiment. C'était déjà ça !
Mais faire boire mes chevaux ! Je ne pensais qu'à ça ! Ah, faire boire mes chevaux ! En temps normal, par température normale, un cheval doit s'abreuver deux fois par jour, à chaque repas de foin et d'avoine.
Ici, impossible ! Quel affreux supplice sous ce terrible soleil ! Que devaient penser nos brave, chevaux de la cruauté de leurs maîtres ? Rien à leur dire, à leur expliquer ! Certains refusaient de manger leur avoine. Les musettes-mangeoires restaient pleines, suspendues aux boutons des têtières.
C'est ainsi qu'on perd une cavalerie...
Cependant, il y avait au loin, à cinq ou six cents mètres à l'entrée du ravin, une grosse ferme, munie dans la cour d'un puits et d'un abreuvoir en pierre. J'avais remarqué - je n'étais pas le seul - que deux femmes venaient y tirer de temps à autre de l'eau. Ne pourrait-on (nous en avions parlé entre nous) y conduire nos chevaux, les pelotons s'y rendant à tour de rôle, les autres restant en position d'alerte ? Cela prendrait, certes, un long moment pour tout un régiment, plusieurs heures sans doute. Mais n'avait-on pas toute la journée devant soi, à ne rien faire en dehors de la routine des patrouilles, des reconnaissances et des détachements de découverte ?
Je m'en étais ouvert au capitaine de Langlois, commandant l'escadron. Il avait hoché la tête, avec son sourire bien connu, à la fois ironique et bienveillant :
- Excellente idée, cher ami ! Figurez-vous que je l'ai déjà eue. J'en ai parlé au colonel.
- Et alors ? On y va ?
- Allez à votre tour le dire au colonel, je vous y engage ! Mais je vous préviens, vous allez vous faire recevoir !
Quand il s'agissait de mes hommes, de mes chevaux, j'avais " tous les culots ". J'y étais allé.
A peu de distance, le colonel était, comme tout le monde, installé à l'ombre sous sa paillote. Il m'avait foudroyé du regard de m'avoir vu l'aborder la main à la visière, sans y être invité.
Je m'étais expliqué. La réponse avait claqué comme un coup de fouet :
- Défense de quitter sa place, ordre du général ! Nous sommes en temps de guerre, savez-vous, mon ami ? Les chevaux boiront cette nuit, au cantonnement !
Et voilà...
Voilà comment après seulement un mois de guerre, rien qu'en restant sans bouger, exposés comme des abricots de Californie sur leur claie aux rayons d'un soleil torride, les chevaux de nos superbes régiments de cavalerie, si bien soignés en temps de paix, allaient être ruinés, détruits, sans même avoir été utilisés, par la faute de chefs ayant perdu le sens des réalités. Les pauvres bêtes allaient se dessécher, atteintes de brûlures, de plaies, de blessures sur le dos dues au contact insupportable de la couverture imprégnée de sueur.
A peu de temps de là, le valeureux aspirant d'Ussel, du 1er escadron, ayant prétendu sortir de la colonne en marche, pour faire boire au plus vite à un abreuvoir rencontré quelques chevaux particulièrement éprouvés de son peloton, s'était fait vertement tancer par le même colonel :
- Rentrez immédiatement dans le rang, d'Ussel ! Qui vous a permis ? La prochaine fois, je vous casserai de votre grade !
Tout cela était grave et triste.
Je regardais nos chevaux devenant peu à peu méconnaissables, efflanqués, mornes, abattus, le poil terne, les salières enfoncées (ce signe de souffrance qui ne trompe pas), les côtes en cerceaux, la plupart bientôt incapables de tout effort sérieux. Je me remémorais la recommandation de notre écuyer à Saumur, le lieutenant de Malherbe (Tué héroïquement les tout premiers jours de la guerre. au cours d'une liaison audacieuse.) :
- Messieurs, rappelez-vous une seule chose : si nous avons un jour la guerre, soignez votre cheval comme la prunelle de vos yeux, soignez-le comme s'il valait une fortune, comme s'il valait un million (C'était en l'an... 1913.). Mais le jour du combat, alors jetez-le sans hésiter sur le tapis, dépensez-le, comme s'il ne valait plus qu'un sou ! C'est dans ce but que vous l'aurez soigné. Etant alors en pleine forme, il vous donnera la victoire.
Que ne sont-ils retournés à Saumur se retremper dans son ambiance et s'inspirer de si sages conseils, nos vieux généraux et nos vieux colonels ! Certains en avaient pourtant le plus pressant besoin ! La guerre venue, ils ont comme perdu tout jugement, considéré le cheval non plus comme un être vivant de chair et d'os, mais comme un véhicule à moteur aux forces illimitées, à ne pas ménager parce que c'était la guerre.
Joffre ne s'y était pas trompé. Il avait dû prendre des mesures sévères à l'égard des chefs de cavalerie, en faire une sélection qui, certes lui coûtait, car il s'agissait parfois de camarades connus autrefois sur les bancs de l'Ecole de guerre. Sur les deux commandants du corps de cavalerie, Sordet et Conneau, il en avait relevé un de son commandement, Sordet. La France comptait 10 divisions de cavalerie. Sur les 10 généraux placés à leur tête 5 avaient été limogés comme insuffisants, timorés, fatigués, ou malades. Ainsi, la cavalerie avait-elle, dès les premières semaines de la guerre, été amputée de la moitié de ses chefs. Il était regrettable que l'hécatombe se fût limitée au grade de général de division, épargnant brigadiers et colonels.
Pour en revenir au général Conneau, notons dès à présent qu'au début des opérations de Lorraine, le généralissime Joffre, faisant fond sur sa réputation d'audace à froid et de parfaite connaissance de l'emploi de son arme, l'avait appelé au Grand Quartier Général, pour lui parler, le voir de près et l'investir d'une mission audacieuse ,
tenue secrète : dès que la IIe armée, de Castelneau, prenant l'offensive dans la région dite des Etangs entre Metz et Strasbourg, aurait réalisé la percée, le corps Conneau (fort de trois divisions, les 2e, 6e et 10e) foncerait dans la brèche, traverserait la Sarre, envahirait la Basse-Alsace jusqu'à la rive gauche du Rhin, la descendrait face au nord, envahissant le Palatinat, pour saccager les arrières de l'ennemi et détruire ses lignes de communications, but stratégique d'une importance capitale.
Mission splendide, enthousiasmante, mais pêchant peut-être par excès d'optimisme. Nous n'en connaissions pas (même nous, les officiers) l'enjeu réel. Nous savions seulement qu'il s'agissait de franchir la Sarre et de s'enfoncer en Lorraine annexée, où la population nous accueillerait dans le délire de la délivrance après quarante-quatre années de servitude et d'humiliations. Pour l'heure, nous devions simplement nous préoccuper d'emporter quatre jours de riz pour les hommes et d'avoine pour les chevaux. Il nous faudrait vivre sur le pays, sans aucun ravitaillement de l'intendance, laquelle ne pourrait suivre.
Le général Conneau avait même fait ouvrir à cet effet entre les régiments un concours de type de paquetage ingénieux, permettant d'emporter le maximum d'avoine, de riz, de sucre et de café.
Le 7e cuirassiers, de Lyon, de la 6e division de cavalerie, avait été le lauréat de ce concours. Aussitôt jalousé. - Pas malin ! avait-on dit. C'était lui qui avait les plus grands et les plus forts chevaux !
Toujours était-il que dès le 16 août tous les chevaux du corps de cavalerie avaient " bénéficié " d'une surcharge de 8 kilos de vivres, répartie entre les bissacs supplémentaires serrés sur le pommeau des selles et les musettes-mangeoires gonflées d'avoine suspendues à l'anneau des poches à fers.
Le 18 août, la IIe armée est en pleine offensive. De même, à sa droite, la Ire armée (général Dubail). Le corps de cavalerie Conneau attend la rupture pour se précipiter dans la brèche et entreprendre sa mission. Cela ne l'empêche pas de participer à l'offensive générale, tout en assurant la liaison entre les deux armées (Par ordre du G.Q.G. le 2e bataillon de chasseurs a été mis aux ordres du général Conneau. Il renforcera ainsi la puissance de feux du corps de cavalerie, au moment de la percée.). Pour le moment tout allait bien. La 6e division de cavalerie s'était emparée de Sarrebourg. C'était le 7e cuirassiers qui avait eu l'honneur de pénétrer dans la ville et de parcourir la rue principale sous les acclamations de la foule.
Les ponts de la Sarre, en particulier celui de Sarrebourg, étaient intacts. La Ire armée occupait le village de Bühl avec la cavalerie légère de la 6e D.C. Les deux autres divisions (2e D.C. et l0e D.C.) avaient alors été chargées de déblayer la rive gauche de la Sarre et d'en réduire les défenses.
En résumé, la rive droite de la rivière était largement débordée par Dubail. De surcroît, les ponts non détruits permettaient au gros du corps Conneau de franchir la Sarre. Au matin du 19 août, les conditions pour faire la percée paraissent remplies. Cependant, la 2e D.C., à Langatte, et la 10e D.C., à Haut-Clocher, se heurtent à un front défensif sérieusement organisé, avec une nombreuse artillerie. Cela donne à réfléchir au général Conneau.
Sous un tir précis d'obus de tous calibres les trois divisions du corps Conneau renoncent à franchir la Sarre (en aval de Sarrebourg) et leur chef obtient de faire stationner ses unités très fatiguées vers Gondrexange.
C'est là le seul point que nous voulons retenir.
Il trahit le manque de soins de notre cavalerie et l'état d'esprit de son chef. Prenons-en note.
Dès le 19 août, la cavalerie française de Lorraine est déjà épuisée sans avoir presque rien fait. Certes, les rencontres entre petites unités françaises et allemandes ont été nombreuses et toujours brillantes côté français, au cours des patrouilles de surveillance réciproques au voisinage de la frontière, mais aucune action importante n'a été engagée. Ni d'un côté ni de l'autre. Et cependant :
Déjà apparaissent dans nos divisions groupées des jours entiers dans les chaumes, sous le soleil torride d'août sans abreuvage le matin, les premiers symptômes d'un épuisement prématuré des chevaux. Les effets vont s'en faire terriblement sentir par la suite (La Cavalerie française dans la Guerre mondiale (1914-1918). F. Gazin. Payot éditeur.).
Il est permis de dire que chez nos adversaires la cavalerie allemande n'a pas été mieux que la nôtre traitée par ses chefs. Nous avons des éléments pour l'apprendre aujourd'hui avec le livre de von Posek : Rôle de la cavalerie allemande dans la Guerre mondiale, et surtout avec le Journal officiel des étapes et opérations du 1er corps de cavalerie allemand, lequel relate qu'à la date du 8 septembre la division de cavalerie de la garde se trouve dans un tel état de fatigue qu'elle est momentanément inutilisable.
Il s'agit du corps de cavalerie von Richthoffen. Le G.Q.G. français, instruit de cette situation par ses agents du S.R., a immédiatement prévenu le général Sordet, commandant le ler corps de cavalerie, de cette situation par note confidentielle spéciale du 11 août : deux régiments du corps de cavalerie allemand sont signalés à la Direction Suprême, par le commandant de ce corps lui-même, comme très éprouvés par La fatigue et la maladie. Ils sont épuisés, en particuliers les cuirassiers de la garde. A toutes fins utiles.
Inutilisables dès le 8 août ! C'était encore mieux que l'état de délabrement de la cavalerie française ! Mais il est juste de préciser que le corps de cavalerie von Richthoffen s'était, lui, usé et dépensé sans compter (donc inconsidérément) dès le 2 août, pour assurer l'exploration et la couverture de l'armée d'aile droite von Kluck. Il avait ainsi droit à des circonstances atténuantes auxquelles le corps Conneau ne pouvait prétendre.
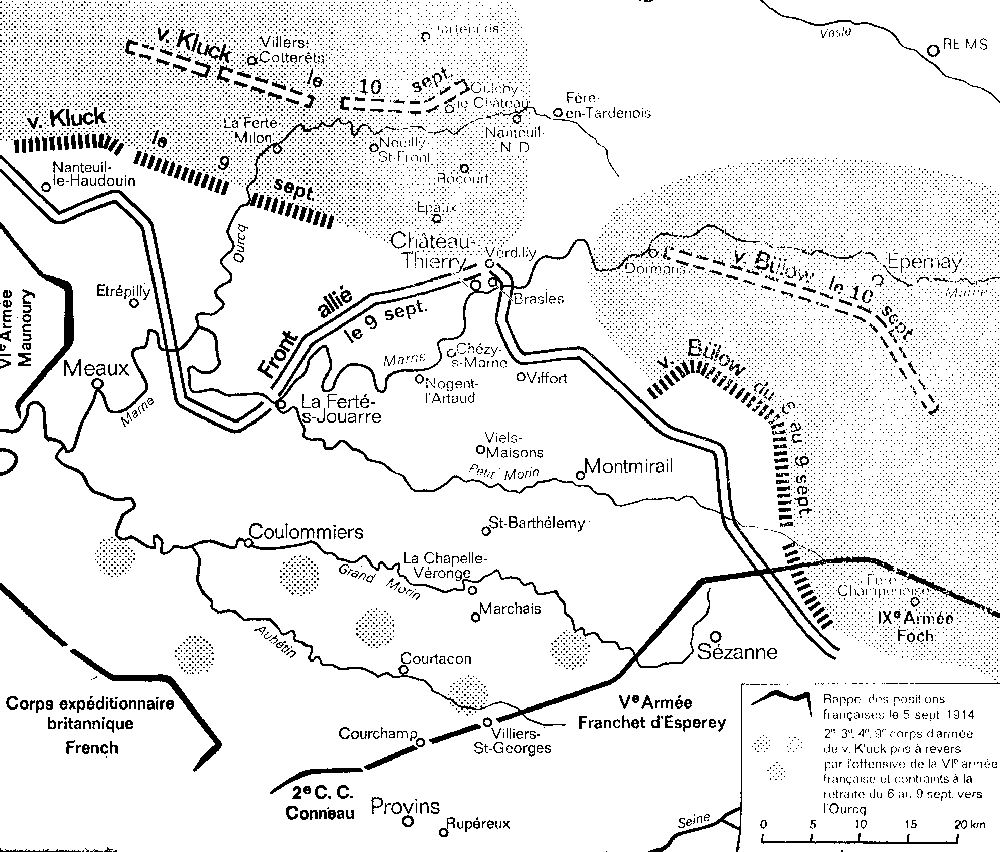
L'offensive de Gallieni oblige von Kluck, pris de flanc, à faire repasser deux de ses corps au nord de la Marne. Une grave déchirure s'ensuit entre les Ire et IIe armées allemandes
LE PILLAGE PAR L'ARMEE ALLEMANDE EN RETRAITE
Mais reprenons la lecture interrompue de mon carnet de guerre de cette période, sans en changer un seul mot.
Nous sommes toujours le lundi 7 septembre 1914. Il est 16 heures. Une nouvelle fois la 10e division reçoit l'ordre de monter à cheval :
Allons-nous enfin poursuivre ? Cette fois-ci, nous marchons ! La division en entier descend vers le ruisseau de l'Aubétin et le franchit au petit village de Courtacon. Un spectacle pitoyable et navrant nous y attend. Les Allemands avant de se retirer, ont brûlé toutes les maisons, toutes. Il en reste à peine six ou sept, aux murs calcinés et debout. Des scènes de pillages effroyables ont dû se produire.
Au milieu des ruines fumantes, des pans de murs noircis, il y a des restes, des vestiges épargnés qui attestent de la soldatesque teutonne.
Les soldats allemands se sont empiffrés, saoulés. On en trouve vautrés dans tous les coins, dans les vergers, ivres morts.
Par les fenêtres nous pouvons voir les lits renversés, les matelas déchirés, maculés, les armoires éventrées, brisées à coups de hache. Partout des torrents de linge, des verres, de la vaisselle en miettes. Ils ont tout saccagé par plaisir. C'est effarant et révoltant. Je ne pense pas qu'il s'agisse de cavaliers. Dans toutes les armées du monde, la cavalerie a un autre comportement, un autre état d'esprit.
Il y a des inscriptions à la craie sur toutes les portes en allemand en lettres gothiques, ou en français. L'une d'elles veut être ironique :
" Merci à l'excellente armée française du bon dîner qu'elle nous a laissés faire ! "
Dehors, dans le jardin est encore toute dressée une longue table. Le couvert est mis. Un drap de lit à servi de nappe. Un régiment de bouteilles vides, ou à moitié pleines, est aligné sur la table. Les fourchettes, les couteaux sont en place, aussi les verres... Dans les plats achèvent de se coaguler des restes dans la graisse figée.
Dans une branche de pommier est toujours accrochée une suspension de salle à manger. La mèche de la lampe brûle encore. De larges fauteuils de reps rouges, sortis d'une maison voisine, ont servi de sièges. C'était sûrement un dîner d'officiers.
Le bon dîner a été brutalement interrompu, les convives jetés dehors, les ivrognes ramassés, entassés dans un tombereau, prisonniers répugnants, déshonorant leur armée.
Le 20e dragons est en avant-garde de la division. Mon peloton est en pointe. Nous sommes les premiers à tout découvrir, à tout voir. Sur les bords de l'Aubétin, nous trouvons deux cadavres français,
celui d'un chasseur de notre groupe cycliste et celui d'un cavalier du 17e chasseurs à cheval (brigade de Contades). Les rares habitants restés dans le village incendié nous disent qu'ils étaient tous deux prisonniers et que les Allemands, au moment de se retirer, les ont sauvagement assommés à coups de barres de fer. Ce ne sont pas des hommes mais des bêtes. Les visages de ces malheureux sont en bouillie. La scène a dû être atroce.
Nous allons et venons à cheval dans les rues incendiées. Nous découvrons dans une cour de ferme un autre cadavre, attaché, les bras en croix, à un cep de vigne, contre le mur. C'est celui d'un gamin de quinze ans fusillé par les Allemands sous prétexte qu'il aurait dénoncé de leurs espions. Sa grand-mère, qui est restée, pousse en nous voyant de longs hurlements. C'est insoutenable.
Pendant toute la traversée du village en fourrageurs nous ne disons pas un mot. Nous regardons. Je sens que, derrière moi, mes hommes, pâlis par l'émotion, serrent plus forts leurs doigts sur la hampe des lances, qu'une haine sourde de ces barbares leur monte au cœur, un désir de vengeance. Quelques-uns, à la découverte de chaque détail, à chaque nouvelle horreur, serrent les dents et murmurent : " Les cochons ! Les bandits ! "
Quand, après la dernière maison, je rallie mes hommes et les remets en colonne, ils ne peuvent retenir leurs exclamations de fureur. Ils répètent : " Cochons ! Cochons ! Salauds de salauds ! Quand on les tiendra on le leur fera payer ! Voyous, bandits ! "
Tous les yeux lancent des éclairs. Cette colère est salutaire, elle excite mes hommes, Les rend plus mordants. Encore quelques spectacles comme celui-là et je ne pourrai plus les tenir, ils deviendront des lions !
Je me retourne en selle pour les voir derrière moi et je leur dis : " Vous voyez ce qu'ils sont venus faire chez nous, en France ! Ne l'oubliez jamais ! "
Ils ne disent rien, mais leurs regards me répondent. Il faudra bien qu'un jour nous allions, nous aussi chez eux, pour leur faire payer tous ces crimes ! Nous irons !
Nous débouchons de la route nationale de Paris à Esternay et rencontrons un convoi de blessés et de prisonniers allemands faits par le 18e corps d'armée. Ils sont entassés sur une charrette à foin. Quelques-uns sont debout, coiffés d'une sorte de bonnet plat et rond, à bandeau rouge. C'est leur coiffure de repos. Nous les croisons. Leurs regards sont mauvais, méchants. Ils ont de sales gueules.
Je dois intervenir pour que mes hommes, qui ont détaché de l'étrier le talon de la lance, ne les piquent pas au passage.
Nous traversons l'Aubétin et grimpons au trot la crête en face. Toujours pas un ennemi en vue. Nous continuons d'avancer, précédés de nombreuses reconnaissances. On a l'air d'avoir peur, gardés par un réseau de sécurité rapprochée très serré. On devrait foncer ! On verrait bien !
Le général Conneau passe près de nous. IL est escorté de deux escadrons de spahis marocains. Tiens, il est à cheval ! Il y a très longtemps que nous ne l'avions pas vu. Etant commandant d'un corps de cavalerie il circule en automobile. Il va ainsi beaucoup plus vite. Il trouve que ce n'est pas le cas de notre poursuite. Elle est trop lente à son gré et le dit, paraît-il, au général Grellet.
Il a vingt fois raison ! c'est honteux ! Ce n'est pas une poursuite mais une suite ! On suit l'ennemi. On dit que les chevaux sont fatigués. Ce n'est pas vrai. Depuis la Lorraine on ne fait qu'aller au pas. Cependant, l'observation à Grellet porte ses fruits. On augmente l'allure. Du pas on passe au trot. On s'arrête moins souvent.
A la nuit tombante, nous arrivons sur les hauteurs dominant la vallée du Grand Morin. Nous ne passerons pas cette rivière ce soir. Un bataillon d'infanterie ( 34e R.I. ) va, lui, la traverser, escaladera les crêtes en face, s'y établira pour nous assurer le débouché demain matin aux premiers rayons de l'aube.
Nous arrivons au village de la Chapelle-Véronge, où la brigade reçoit l'ordre de cantonner.
Ainsi, pendant une journée presque entière nous aurons soi-disant poursuivi sans donner un coup de sabre, sans voir un ennemi, sans avoir vu de l'armée allemande autre chose que des chevaux crevés, des objets jetés le long des routes, des boîtes de conserve et des bouteilles vides ! ! !
Nous l'avons suivie à la piste, oui ! Mais nullement poursuivie, non ! Et cette fois-ci cependant nous l'aurions pu. Tout nous le dit, les habitants, nos reconnaissances, les prisonniers.
Une occasion manquée ! Nous la retrouverons ! Le moral reste excellent, puisque malgré tout on marche en avant (Ces douze lignes de mon carnet de guerre, ponctuées de points d'exclamation, traduisent le cri d'indignation pris sur le vif de toute la 10e division de cavalerie contre le chef qui la maintenait dans l'inaction. Les hommes ne demandaient qu'à marcher ! Les chevaux aussi.).
La Chapelle-Véronge a été pillée mais non brûlée. Dans les maisons il ne reste rien, mais plus rien ! L'escadron cantonne en entier dans la cour immense d'une grosse ferme du village. Trouverons-nous quelque chose à manger ? Il fait nuit depuis longtemps. Dans l'ombre, nous devinons la scène de pillage qui s'est produite ici. Par terre, apparaissent des blancheurs qui sont des matelas, des draps de lit, des amas de linges, des serviettes, des pièces de vaisselle, des verres.
La lune se lève, pâle. Et sous sa clarté bleue se révèle toute l'horreur du drame. Les hommes ont trouvé des bougies et des lampes avec un reste de pétrole, on peut les allumer. A la lueur de ces lumières nous pénétrons dans les maisons. Les vitres sont brisées. C'est le même spectacle qu'à Courtacon.
Il nous faut enjamber des amas d'objets et de meubles fracassés, des torrents de linges répandus dans les chambres pour le plaisir de détruire, de casser, de salir. Des vêtements déchirés, des couvertures lacérées. Désordre impossible à décrire. Nos hommes sont hors d'eux-mêmes. Depuis qu'ils ont vu ce garçon de quinze ans fusillé à Courtacon, ils ne parlent que de vengeance, de massacrer les prisonniers qu'on fera.
Le capitaine de Langlois découvre l'unique veau échappé au pillage, emmené à l'écart dans un pré. Il le réquisitionne à ses propriétaires restés sur place. Bon de réquisition régulier, signé par le capitaine. L'escadron va pouvoir se nourrir.
A minuit, le lieutenant Verdier réussit à rejoindre avec ses fourgons (Train régimentaire du 20e dragons.). Distribution à peu près convenable de pain, viande, sucre et café. Avoine pour les chevaux.
Nous couchons dans la paille. Ça sent le Boche. Pendant ce temps, notre infanterie a grimpé les crêtes qui dominent au nord le Grand Morin. Notre débouché pour demain est assuré.
Mardi 8 septembre.
Je reprends ce journal pendant un repos de la division au milieu des champs. Ah, il est dur d'écrire en ce moment. J'essayerai d'avoir la persévérance de le faire, mais écrirai cependant moins de pages.
Nous avons passé le Grand Morin sur un pont de bois construit par les Allemands au moment de leur avance, puis abandonné dans leur fuite, comme l'indique une pancarte en allemand.
Nous suivons l'armée allemande à la trace. Ce n'est pas difficile. Tout le long des routes qu'elle a empruntées, gisent des bouteilles par milliers. Toutes celles qu'ils ont pillées dans les villages et bues en marchant. Et cette odeur indéfinissable du soldat allemand qui traîne derrière lui et que nous sentons comme des chiens de chasse.
Et ces volailles ! Ces volailles, ces poulets, ces lapins qu'ils n'ont pas eu le temps de plumer et de dépouiller et jetés ensuite dans les fossés. Les fossés en sont pleins.
Nous traversons le village de Saint-Barthélemy. Un spectacle tragique nous y attend.
Là, au cours de la retraite, le 4 septembre, le train régimentaire du 3e cuirassiers a été rejoint et détruit (par les cyclistes allemands armés de mitrailleuses) (Au dire des quelques habitants restés dans le village.). Sur toute la route, il y a des cadavres de chevaux qui empestent, déjà décomposés par le soleil. Les fourgons ont été renversés, éventrés, vidés. Tout autour, gisent pêle-mêle les objets les plus divers. Des cantines d'officiers ont été forcées, broyées
, leur contenu éparpillé sur le talus. Je vois, souillée de boue, puis étalée ostensiblement sur l'herbe la tunique à cinq galons du colonel commandant le 3e cuirassiers. Gisent aussi tout autour, pareillement exposées sur les talus, les tuniques de tous les officiers du 3e. Ah ! venger ces insultes, en faire autant un jour chez eux ! Ce jour viendra !
Aucun cadavre d'homme. Les habitants les ont pieusement enterrés. IL y a des croix, avec des noms. Saint-Barthélemy, nom prédestiné... La puanteur du charnier est insoutenable, elle soulève le cœur. Nous passons vite. Je compte au moins cinquante cadavres de malheureux chevaux mitraillés, peut-être davantage, gonflés, ballonnés, les jambes raidies vers le ciel. Des torrents de mouches !
Mais, Bon Dieu, allons-nous toujours suivre des épaves, au pas, au lieu de passer devant ! Au galop s'il le faut ! Fatigués, nous et nos chevaux ? Allons donc ! Indignés, oui ! Indignés d'être bridés, tenus en laisse !
L'église de Saint-Barthélemy a été occupée par les Allemands, la sacristie, vidée, les nappes d'autel souillées, profanées, ont servi de draps de lit sur la paille étendue dans l'église.
1 h du soir
Soudain, canonnade violente, intense dans la direction de Marchais, de Montmirail ( je situe sur la carte). Nous passons par Mondauphin et traversons le Petit Morin, dont les ponts ont été réparés par les sapeurs du génie. La 10e D.C. débouche ainsi dans un ravin étroit. Des shrapnells éclatent sur nos têtes. Sans mal. Ç'a ne dure pas.
Notre artillerie arrose terriblement Marchais et Montmirail. Elle les couvre de projectiles. L'artillerie allemande essaye de répondre mais est dominée. Elle n'insiste pas. Le général Franchet d'Espérey a la manière, lui ! Il fait avancer les canons. Les fantassins se sentent soutenus et même précédés. Le moral, si bas pendant la retraite, est complètement revenu.
2h50
Toujours canonnade terrible. La 1Oe D.C. n'agit toujours pas ! Elle est pied à terre sur la rive droite du Petit Morin. L'artillerie française tire par-dessus nos têtes. Le bruit est assourdissant.
Le général Chêne, commandant notre brigade, nous a égarés. Il ne sait plus où trouver la division. Il la retrouve enfin. Et de nouveau c'est le pied à terre général. A notre droite, vers Montmirail, le combat est de plus en plus violent. Il gagne en intensité. On entend les longues rafales de la mousqueterie d'infanterie.
- A cheval !
On a un instant d'espoir. Va-t-on marcher ? - Pied à terre !
Air connu...
Un orage épouvantable de pluie éclate sur nous. - Déroulez les manteaux !
Cela dure plus d'une heure. Nous sommes trempés jusqu'aux os. Nous sommes dans une terre labourée. Les sabots des chevaux grattent le sol vite détrempé. Cela tourne au marécage.
La nuit tombe. Le combat devient de plus en plus intense. L'arrière-garde allemande s'accroche sur la hauteur, mais on sent que la bataille tourne, à notre droite, à notre avantage. Nous ne pouvons rien voir. C'est cependant tout près, à moins de deux kilomètres.
6h30
Une longue clameur française : " Chargez ! à la baïonnette ! " Un frisson sacré passe sur nous. La pluie s'est arrêtée. Ah ! voir !
voir ! Prendre part au combat. Il y a cent ans, c'était ici même la victoire de Montmirail. La grande ombre de Napoléon hante ces lieux... 1814-1914, la campagne de France recommence ! Les nuages se déchirent. Pour un rien, il me semblerait entendre les cris de l'infanterie : - Vive l'Empereur !
La nuit nous enveloppe, puis une lueur sanglante barre l'horizon de l'ouest, comme une allégorie de victoire. Un grand silence à présent. L'arrière-garde allemande s'est bien battue. Elle a arrêté notre Ve armée durant plusieurs heures sur le goulet de Montmirail, puis notre infanterie l'a enfoncée.
C'est fini. Le silence. On n'a pas eu besoin de nous.
Nous montons à cheval enfin ! Mais pour rien... Pour nous en aller... Nous escaladons au pas les pentes nord du Petit Morin et atteignons par le village de l'Epine-aux-Bois le gros bourg de Vieils-Maisons, près de Marchais, où l'on s'est battu âprement. (Vieils-Maisons est sur la route nationale de Paris à Châlons-sur-Marne.)
Nous redescendons pour cantonner dans un très petit village, La Bénite, sur le bord du Petit Morin. Bivouac. Les chevaux à la corde dans une prairie mouillée par la pluie. Repas plus que frugal. Le train régimentaire fait des prodiges pour arriver jusqu'à nous. Mais il n'y a presque rien dans ses fourgons. Nous couchons, officiers et hommes, sur une mince couche de paille dans quelques maisons et granges. Odeur sauvage du soldat allemand.
Le ciel se découvre. La lune vient nous dire bonjour.
Mercredi 9 septembre.
A cheval et départ à 4 h 30. On avance. L'armée allemande accentue sa retraite. Elle a décroché pendant la nuit. Nous marchons nord-nord-est. Notre objectif est Château-Thierry, sur la Marne. Notre axe de marche est défini par Vieils-Maisons, Montcel-Enger, Ville-Chamblon, Viffort et grande route directe sur Château-Thierry.
A la mairie de Vieils-Maisons sont entassés plusieurs centaines de prisonniers allemands provenant du combat de la veille. On peut apercevoir par les fenêtres du rez-de-chaussée leurs têtes aux cheveux rouges. Presque tous les soldats allemands que nous avons eus devant nous, en Lorraine ou ici, ont ainsi les cheveux rouges. Ils n'ont pas changé depuis les Huns, depuis Attila. Même instinct dévastateur de pillage et de massacre. Ce n'est pas pour rien que leurs hussards de la Mort portent sur leur kolbak une tête de mort avec deux tibias entrecroisés.
Voici quelques nouvelles colportées sur l'engagement de la veille : Nous avons remporté une véritable victoire, à Marchais et à Montmirail, à cent mètres près du monument rappelant la victoire de 1814, comme je l'écrivais hier. Il paraît que les pertes allemandes sont considérables et les nôtres minimes. L'arrière-garde ennemie, qui s'était accrochée au terrain, s'est magnifiquement battue pendant un jour entier, puis à tombée de nuit, a finalement été rejetée vers le nord par un assaut très brillant de l'aile droite de la Ve armée. (Je songe aux débris du 18e R.I. rencontrés à Rupéreux le 5 au soir. Incroyable !)
Nous quittons Vieils-Maisons. A un carrefour, plusieurs fantassins français entassent une masse énorme de fusils allemands et de munitions. Nous les acclamons. Il y a là des centaines et des centaines de fusils, des milliers et des milliers de cartouches. Ah, ils n'en manquent pas !
Nous allons dans un champ. Pied à terre pendant une heure ! Nous donnons l'avoine aux chevaux.
A cheval ! Il paraît que nous devons aller directement à Château-Thierry et s'il le faut nous en emparer et franchir la Marne.
Enfin, on va faire quelque chose !
Cependant, la poursuite à la même allure que la veille, la même physionomie. Il fait un temps gris très agréable, bien plus que les chaleurs orageuses de ces derniers jours.
Je remarque le changement de physionomie de mes hommes depuis le 7 de ce mois. Ils sont transformés. L'ennemi recule ! Alors, tous, fantassins, cavaliers, artilleurs, redressent la tête, oublient la fatigue, les camarades tombés, les souffrances, le ravitaillement si souvent précaire. Le sourire est revenu. Les lazzis volent de bouche en bouche.
Au diable le pessimisme de ce capitaine du 18e de l'autre jour ! Où est-il ?...
4 h du soir
Un heureux hasard fait que nous venons de mettre pied à terre dans un grand chaume, à côté du 10e hussards, lui même pied à terre depuis un moment.
Le 10e hussards est le régiment où j'ai accompli trois années de services avant mon entrée à Saumur. J'y compte beaucoup d'amis et de camarades parmi les officiers et les sous-officiers.
Je vais d'abord saluer le colonel de Rascas de Châteauredon, toujours à la tête du régiment. Il a été pour moi d'une extrême et amicale bienveillance. Sa poignée de main est solide et affectueuse :
- Quelle joie de vous revoir, cher ami, et en campagne de guerre ! Je vous ai toujours suivi, vous savez, à Saumur, puis dans votre nouveau régiment, je sais que vous êtes très aimé au 20e dragons. J'en ai été heureux et ça ne m'étonne pas !
Le colonel de Rascas est toujours le même, vif et alerte, un vrai cavalier. Le 10e hussards est bien commandé !
C'est le régiment de corps du 18e corps d'armée, chargé d'assurer son éclairage et sa sûreté éloignée et rapprochée.
Les paroles du colonel de Rascas me vont au cœur. C'est un vrai chef, lui ! Il m'apprend que le 22 août, sa mission étant de couvrir la retraite du 18e corps, le l0e hussards a eu une rencontre avec le 1er cuirassiers de la garde du 1er corps de cavalerie allemand. Ça a été très vif. Trois escadrons du 1er cuirassiers contre deux escadrons du 10e hussards. Des pertes des deux côtés.
Je vais serrer la main des lieutenants Quiot, de Sevin, de Camaret et des maréchaux des logis d'Astanières, Milhade, de Lur-Saluces, Surchamp, Labédan, Dubédat, d'autres...
Quelle joie de revoir tant d'amis ! Mais j'apprends la mort de chics types parmi eux, tués au cours de la rencontre, laquelle a eu lieu à Etroeungt (Nord) . Vidal tué, Tardieu tué, Bergès tué, Bertrand de Falguières blessé.
C'est le 2e peloton du 2e escadron (celui où j'ai justement servi pendant deux ans) qui a été le plus éprouvé. Le régiment a perdu quarante-cinq hommes et quarante-deux chevaux. Le 1er cuirassiers allemand davantage. Les hussards ont ramené cinquante chevaux de prise.
Un officier du 1er cuirassiers, blessé et prisonnier, a déclaré " que la supériorité du petit sabre courbe de ces hussards du midi de la France, était manifeste. Ces petits hussards montés sur leurs chats arabes, armés de ce petit sabre bien manié, ont fait grand mal à nos cuirassiers armés de la longue lance allemande et haut perchés sur nos gros chevaux. "
Ce fut en effet une brillante attaque au sabre. Elle fait honneur à mon ancien régiment. Nous, nous n'avons pas encore eu cette chance.
Je demande si mon ancien cheval Mi-Carême est toujours là ? Oui, il est toujours là. Il a chargé à Etroeungt. Il est indemne. Je vais l'embrasser, aux applaudissements des camarades. M'a-t-il reconnu ? Oui il m'a semblé.
A l'odorat peut-être...
On n'imagine pas la subtilité de l'odorat du cheval. Il reconnaît toujours son cavalier entre mille autres, même longtemps après, à l'aide de son seul odorat.
Nous avons, chacun, pour notre cheval, comme une sorte de carte d'identité olfactive.
Il ne l'oublie pas.
En vue de Château-Thierry. Magnifique amphithéâtre, avec au fond de la vallée, la ville que traverse la Marne. Mais comme il sera difficile de passer, si l'ennemi s'est établi sur les hauteurs qui bordent cette vaste cuvette !
Mais il paraît qu'il n'y est pas. Nos reconnaissances rentrent. Elles signalent cependant que le pont central sur la Marne paraît barricadé et mis en état de défense. Par des traînards sans doute. Du haut des crêtes, je fouille à l'aide de mes jumelles. L'escadron est en soutien de notre groupe d'artillerie de la 10° D.C. J'aperçois sur les hauteurs dominant la rive droite de la Marne quelques cavaliers aux uniformes gris. A la première salve de nos 75 ils se dispersent au galop en fourrageurs et disparaissent.
Mais nos canons entrent en action plus vive et envoient une centaine d'obus sur la patrie de La Fontaine, en particulier sur le jardin public, shrapnells (obus à balles, c'est-à-dire fusants, qui ne font pas de dégâts). Le but de ce tir est d'attirer le feu des batteries ennemies qui pourraient être dissimulées dans les environs et se trahiraient ainsi d'elles-mêmes. Et aussi pour impressionner les traînards laissés par les Allemands pour défendre La ville et ralentir notre avance.
LE 20e DRAGONS, AVEC L'APPUI DU 15e, ENLEVE CHATEAU-THIERRY
5 h du soir
Il s'agit pour nous d'enlever Château-Thierry et de passer la Marne. Le premier demi-régiment (1er et 2e escadrons) du 20e Dragons est désigné pour attaquer directement la ville par le pont central, barricadé mais non sauté. Les premiers éclaireurs sont accueillis à coup de feu. Ils ripostent vivement. Les aspirants Dumont-Saint-Priest et d'Ussel se distinguent au cours de l'assaut. Le capitaine Riondel est blessé d'une balle à l'épaule et doit être évacué. Blessure heureusement peu grave.
Le 1er groupe de Chasseurs Cyclistes arrive à la rescousse. Le pont est enlevé à la baïonnette. Les défenseurs sont faits prisonniers. Parmi eux, des infirmiers à brassard de la Croix-Rouge. Ils risquent d'être fusillés pour avoir pris les armes. Cela ne nous regarde pas. On les emmène vers l'arrière, qui décidera.
Pendant ce temps, mon peloton est chargé d'attaquer la gare et de s'en emparer au combat à pied. Le capitaine de Langlois m'accompagne. Affaire facile et vivement menée. Quelques traînards tirent et tentent de s'enfuir. Nous faisons quelques prisonniers, une dizaine, dans le bureau portant l'inscription : " Sous-chef de gare ". Ça me fait un drôle d'effet, cette gare vide, ces wagons immobiles et abandonnés, ces quais déserts, abandonnés.
Le maréchal des logis Mardelle, avec deux cavaliers, fait sortir d'un wagon de 1re classe trois Allemands hirsutes et titubants. Ils lèvent les mains, terrorisés. Ils sont avinés et ne comprennent rien. Mais ils sont satisfaits et rient, rassurés, lorsque je leur crie : " Gefangene ! " Ils n'opposent aucune résistance. Au contraire. Ils se hâtent de se mêler à nous.
Nous rejoignons nos chevaux tenus en main derrière la gare des marchandises. A cheval ! C'est fait, Château-Thierry est pris. Aucune perte à mon peloton. Je n'ai eu qu'un homme dont le talon de botte, tandis qu'il courait, a été enlevé par une balle. Comme Napoléon à Ratisbonne. C'est tout. Je le lui dis. Il rit.
Château-Thierry pris, la 10e D.C. tout entière fait son entrée à cheval dans la ville, 20e Dragons en tête. C'est justice. La patrie du bon La Fontaine est sens dessus dessous. Les habitants sont sortis de leurs caves, où ils s'étaient terrés. On nous applaudit, on pousse des exclamations. Château-Thierry a été occupé pendant six jours par l'ennemi, beaucoup de maisons pillées, mais non incendiées. Les portes sont criblées d'inscriptions à la craie en caractères gothiques allemands. J'en lis plusieurs portant " Gute Leute ". Braves gens ! Cela compromet les habitants de l'immeuble. Ils ont donc bien accueilli les Allemands ? Bon à savoir !
Des femmes nous jettent des fleurs. Les sabots de nos chevaux écrasent des géraniums, des sauges, des reines-marguerites et des glaïeuls lancés par brassées. Ma jument Ma-Zaza porte de chaque côté de la tête deux bouquets de dahlias qu'un homme a voulu absolument lui attacher au frontail. Elle en a l'air toute fière.
Les chasseurs cyclistes fouillent les caves maison par maison. Ils en ramènent parfois des prisonniers, pas tellement nombreux. En général hébétés, indifférents à ce qui se passe. Beaucoup sont ivres.
Les cavaliers sont fêtés, on leur distribue au passage du pain, du vin, des fruits, du chocolat, des cigarettes. On crie : " Vive la France ! Vive le 20e Dragons ! "
Nous faisons figure de vainqueurs. A ce prix-là ce n'est pas difficile ! Si cela doit durer ainsi jusqu'au bout !... Ça ira ! Maintenant, on marche, on marche, on avance ! Je me rappelle les vers de Victor Hugo :
... Poussé par le grand bruit vivant Que font les pas humains quand ils vont en avant.
Comme c'est vrai ! On se sent porté par le succès, par la gloire, même éphémère.
Mais voici tout un groupe de prisonniers faits dans le jardin en terrasse. Peut-être deux cents. Ils ne se sont même pas battus, attendant la fin du combat. Ils se manifestent à présent. Il y a de tout, des fantassins, des uhlans, des chevau-légers, des artilleurs.
D'autres ont été trouvés cachés jusque dans des armoires, derrière les vêtements d'hommes ou de femmes.
Le soir tombe. La brigade Chêne, cette fois le 15e Dragons en tête, escalade les pentes à la sortie de Château-Thierry, vers la campagne.
Il fait encore grand jour. On sent qu'il n'y a rien devant nous, ou presque ! Pour que l'ennemi nous ait laissé passer la Marne si facilement, il faut qu'il n'ait pas grand-chose à nous opposer.
Des reconnaissances d'officiers rentrent. Elles n'ont vu personne. L'une d'elles cependant a été accueillie à coups de feu derrière le mur de clôture d'un château. Deux chevaux tués. Les deux cavaliers rentrent dans nos lignes, à pied, portant les selles sur la nuque, la carabine en sautoir, la lance et le sabre dans les mains. C'est le règlement : le cavalier démonté doit rapporter le harnachement.
J'interroge au passage les deux cavaliers. Ils sont du 15e Dragons. Ils n'ont rien vu. Reconnaissance d'officier. L'officier est indemne. Le capitaine de Léobardy l'appelle pour lui faire rendre compte. C'est de son escadron. Je ne sais pas ce qu'ils disent.
La 10e division de cavalerie pourra écrire sur ses étendards : Château-Thierry en lettres d'or. Et maintenant ?
Nous attendons un ordre de poursuite, car il n'y a devant nous qu'un faible rideau tendu par l'ennemi, sans doute des cavaliers au combat à pied. La preuve est faite.
Nous recevons l'ordre de redescendre vers la Marne et d'aller cantonner à Brasles, au bord même de la rivière... Je dois prendre les avant-postes avec mon peloton au château de Brasles, avec son parc clos de murs d'où ont été tirés les coups qui ont tué les deux chevaux du 15e Dragons.
Je fais fouiller le château et le parc. Tout est vide. Sur un endroit d'une pelouse, l'herbe est piétinée par des fers, un amas de crottin. C'était bien des cavaliers. Trois ou quatre, pas plus. Ils ont déguerpi.
La lune se lève, énorme et ronde sur l'horizon boisé. J'ai placé un réseau de vedettes, à pied et à cheval.
Le brigadier Viacroze m'apporte un pigeon qu'il a tué, sans descendre de cheval, posé sur une branche, d'un coup de lance. Ça ne m'étonne pas. Viacroze est le meilleur de mes lanciers. Premier au concours des bagues, au mois de mai. C'est loin... Saudin se débrouille au jardin potager, découvre des petits pois en cosses, les écosse : " Mon lieutenant, vous allez le manger aux petits pois ! " Il est tout heureux.
A 10 h du soir, je dîne en plein air derrière la barricade que j'ai fait dresser sur le chemin conduisant à Brasles. Pigeon un peu dur. Petits pois aussi, mais le cœur y est. J'invite le maréchal des logis Souquet, le brigadier Viacroze et le cuisinier Saudin.
Il fait très doux. C'est idiot, cette barricade ! L'ennemi ne viendra sûrement pas ! Il est en pleine retraite et ne pense qu'à ça ! C'est à nous d'aller l'attaquer par une attaque de nuit, au clair de lune, et le mettre en pagaille. Mais ça, il n'en est pas question...
C'est la pleine lune. On y voit comme en plein jour. On pourrait faire une attaque à travers champs, même à cheval, s'il le fallait. Il nous faudrait un général qui ait du cran. Le nôtre est malade, paraît-il... Malade de quoi ?... C'est fou d e ne rien faire ! Seule, l'inaction est infamante, dit le règlement de cavalerie. Que doit penser de nous l'ennemi derrière ses barricades ? Il a dû en faire, lui aussi. Peut-être tout près d'ici ?
Nous attendons le jour...
IL ne s'est rien passé pendant la nuit. Il ne pouvait en être autrement. L'ennemi est en retraite après l'affaire de Montmirail et de Château-Thierry. Comme la 10e D.C. n'a pas fait mine d'exploiter notre succès, il est trop heureux qu'on le laisse tranquille. Il n'en demandait pas tant. Il se défile. Il n'y avait pas de chances qu'il vienne rôder à nos barricades (comme au mois d'août en forêt de Parroy). C'était à nous d'aller bousculer les siennes. Mais alors ça, il n'y faut pas compter...
Journée insignifiante. C'est bien simple. Nous ne faisons rien. Mais absolument rien, si ce n'est d'avancer par bonds successif s de 500 m dans un vide total, sans rien rencontrer et de descendre de cheval pendant des heures entières. IL est vrai que la 1Oe D.C. qui hier était en première ligne à l'avant-garde du C.C.C. est aujourd'hui en réserve derrière les deux autres, 8e et 4e D.C.
Pourtant, sur notre gauche, pendant la matinée, gronde une assez vive canonnade. L'armée anglaise a enfin passé la Marne, hier au soir, en aval de Château-Thierry. Elle l'a franchie à Chézy-sur-Marne et à Nogent-l'Artaud, sous la protection de notre avance. Ce doit être son artillerie qui, en ce moment, entre en action contre les arrière-gardes allemandes.
Quant à l'aile gauche de la Ve armée, que nous protégeons, je ne sais pas... Elle est à notre droite, sans doute vers Dormans. Il n'y a personne devant nous. Nous sommes seuls, les trois D.C.
La canonnade ne dure pas longtemps. L'ennemi décroche sans doute en vitesse.
Nous sommes envoyés (3e et 4e escadrons du 20e Dragons) en reconnaissance offensive sur la droite de la division. Mission : fouiller les bois de Verdilly qui s'étendent autour du château du même nom. Il y aurait des traînards ennemis attardés dans les taillis et les fermes. Une reconnaissance qui passait par là a essuyé des coups de feu, ce matin.
Nous partons. Il pleut. Après le beau clair de lune de cette nuit, le ciel s'est couvert. Les éclaireurs reviennent et rendent compte que le château de Verdilly est inoccupé. Nous fouillons consciencieusement les couverts environnants. Rien. Le vide. Pas un coup de feu. Pas un cavalier.
Les domestiques, restés au château pendant l'occupation de quelques jours, nous disent que c'étaient des cavaliers habillés de gris, peu nombreux, qui étaient là (des uhlans semble-t-il) environ quatre-vingts - la valeur d'un escadron - répartis entre Verdilly et Epieds. Ils nous montrent d'énormes ballots d'argenterie et d'objets de valeur pillés dans le château, prêts à être chargés et emportés dans une charrette. Mais un des leurs est venu leur dire que la cavalerie française approchait, alors ils ont déguerpi comme des lapins.
Un cavalier de la brigade Sauzet passe près de nous. Il porte un renseignement important : plusieurs groupes de cavaliers (encore des uhlans probablement) étaient à Epieds, il y a une heure. Epieds est un village sur la route de Fère-en-Tardenois, à 2 kilomètres à peine de l'endroit où nous sommes.
A 2 heures du soir, nous rejoignons la division, elle est toujours pied à terre dans le champ où nous l'avions laissée. C'est tout ce qu'elle a fait.
LA GRAVE INACTION DU CORPS DE CAVALERIE CONNEAU
Mais pendant ce temps que se passe-t-il sur le plan général ? A notre échelon nous ne pouvons évidemment que l'ignorer. Nous le saurons plus tard. Sans que le G.Q.G. ait déjà pu le discerner de manière certaine, la situation empire rapidement pour l'ennemi.
Cependant, la VIe Armée (Maunoury) éprouve de la difficulté à contenir la Ire Armée allemande, qu'elle a attaquée de flanc direction sud-ouest, nord-est. Von Kluck a réagi aussitôt avec intelligence. Il a fait repasser une partie de ses forces du sud au nord de la Marne. Il allonge de plus en plus son aile droite et prétend arriver à envelopper l'aile gauche de Maunoury. Or, c'est présomption et imprudence de sa part.
Au sud de la Marne, la Ve Armée et l'armée britannique (W) ( (W) : sigle d'abréviation adopté pour l'armée britannique.) continuent d'avancer tout en se laissant ralentir - trop - par des arrière-gardes ennemies. Les Anglais ont atteint la Marne à La Ferté-sous-Jouarre, mais ne la traversent pas. Comme ils sont lents ! Hésitants !
La Ve Armée se bat à la soudure des Ire et IIe Armées allemandes. La manœuvre risquée de von Kluck a eu pour conséquence de provoquer un vide dans le dispositif allemand. Le G.Q.G. français informé le signale aussitôt à Joffre. Celui-ci adresse, le 8 septembre à 20 heures, une instruction spéciale n° 19 à ses armées d'aile gauche. La voici :
I. - Les forces allemandes se sont repliées en se scindant en deux groupements distincts :
- l'un qui paraît comprendre le 4e corps de réserve, les 2e et 4e corps actif s. Il combat sur l'Ourcq, face à l'ouest contre notre VIe Armée et cherche à la déborder par le nord
- l'autre comprend le reste de la IIe Armée allemande, c'est-à-dire les 3e et 9e corps actifs et les IIe et IIIe armées allemandes. Ce groupement est opposé à nos Ve et IXe armées (Plus exactement : détachement d'armée Foch, récemment créé et inséré sur le front entre les Ve et IVe armées (de la gauche à la droite).).
La réunion entre ces deux groupements paraît n'être assurée que seulement par plusieurs divisions de cavalerie, soutenues par des détachements de troupes de toutes armes. Ceci en face de l'armée britannique.
II. - Il paraît essentiel de mettre hors de cause l'aile droite allemande avant qu'elle ne puisse être renforcée par d'autres éléments que la chute de Maubeuge a pu rendre disponibles (Maubeuge vient en effet de capituler le 8 septembre au soir, étant assiégée par un corps d'armée allemand à deux divisions de réserve (d'ailleurs de médiocre valeur)). Ce sera la mission de la VIe Armée et des forces britanniques.
A cet effet, la VIe Armée maintiendra devant elle les troupes qui lui sont opposées sur la rive droite de l'Ourcq. Les forces anglaises franchissant la Marne entre Nogent-l'Artaud et la Ferté-sous-Jouarre, se porteront sur la gauche et les derrières du groupement ennemi engagé sur l'Ourcq.
III. - La Ve armée couvrira le flanc droit de l'armée britannique et dirigera à cet effet un fort détachement sur Azy, Château-Thierry.
Le corps de cavalerie Conneau, franchissant la Marne, au besoin derrière ce groupement et derrière les colonnes anglaises assurera d'une manière effective la liaison entre l'armée britannique et la Ve armée.
A sa droite, la Ve armée continuera à appuyer l'action de la IX` armée (Foch), en vue de permettre à cette dernière de passer à l'offensive, le gros de la Ve Armée marchant droit vers le nord et refoulant au-delà de la Marne les forces qui lui sont opposées.
Le 9 septembre au matin, côté allemand, von der Marwitz et von Richthoffen, que ni Kluck ni Bülow n'ont eu l'idée de réunir sous un même commandement (ce qui eût été du ressort de von Moltke, chef de la Direction Suprême) n'arrivent pas à ressouder un front continu.
A 8 heures, Marwitz a été rejeté au nord de la Marne, mais tient encore la rive droite à la boucle de Nanteuil ( 6 kilomètres N.-E. de La Ferté-sous-Jouarre), c'est-à-dire jusqu'au confluent de l'Ourcq.
A midi, le rideau tendu par Richthoffen pour défendre Château-Thierry est crevé sur la route de Rebais par la brigade des Quinze-Vingt ( 15e et 20e dragons). Les deux divisions de Richthoffen, coupées l'une de l'autre, doivent céder précipitamment le terrain, la 5e D.C. droit au nord, en repassant la Marne, la division de la garde vers le nord-est dans le prolongement de l'aile droite de von Bülow.
" Tout l'espace circonscrit par la route de Coulommiers à La Ferté-sous-Jouarre, le cours de la Marne et la route de Château-Thierry à Montmirail se vide alors d'ennemis (Histoire de la Guerre mondiale, p. 296, général Duffour, Payot éditeur.) . "
C'est la conséquence de la prise de Château-Thierry par le 20e Dragons. Une brèche s'est ouverte dans le dispositif allemand. Ce vide, que connaît Joffre depuis la veille, vient de singulièrement s'aggraver.
On est le 9 au soir. Le S.R. français a fait son métier, le G.Q.G. de Joffre est admirablement renseigné. Il est vrai de dire que les opérations se déroulant en zone française ses agents sont comme des poissons dans l'eau.
Quand on est cavalier et qu'on relit aujourd'hui à tête reposée cette Instruction Spéciale n° 19 de Joffre adressée dans la nuit du 8 au 9 septembre à ses armées de gauche et au corps de cavalerie Conneau, on reste saisi :
Que dit-il à Conneau ? Il lui enjoint de traverser la Marne (ce sera fait dans l'après-midi du 9 à Château-Thierry) et d'assurer d'une manière effective la liaison entre l'armée britannique et la Ve armée.
Et c'est tout ! Tragiquement tout ! Toujours et encore la liaison ! Constante préoccupation, souci majeur de tous les instants ! Pas un mot au sujet de la poursuite ! Ordre malencontreux, ordre catastrophique, car il porte en germe toute l'inaction de Conneau.
Nous n'irons pas jusqu'à dire que, cet ordre, Conneau l'attendait, mais il faut bien constater qu'il le reçoit sans réagir et qu'il va l'exécuter à la lettre, c'est-à-dire sans lui insuffler cet esprit qui devrait être le sien : l'esprit cavalier.
Comment est-ce possible ? Le général en chef lui apprend officiellement ce que Conneau aurait dû savoir par lui-même par ses reconnaissances et ses détachements de découverte, c'est-à-dire que les forces allemandes se sont repliées en se scindant en deux groupements distincts et que leur réunion paraît n'être assurée que seulement par plusieurs divisions de cavalerie soutenues par des détachements de troupes de toutes armes. Ceci, en face de l'armée britannique.
Joffre ajoute même, intention capitale :
Il paraît essentiel de mettre hors de cause (c'est-à-dire attaquer et détruire) l'aile droite allemande avant que.. etc.
Et Conneau reste impassible, serein et inactif !
Il a reçu cette instruction dans la nuit du 8 au 9 septembre (elle a été signée à 20 heures, puis diffusée depuis Bar-sur-Aube, où le général Joffre a transporté son quartier général) et il n'a pas bondi ! Il s'est contenté d'acquiescer et d'assurer le lendemain la liaison entre l'armée W et la Ve armée. Il n'a pas fait remarquer au commandant en chef que ce n'est là qu'une banale opération de routine de liaison et qu'il y a mieux à faire, qu'il est prêt à bousculer ces divisions de cavalerie allemandes soutenues par des détachements de toutes armes (signalées comme très fatiguées). Il a, lui aussi, trois divisions de cavalerie appuyées d'un régiment entier d'infanterie. Ce sont des forces considérables. Tout ce monde ne demande qu'à s'engager et ronge son frein depuis la proclamation du 6 septembre du général commandant en chef.
La cavalerie en a assez d'attendre que s'ouvre le trou, le fameux trou, dans les lignes allemandes. Or, ce trou vient de se produire et les escadrons brûlent de s'y précipiter, d'inonder le terrain au nord de la Marne, de faire irruption sur les derrières de von Kluck, lequel a dû faire pivoter sa Ire armée sur sa gauche, la mettre en potence, en crochet défensif, sur une ligne sud-nord, pour résister à l'offensive de la VIe Armée de Maunoury.
On touche là vraiment à un moment capital de la bataille, un moment capital de la guerre. Si Conneau, le 10 septembre au matin, s'engageait à fond dans la trouée large d'une quarantaine de kilomètres qui s'est creusée devant lui (du fait que von Kluck a dû prélever deux corps d'armée sur sa droite pour les ramener à gauche face à Maunoury, ouvrant ainsi lui-même une brèche dans le dispositif allemand) il surgirait dans le dos de la Ire Armée allemande prise en sandwich entre deux feux, celui de face de Maunoury et celui de revers de l'aile gauche de Franchet d'Espérey (le 18e corps de la Ve Armée) et des 5 divisions d'infanterie et des 20 escadrons de cavalerie d'Allenby de l'armée britannique, lesquels ne pouvaient manquer de s'engouffrer dans la zone ouverte par le corps Conneau assurant leur débouché en direction d'Oulchy-le-Château et de Neuilly-Saint-Front.
![]()
CHAPITRES SUIVANTS DE L'OUVRAGE DU GENERAL CHAMBE : ADIEU CAVALERIE
![]()
MENU DE LA BATAILLE DE LA MARNE VUE PAR LE GENERAL CHAMBE
![]()
MENU DES RESPONSABLES ET ECRIVAINS FRANÇAIS
![]()
RETOUR VERS LE MENU DES BATAILLES DANS LA BATAILLE
![]()
![]()