ADIEU, CAVALERIE !
La Marne, Bataille gagnée ... Victoire perdue
14 et 15 septembre 1914, le saillant de Sissone
![]()
14 et 15 septembre 1914, le saillant de Sissone
LE CORPS CONNEAU N'A RIEN DEVANT LUI
Mais rien de tout cela ne se produira. Le corps de cavalerie Conneau s'arrêtera le 9 septembre au soir, le nez devant la brèche ouverte. Il passera toute la nuit sur place, alors que le magnifique clair de lune est si beau qu'il invite à s'engager à cheval à travers champs comme en plein jour. Un temps formidable est ainsi perdu. Et le 10 septembre, il en sera de même pendant toute la journée !
Je n'en veux pour preuve que les quatre premières lignes déjà citées mais que je souligne encore ici de mon carnet de guerre de ce jour-là. Les voici :
Jeudi 10 septembre.
Journée insignifiante. C'est bien simple. Nous ne faisons rien, absolument rien, si ce n'est avancer par bonds de cinq cents mètres et descendre de cheval pendant des heures entières.
C'est là un document indiscutable, tangible, écrit noir sur blanc sur place, il témoigne de l'inaction du corps Conneau.
Journée insignifiante, alors que le sort de la guerre se joue devant nous, à ce même moment !
COMMENT S'EXPRIME L'HISTORIQUE DU CORPS DE CAVALERIE CONNEAU REDIGE SOUS LA HAUTE DIRECTION DU GENERAL CONNEAU
Il est instructif de voir comment s'exprime après coup l'historique du corps de cavalerie Conneau relatant cette fin de journée du 9 septembre et cette journée du 10. Comment explique-t-il cette attitude passive (Historique du corps de cavalerie commandé par le général Conneau. (Rédigé sous la haute direction du général Conneau.) Charles-Lavauzelle et Cie, éditeurs, Paris.) ?
Nous citons :
9 septembre.
La 10e division, entrait, tard dans la soirée, à Château-Thierry, où elle faisait quelques prisonniers.
Le corps de cavalerie n'atteignait qu'à la nuit le plateau d'Etrepilly, trop tard pour attaquer les arrière-gardes allemandes dont il reprenait le contact sur la ligne Etrepilly-Bezuet. Il stationnait ses gros sur la Marne, entre Château-Thierry et Chézy.
Cette rédaction mesurée contient d'abord des inexactitudes et plus loin un aveu.
Ce n'est pas tard dans la soirée que la 10e division est entrée à Château-Thierry, mais tôt dans l'après-midi. A 5 heures ( 17 heures, comme l'on dit aujourd'hui) le combat est fini depuis longtemps. La 10e brigade de dragons, qui a pris la ville, remonte à cheval, parcourt la rue principale sous les acclamations de la population délivrée, puis se hâte d'escalader le plateau qui domine la ville au nord, sur la rive droite. Elle assure ainsi le débouché de la 10e Division et du corps de cavalerie qui suivent par-derrière.
Il fait encore grand jour sur le plateau d'Etrepilly-Bezuet. La nuit est loin d'être tombée. Des coups de feu accueillent les éclaireurs du 15e Dragons sur la route qui monte très fort vers le village de Verdilly. Nos chasseurs cyclistes se déploient et ripostent.
Le 15e Dragons a eu un cheval tué, les cyclistes un blessé. Les cyclistes entourent le village et ramènent un prisonnier. C'est justement un chasseur cycliste de cavalerie allemand. Il fait toujours grand jour. La pleine lune monte de derrière une haie, énorme et toute jaune.
Il semble qu'il n'y ait rien devant nous. Le vide est impressionnant.
L'ordre arrive de la 10e D.C. de mettre pied à terre et d'attendre la répartition du stationnement. On ne va pas plus loin: La lune est déjà haute, lorsque parvient l'ordre de la division de cantonner en amont de Château-Thierry et de se couvrir par des avant-postes.
C'est ainsi que je suis envoyé au Château de Brasles. Voilà la vérité. J'étais là.
L'aveu est qu'au lieu de pousser au nord, même de nuit, tout le corps de cavalerie Conneau s'est laissé intimider par une faible fusillade et a préféré redescendre sur les bords de la Marne pour y passer la nuit. C'est insensé !
Mais continuons la lecture de l'historique du corps de cavalerie. Que dit-il sur cette journée du 10 septembre, que mon journal qualifie d'insignifiante, alors qu'elle aurait pu être si riche de conséquences.
Voici :
10 septembre
L'ordre n° 497 de la Ve armée oriente la poursuite dans la direction d'Oulchy-le-Château, en avant du front de l'armée qui s'établira au nord de la Marne et serrera ses corps sur leurs avant-gardes en vue du mouvement du 11. A la gauche du corps de cavalerie, l'armée anglaise s'établira de même sur le Clignon.
Le général Conneau (ordre daté de Chézy-sur-Marne, le 10 septembre, 1 heure du matin) prescrit aux divisions de se trouver rassemblées à 6 heures dans la région Bouresches-Chantemerle, couvertes par de fortes reconnaissances.
En fait, ce rassemblement ne pouvait avoir lieu qu'à 9 heures , par suite de nécessités absolues de ravitaillement, hommes et chevaux en ayant été privés la veille.
Le général commandant le corps de cavalerie prescrivait à la 4e division, soutenue par des bataillons d'infanterie en camions, d'orienter sa poursuite sur Soissons, par Epaux, Rocourt, Oulchy-le-Château ; à la 8e, soutenue par un bataillon d'infanterie en camions, d'orienter sa poursuite sur Braine par Fère-en-Tardenois ; à la 10e, de se porter sur la route de Soissons, prête à prolonger à gauche l'action de la 4e et à déborder les résistances qui l'arrêteraient.
Il importe de poursuivre l'ennemi avec la dernière énergie, sans lui permettre de souffler. (Ordre de Château-Thierry (sortie nord) le 10 septembre, 8 h 15.)
A 14 h, après une poursuite que l'épuisement des chevaux ne lui permet pas de pousser activement, la 4e est au-delà d'Oulchy-le-Château dont elle a tourné la résistance ; à 17 h, elle a atteint Hartennes et talonne l'ennemi. Un retour offensif de ce dernier fait reculer ses bataillons et ses escadrons qui s'arrêtent sur la ligne Plessier-Huleu-Grand Rosoy.
La 10e, retardée devant Verdilly, est trop éloignée pour pouvoir lui prêter son concours. Le général Conneau, dont le P.C. est à Oulchy-le-Château, la presse vivement de marcher sur Oulchy-la-Ville.
La 8e, arrêtée à 13 h entre Courpoil et La Croisette et à 14 h devant les lisières de la forêt de Fère, atteint au soir, Fère-en-Tardenois.
Le corps de cavalerie stationnait à Oulchy-Ville, région Hartennes-Oulchy-Ville (4e division), région d'Oulchy-le-Château (1Oe), région Fère-en-Tardenois (8e).
La rédaction de cette journée du 10 septembre est ambiguë. Elle trahit un embarras certain. Il faut convenir qu'après l'injonction qu'il a reçue la veille de Franchet d'Espérey commandant la Ve armée aux ordres duquel Joffre l'a placé depuis plusieurs jours, le général Conneau n'a pas de raison de se montrer particulièrement fier.
Depuis que la Marne a été franchie hier dans l'après-midi toute une nuit et tout un jour se sont écoulés. Le corps de cavalerie stationne ce soir sur la ligne générale Oulchy-le-Château - Fère-en-Tardenois, c'est-à-dire à même pas vingt kilomètres plus au nord. Il est bloqué par un rideau de cavalerie qu'il n'a pas osé déchirer afin de nettoyer tout le plateau circonscrit par la boucle de l'Ourcq, où von Kluck, cependant pris à revers, tient toujours tête à Maunoury. Les éléments les plus avancés de Conneau se sont arrêtés fatigués sur la rocade ouest-est de Villers-Cotterêts à Fère-en-Tardenois devant Saint-Rémy-Blanzy-le Plessier-Huleu-Beugneux.
On est loin de l'ordre, semblable à une proclamation, déclarant que l'ennemi doit être poursuivi avec la dernière énergie, sans lui permettre de souffler. C'est le C.C.C. qui souffle. Il perd son temps en de sordides problèmes d'intendance (ravitaillement) ou de fatigue des chevaux.
En 1806, après Iéna, que pesaient ces mêmes problèmes pour le corps de cavalerie de Murat et de la brigade de hussards de Lasalle, au cours de leur fougueuse poursuite jusqu'à Stettin et Koenigsberg et jusque dans les îles de la Baltique ? L'esprit cavalier y suppléait. Murat et Lasalle étaient des chefs jeunes et impétueux. Tous leurs colonels avaient l'âge de lieutenants ! Cent ans après, toute la différence est là. Elle se fait cruellement sentir.
Franchet d'Espérey a bien tenté de pousser Conneau au-delà de la simple mission d'assurer d'une manière effective la liaison entre l'armée britannique et la Ve Armée donnée par Joffre dans son instruction spéciale n° 19. Il l'a engagé à saisir toutes les occasion d'attaquer et de détruire l'ennemi. Mais Conneau ne paraît pas tellement pressé. Il a en poche les instructions les plus récentes du commandant en chef et les appliquera : " Assurer la liaison ", etc.
Or, Franchet d'Espérey a reçu une nouvelle instruction particulière de Joffre postérieure à celle du n° 19, elle porte le n° 20. Datée du 9 septembre à 22 h, elle est enregistrée sous le n° 4 440.
Corrigeant la regrettable insuffisance de ses directives concernant le corps Conneau, Joffre rectifie et, cette fois, précise : Le corps de cavalerie Conneau, opérant avec le 18e corps, prendra contact avec l'ennemi et cherchera toujours à percer dans la direction générale d'Oulchy-le-Château.
Le général Joffre y voit très clair, il suit son idée de lancer des forces dans le dos de von Kluck et de le prendre en tenaille entre Maunoury, d'une part, et Franchet d'Espérey et les Anglais, d'autre part.
Oulchy-le-Château est le point crucial, le lieu géométrique de la bataille qu'il faut absolument livrer et gagner ! Joffre le sait bien. Il n'y a d'ailleurs qu'à regarder la carte : l'Ourcq décrit une vaste courbe englobant le plateau du Tardenois, couvert de moissons et de villages. Oulchy-le-Château, sur la rive droite, marque en quelque sorte le sommet de la courbe, le verrou qu'il faut tirer. Kluck sera pris. Car, le 9 septembre, Kluck, entêté, n'a pas encore flairé le danger. Il maintient la majeure partie de ses forces sur la rive ouest de l'Ourcq, prétendant non seulement tenir tête à Maunoury, mais parvenir à envelopper (aùfrollen) son aile gauche. Il espère réussir et s'attarde sur le champ de bataille. II ne veut pas tenir compte du vide qu'il a de ses propres mains provoqué et creusé derrière lui. Richthoffen et Marwitz suffiront bien à l'aveugler avec leurs carabines et leurs sabres ! Moltke ne les a-t-il pas d'ailleurs renforcés avec des détachements de toutes armes ?
Von Kluck a le tempérament d'un joueur. Le jeu, il aime ça ! Il manie admirablement ses cartes, mais Joffre, à Bar-sur-Aube, y voit clair dans son jeu. Von Kluck devrait payer cher l'imprudence qu'il a commise de dégarnir sa gauche au profit de sa droite, d'ouvrir ce hiatus de quarante kilomètres entre son armée et celle de Bülow.
Oulchy-le-Château, percer en direction d'Oulchy-le-Château, y parvenir et tirer le verrou ! C'est l'obsession, d'une clarté limpide ! Joffre compte sur ses lieutenants pour parachever la manœuvre. C'est sur la cavalerie que le destin va faire peser le sort de la bataille du Tardenois. Pour une fois, pour la dernière fois peut-être, la cavalerie va pouvoir user de la seule arme qui lui reste, la seule que les progrès de la science et de la technique ne lui ont pas encore arrachée : sa relative vitesse par rapport aux autres armes sur le champ de bataille.
Par une incroyable et mutuelle aberration, les hauts commandements allemand et français n'ont pas commis avant 1914 l'avantage décisif offert par le transport automobile. Le haut commandement allemand est le plus coupable de manque de clairvoyance, parce qu'il avait voulu cette guerre, l'avait minutieusement préparée et fait déclarer à l'heure de son choix.
Imagine-t-on ce que serait devenue la bataille des frontières livrée le 22 août en Belgique, si la Ire Armée allemande, celle de von Kluck, avait été motorisée, son infanterie transportée en voitures automobiles, utilisant à plein débit le réseau routier, alors que l'armée de Lanrezac et l'armée anglaise ne pouvaient se déplacer qu'avec les jambes de ses fantassins ?
C'est bien simple, il n'y aurait jamais eu de retraite, ni de bataille de la Marne. Tout se fût terminé le 30 août dans les plaines de Saint-Quentin, la gauche française et l'armée anglaise tournées en quelques heures, enveloppées, ligotées, disloquées, écrasées en une seule journée, la France et l'Angleterre battues, l'Allemagne victorieuse. Mais l'état-major allemand, soi-disant le premier du monde, n'en était pas, heureusement, à une bévue près. Celle de l'imprévoyance dans l'emploi du transport motorisé des troupes en campagne a été la plus lourde.
Quoi qu'il en soit, ce jeudi 10 septembre, au point du jour, le général Conneau qui, depuis la veille mercredi 9 septembre, à la tombée du soir, et toute la nuit du 9 au 10, a déjà tenu le sort de la bataille, le tient encore en main. Tout dépend de lui, de son esprit de décision. Il s'agit de faire vite ! Ne le sait-il pas ? Ne le voit-il pas ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Conneau n'enflamme pas ses escadrons.
A Franchet d'Espérey qui, au téléphone brandit et commente l'instruction n° 20 de Joffre, et le presse une nouvelle fois d'agir, il répond (ce qu'il va confirmer par écrit par une lettre adressée à Franchet d'Espérey, datée du 10 septembre à 22 h et enregistrée à l'arrivée sous le n° 2 950) :
- J'ai eu l'honneur de vous signaler, il y a trois jours, que la limite extrême des hommes et des chevaux était atteinte. Je crains bien qu'elle ne soit maintenant dépassée.
Cependant nous irons jusqu'au bout, jusqu'au dernier cheval s'il le faut.
Conneau.
Tout ceci est très exagéré. Depuis qu'on a repris l'offensive le 6 septembre, c'est-à-dire depuis quatre jours, le corps de cavalerie est resté presque inactif, sauf, hier, à Château-Thierry (et encore les chevaux sont-ils restés tenus en main, tandis que les hommes combattaient à pied. Les chevaux n'ont donc pu se fatiguer). Le reste du temps, la cavalerie n'a avancé qu'avec une extrême lenteur, dans les jambes de l'infanterie, marchant soit au pas, soit s'arrêtant pour mettre pied à terre, durant des heures interminables.
L'infanterie couvre de lazzis et de moqueries les cavaliers qui, arrêtés, la regardent les dépasser. Cette inaction est telle que beaucoup d'officiers, les jeunes surtout, en sont indignés et discutent entre eux à ce sujet.
Fatigués, les chevaux ?
Relisant mes carnets de route, j'y relève ce passage, justement à la date du 10 septembre :
En attendant l'ordre de stationnement, nous sommes dans un grand espace où pullulent les lapins de garenne. Nous laissons nos cavaliers les poursuivre à cheval à coups de lance. Quelques lapins sont tués. L'ordinaire de l'escadron en sera amélioré. Ce ne sera pas de trop.
Nous cantonnons à Nanteuil-Notre-Dame, après être revenus derrière l'Ourcq...
Et voilà..., le témoignage est pris sur le vif, irréfutable. Pendant ce temps, Joffre, commandant en chef, est persuadé que nous perçons sur Oulchy-le-Château, à la poursuite ardente de l'ennemi.
Pendant ce temps, Franchet d'Espérey reçoit le factum grandiloquent de Conneau : Je crains que la limite extrême des hommes et des chevaux ne soit maintenant dépassée. Cependant nous irons jusqu'au dernier cheval, s'il le faut.
Pendant ce temps, von Kluck, qui a pris conscience du péril, décroche et déménage son armée, fourgons et bagages compris, vers le nord-est en direction de Soissons et de l'Aisne.
Pendant ce temps, Richthoffen et Marwitz, à l'aide du rideau, ténu comme une toile d'araignée, qu'ils ont construit sur la rocade Villers-Cotterêts - Fère-en-Tardenois, masquent la retraite de Kluck et contiennent sans peine la poussée d'un ennemi décidément très peu mordant (C'est l'adversaire qui parle.). (General-Leutnant von Poseck. Inspecteur de la cavalerie allemande Die Deutsche Kavallerie in Belgien und Frankreich, pages 113 à 122.)
Dans trois jours, nous retrouverons von Kluck accroché solidement sur la falaise du Chemin des Dames.
Quel jeu joue donc le général Conneau ?
D'aucuns ont émis l'hypothèse qu'il a été très frappé par le limogeage de Sordet, relevé de son commandement à la suite de la ruine de son corps de cavalerie (Dont Joffre lui-même était en partie responsable. Ne se rendant pas compte de l'effort que cela imposait aux chevaux, il avait donné l'ordre direct à Sordet (alors que Sordet était aux ordres de Lanrezac, chef de la Ve armée, qui l'employait à son gré et lui donnait de son côté ses instructions) de pousser jusqu'au nord de Namur et de s'y montrer, pour rassurer les Belges.
Le gouvernement belge, angoissé par la chute de Liège, avait en effet décidé de se mettre à l'abri à Anvers. Joffre avait peur que toute l'armée belge suivît cet exemple. Il voulait l'éviter à tout prix.).
Conneau tiendrait-il à conserver le sien en état de fraîcheur, d'où l'extrême timidité de sa poursuite ?
Pourquoi ne serait-ce pas vrai ?
QU'AURAIT FAIT NAPOLEON A LA BATAILLE DE LA MARNE ?
Une première étude critique du comportement du général Conneau et du rôle joué par son corps de cavalerie au cours de la bataille de la Marne a été établie par un général de cavalerie, le général de Cugnac.
Cette étude, publiée naguère par la Revue de Paris, aujourd'hui disparue, n'est pas tendre - disons-le tout de suite - pour le général Conneau.
L'auteur commence par se poser une question : Qu'aurait fait Napoléon à la bataille de la Marne ?
Pour y répondre il s'appuie sur le livre déjà ancien, très documenté, très médité, d'un autre général, le général Camon, Quand et comment Napoléon a conçu son système de bataille (Berger-Levrault, édit.).
Le général Camon rappelle, en préambule à son ouvrage, l'exemple historique de la bataille de Prague de Frédéric II, le Roi-Soldat, exemple bien connu, cité et étudié chaque année tant à l'Ecole de guerre française que dans la plupart des académies de guerre allemandes et étrangères
Le 6 mai 1757, Frédéric II, roi de Prusse, ayant déclaré la guerre à l'Autriche, rencontre à l'est de Prague les forces autrichiennes commandées par le maréchal Brown.
Jusqu'alors toutes les batailles se résument à une rencontre de face des armées, front contre front. C'est la plus solide, la plus disciplinée, la mieux armée, encadrée des officiers et bas-officiers les plus vaillants qui l'emporte et reste maîtresse du champ de bataille. La bataille est gagnée ou perdue. On ne cherche pas midi à quatorze heures. L'armée qui a le mieux résisté au choc, infligé le plus de pertes à l'adversaire est victorieuse. C'est l'époque du sacro-saint ordre perpendiculaire. Front contre front, c'est tout. Tout est très simple. Pas de manœuvres compliquées, superflues. Le terrain a son importance. On cherche à tenir la position haute et à forcer l'adversaire à combattre en position basse. C'est tout le fin du fin de la tactique. Sur deux rangs, la troupe recharge son arme, tandis que le premier rang, qui a tiré, passe derrière le second qui, arme croisée, soutient le choc de l'infanterie et de la cavalerie et permet au premier rang de charger son fusil. C'est l'origine du carré, cher au premier Empire.
Frédéric II, tacticien plus subtil, inaugure à Prague l'emploi de l'ordre oblique. Celui-ci consiste à attaquer d'abord non pas le centre mais l'aile de l'adversaire. Ce dernier, neuf fois sur dix, réagit en prélevant sur son centre une partie de ses moyens, pour renforcer son aile attaquée. Alors il est perdu. Frédéric II n'attend que ce moment. Il prononce son effort principal sur le centre de la ligne adverse imprudemment dégarnie et amenuisée et la coupe en deux.
Ainsi, à Prague le 6 mai 1757.
Le maréchal Brown a établi sa ligne sur une position haute, sa gauche appuyée aux faubourgs de Prague, que Frédéric II ne peut tourner.
La matinée se passe en fusillade de part et d'autre sans résultats spectaculaires. Au milieu de l'après-midi, Frédéric II détache de son gros un contingent suffisamment important sous les ordres de son lieutenant principal Schewrin. Il prescrit à Schewrin de décrire un vaste arc de cercle sur le champ de bataille, pour venir prononcer une menace d'attaque sur l'aile droite de Brown. C'est le concept de la diversion. Manœuvre inusitée, contraire à tous les usage,.
Brown, surpris mais non encore inquiet, renforce alors son aile droite à l'aide d'éléments prélevés sur son centre, fort bien pourvu et très cohérent. Sa ligne centrale s'allonge ainsi, en même temps qu'elle s'affaiblit.
Frédéric II, lunette en main, ne peut s'empêcher de sourire. Brown allonge son aile, alors il est perdu. Frédéric II a vu les prélèvements opérés sur le centre autrichien. Mais le centre autrichien ne l'intéresse pas encore. Ce qui l'intéresse, c'est le point de soudure de l'aile droite la raccordant au centre. Il y lance avec détermination les bataillons qu'il a conservés à cet effet. L'aile droite de Brown est écrasée, coupée du dispositif. Elle s'est mise en potence, en crochet défensif, pour mieux s'opposer à l'assaut de Schewrin. Le centre de Brown, au voisinage de l'aile droite, est devenu trop faible pour résister au choc décisif de Frédéric II. L'armée autrichienne est mise en pièces. Prague est une éclatante victoire prussienne. Une ère nouvelle s'ouvre en stratégie et tactique, celle de l'ordre oblique. Ce terme géométrique s'applique imparfaitement à la manœuvre inaugurée par Frédéric II à Prague. Il s'agit plus, en langage plus simple, d'attaque d'aile, d'attaque de flanc.
Napoléon, grand admirateur de Frédéric II, s'est penché sur le problème. Il a étudié la solution la meilleure à lui donner. Ne peut-on améliorer, perfectionner celle du Roi-Soldat ?
Napoléon la perfectionne. L'idée de Frédéric II de conserver durant la bataille un contingent réservé pour le choc final ne lui suffit pas. Il veut y ajouter l'effet de surprise toujours si payant.
C'est ainsi qu'à Bautzen le 21 mai 1813, il commence par fixer sur la Sprée la ligne prusso-russe, commandée par Blücher. Il amuse le tapis, pourrait-on dire, à l'aide d'un minimum de forces placées sous ses ordres directs, voltigeurs, tirailleurs et grenadiers. Il aveugle Blücher sur ses intentions. Dans le même temps il envoie Ney avec la valeur d'un corps d'armée prononcer ostensiblement par un vaste mouvement tournant une menace d'attaque contre l'aile droite russe. Celle-ci clame au secours et demande du renfort.
Blücher, oubliant l'enseignement de Prague, dégarnit son centre, il en amenuise la ligne, pour satisfaire son allié. Napoléon découple alors le corps d'armée de Soult préparé et amené secrètement dans ce but depuis le matin dans un repli de terrain, où il se dissimule.
C'est la surprise et la victoire de Bautzen, en Saxe, exemple typique de la stratégie napoléonienne.
Moins exemplaire de ce point de vue, cette manœuvre a été huit ans auparavant l'immortelle victoire d'Austerlitz mais elle procède de la même pensée.
Le 1er décembre 1805, dans la nuit, Napoléon recule volontairement son front au plateau de Pratzen, dans le dessein de donner le change aux états-majors des deux empereurs (Allemagne et Russie) et de les amener à combler ce vide qu'ils jugent avantageux d'occuper. Mais ils ne songent pas qu'ils étirent en même temps dangereusement leur propre dispositif. Et le lendemain 2 décembre, se lève le soleil de l'immortel Austerlitz.
Quoi qu'il en soit, si Napoléon a remporté nombre de ses victoires en provoquant lui-même l'allongement donc l'affaiblissement de la ligne de bataille de l'adversaire à l'endroit choisi par lui, il n'a jamais, au grand jamais, vu l'adversaire créer volontairement un vide dans son front. Il n'a jamais eu cette chance.
Cent ans plus tard, Joffre, lui, va l'avoir, cette chance, à la bataille de la Marne. Qu'en fera-t-il ?
Pour l'instant, rejoignons le général de Cugnac. Supposons avec lui qu'à la place de Joffre, Napoléon se fût trouvé sur la Marne au soir de ce 9 septembre 1914.
Disons tout de suite qu'une telle hypothèse n'est qu'un jeu de l'esprit. N'est-il pas absurde de vouloir établir une comparaison entre le passé et le présent, entre le rêve et la réalité ? Non, ce n'est pas absurde. Une telle comparaison repose sur des éléments positifs qui ne sauraient varier avec le temps et seront toujours d'actualité. On doit en tirer des leçons pour l'avenir.
Un commandant en chef, dès l'échelon d'armée, doit toujours, quoi qu'il arrive, conserver par-devers soi une réserve de forces à ses ordres directs, destinée à lui permettre à toute heure d'intervenir sur le champ de bataille. C'est également vrai pour les trois armes, Terre, Mer et Air. Le chef doit garder avec lui une part valable de son effectif avant de l'engager dans le combat.
A l'échelle napoléonienne, cette réserve de forces atteignait toujours l'effectif d'un corps d'armée. Selon les circonstances, elle s'est appelée Ney, Soult, Oudinot ou Gérard. Cela suffisait. A l'échelle de la bataille de la Marne, son effectif aurait dû s'élever à deux corps d'armée, au minimum.
La bataille ne se livrait plus à portée de voix et de lorgnette, mais par T.S.F. et à l'aide d'une multiplicité de téléphones. Les limites du champ de bataille n'étaient plus celles d'un chef-lieu de canton visibles sur le terrain même, mais celles de tout le nord-est de la France épinglées contre le mur de la salle des cartes.
Napoléon avait en permanence avec lui son corps d'armée qui ne le quittait pas et aussi - cela va sans dire - le corps de cavalerie de Murat ou de Lasalle tenu dans son ombre, contre sa botte. Un mot de lui, un geste et le tonnerre se déchaînait, le grondement de vingt mille sabots labourant le sol, ponctué des cinq mille éclairs des sabres jaillis hors des fourreaux. Le 9 septembre, Joffre, général en chef, n'a rien de tout cela dans les mains pour intervenir dans la bataille. Rien dans les mains, rien dans les poches ! Il peut bien les sonder désespérément (ses poches), les retourner jusqu'au tréfonds, il n'en tombera pas une division, pas un régiment, pas un bataillon. Il a tout donné, tout distribué, tout dépensé.
Il n'y a pas à lui adresser de reproches. Il a bien pensé à se constituer une masse de manœuvre réservée à ses ordres personnels, située en position centrale sur le théâtre d'opérations. Il y a non seulement pensé mais l'a virtuellement réalisé.
Le gros de l'affaire devant se développer vers la gauche et le rôle des armées de droite ne présentant plus d'immédiate importance, Joffre y a prélevé précisément deux corps d'armée. Le 21e corps a été enlevé à la Ire Armée (Dubail) et le 15e corps à la IIe (Castelnau).
Ces deux corps d'armée, transportés par voie ferrée, étaient prévus pour être débarqués vers Château-Thierry, dès le 7 septembre, c'est-à-dire au plus près de la zone cruciale, leur emploi strictement réservé au généralissime. C'était parfaitement prévu, parfaitement logique. Mais le Dieu des batailles seul dispose...
En certains points du front, la lutte devient rude, très rude. Il n'y a pas que chez l'ennemi que se produit des brèches, une première s'est ouverte en Champagne Pouilleuse, au camp de Mailly, entre la gauche de la IVe Armée (de Langle de Cary) et la droite du détachement d'armée Foch (bientôt baptisée IXe Armée). Elle mesure près de vingt kilomètres. Ce n'est pas encore inquiétant mais déjà préoccupant. Les fluctuations d'une ligne de bataille aussi longue ne sauraient être évitées, mais leurs déchirures demandent à être au plus tôt réparées par des points de suture.
Langle de Cary et Foch ont fait appel en même temps au chirurgien en chef. Celui-ci a répondu à leur demande et rapproché les lèvres de la plaie. Il a colmaté la brèche du camp de Mailly à l'aide du 21e corps, premier utilisé.
Quant au 15e corps, c'est à Sarrail, nouveau commandant de la IIIe Armée, qu'on l'a donné. Une lézarde s'est produite à Révigny, au voisinage de l'Argonne.
Si bien qu'au matin du 9 septembre, à l'heure utile, Joffre n'a plus rien à lancer sur les arrières de von Kluck sur le plateau de Fère-en-Tardenois.
Des critiques militaires ont objecté que laisser s'ouvrir une brèche à Révigny ne présentait pas une importance aussi impérative que l'intérêt de détruire l'Armée von Kluck. En foi de quoi, il eût convenu de conserver le 15e corps, de le laisser arriver jusqu'à Château-Thierry et de l'utiliser pour la destruction de la Ire Armée allemande. Quel bénéfice y avait-il à interdire à l'ennemi de remporter un succès limité sur un point quelconque du front, alors qu'on l'aurait anéanti dans son ensemble par une victoire décisive sur un autre point intelligemment choisi ? Joffre n'aurait-il pas manqué d'appréciation ? Ne se serait-il pas laissé distraire de l'opération principale par des détails ?
L'argument a sa valeur, mais Joffre pouvait rétorquer qu'avec le 18e corps, jumelé avec le corps de cavalerie Conneau, il avait avec lui le moyen d'éliminer la Ire Armée allemande. S'il avait manqué de juste appréciation, c'était pour avoir surestimé la valeur personnelle du général Conneau. Là, il était d'accord. Le général Conneau devrait porter devant l'Histoire la grave responsabilité d'avoir, par son inaction, par sa carence, permis à von Kluck de se tirer d'affaire le 10 septembre et d'avoir sauvé son armée en la faisant déménager vers le nord-est par le couloir de Soissons.
Plus tard on pourra dire que la contre-offensive de Joffre (et de Gallieni) aura été une magnifique et incontestable victoire française. Mais ne devra-t-on pas dire que le rétablissement de von Kluck derrière l'Aisne aura été aussi une victoire, une victoire défensive, certes, mais une victoire allemande ?
L'armée française, en retraite, a réussi à échapper à la destruction sur la Marne. L'armée allemande, en retraite, a réussi à échapper à la destruction sur l'Aisne.
La Marne et l'Aisne s'équilibraient. Tout était à refaire. Cela allait durer près de cinq ans.
A la bataille de la Marne, Napoléon, avec son oeil d'aigle et sa rapidité de décision, n'aurait pas manqué de jeter le corps du général de Maud'huy ( 18e C.A.) dans la brèche ouverte entre Bülow et von Kluck. Il l'eût fait précéder d'un tourbillon de cavalerie chargé de déchirer le dérisoire rideau tendu par Richthoffen et Marwitz pour retarder sa marche. Cavaliers contre cavaliers, que de belles actions, que de grisantes rencontres en perspective pour les descendants, d'un côté comme de l'autre, de ceux de la grande mêlée de Ville-sur-Yron, le 16 août 1870 !
Iéna, Austerlitz, Ville-sur-Yron, Murat, Lasalle, tout cela appartenait au passé ! Le présent était le présent ! Conneau se serait défendu en déclarant que Murat n'aurait pas fait mieux que lui avec des chevaux aussi fatigués que les siens. Fallait-il en conclure que sous le premier Empire la cavalerie savait mieux entretenir et soigner ses chevaux ?
La vérité n'était pas là. La vérité était que le 10 septembre 1914, à la bataille de la Marne, rien n'eût été changé, même avec de bons chevaux. Conneau n'était pas Murat et Grellet n'était pas Lasalle.
Si mon propre carnet de route fait foi de la déception de la 10e Division de cavalerie d'avoir été maintenue sur les bords de la Marne le 9 septembre au soir, au lieu d'être poussée en avant, je tiens à produire ici les notes rédigées au même moment par un autre acteur et témoin : le capitaine de Léobardy, commandant le 4e escadron du 15e Dragons (le fameux Noailles-Cavalerie).
On pourra peut-être reprocher à mes notes la sévérité et parfois l'outrance de mes critiques, sous le coup de l'indignation. J'ai cependant tenu à les présenter telles quelles, pour leur conserver leur caractère de spontanéité, de franchise et d'authentique fraîcheur. Si l'on peut adresser le même compliment aux notes du capitaine de Léobardy, on ne saurait leur faire le moindre reproche. Plus âgé que moi, d'esprit pondéré, mûri par la responsabilité d'un commandement déjà important, ses notes prises sur le vif témoignent de la carence du corps de cavalerie Conneau et de son chef, au cours des journées capitales des 9 et 10 septembre 1914. Ces notes m'ont été communiquées par des camarades et des parents à lui quand ils ont su que je travaillais à ce livre et avais l'intention d'ouvrir le procès du corps de cavalerie Conneau à la bataille de la Marne.
Je reproduis ici les notes du capitaine de Léobardy dans leur texte intégral. Elles ont à mes yeux valeur de document sacré. Comme les miennes, je me garderais d'en modifier une seule virgule. Les voici :
Le 9 septembre, la 10e D.C. s'empare de Château-Thierry qui est pris par les 15 et 20e Dragons, vers 6 h du soir (Je rappelle encore une fois que les 15e et 20e Dragons (mon régiment) formaient ensemble la 10e brigade de dragons, la légendaire brigade des Quinze-Vingt, laquelle venait de s'emparer de Château-Thierry.).
Plusieurs escadrons envoyés en avant-poste sur les hauteurs de la ville ont pu s'y installer tranquillement sans être inquiétés par l'ennemi et passer ainsi la nuit. Le corps de cavalerie Conneau faisait, paraît-il, de la " poursuite ". Il aurait semblé normal qu'après être entrés dans Château-Thierry vers 6 ou 7 h du soir, nous eussions reçu l'ordre de continuer notre marche en avant. On aurait ainsi gagné une dizaine de kilomètres.
Mais pas du tout ! Notre 10e D.C. reçoit l'ordre de s'arrêter et le 15 Dragons cantonne à Château-Thierry, ce 9 septembre !
Le général Conneau, avec son corps de cavalerie (trois D.C.) ne devait-il pas pousser de l'avant et ne pas s'arrêter sur la Marne ? Il est facile de critiquer après coup. Tout de même ! A Château-Thierry, la résistance s'était révélée assez légère et sur les hauteurs au nord les réactions étaient insignifiantes.

Von Kluck a reçu l'ordre de battre en retraite avec sa Ire armée. D'avis contraire, il bat en retraite, mais trop au nord. La déchirure s'aggrave entre Kluck et Bülow. Toutes les conditions sont alors remplies pour une grande victoire décisive. Mais la cavalerie et la Vème armée française ne poussent pas dans la brèche. Non plus que les Anglais.
Sans doute le général Conneau avait-il des excuses. Les chevaux de tous les régiments étaient extrêmement fatigués, il n'avait que peu de renseignements, etc. Bref, il n'a pas osé aventurer sa cavalerie et resta aligné sur l'infanterie. Et cependant quel beau coup de filet c'eût été si nos régiments avaient continué plus avant et plus rapidement ! La liaison aurait pu être faite avec la division de cavalerie de Cornulier-Lucinière (C'est tout ce qui restait du 1er corps de cavalerie (corps Sordet) usé prématurément en Belgique. Avec les débris de ce corps, on avait pu reconstituer une seule division, dite division de cavalerie provisoire. C'était la 5e D.C. Le commandement en avait été confié à un général resté jeune, très dynamique, le général de Cornulier-Lucinière. Cette division, lancée sur l'ordre de Gallieni, avait pour mission de tourner l'aile droite de l'armée von Kluck, de se rabattre si possible sur ses arrières, de faire entendre son canon sur l'Ourcq et derrière l'Ourcq, de jeter le désordre partout où il serait possible d'intervenir, de créer un climat d'insécurité et de panique chez l'ennemi. La division de cavalerie provisoire allait accomplir un travail considérable avec un magnifique élan. Les épisodes qui resteront dans les annales seront : La destruction d'une escadrille d'avions allemands, en lisière de la forêt de Villers-Cotterêts, par l'escadron de Gironde, par une charge de nuit, à la lance, contre cette escadrille surprise au repos. L'héroïque lieutenant de Gironde serait tué, avec plusieurs officiers et dragons (16e dragons), dans cette glorieuse aventure. Un autre épisode fut l'attaque par un escadron du 15e chasseurs (escadron de Fraguier) du propre état-major du général von Kluck, chef de la Ire armée allemande. II s'en faillit d'un rien que von Kluck fût capturé en personne. Von Kluck a raconté cet épisode dans ses Mémoires. C'est aussi la charge de l'escadron Wallance, du 15e chasseurs, à Chouy, sous un feu intense, les innombrables poursuites, galopades, fusillades, canonnades, coups de sabre et de lance contre un adversaire en nombre six fois supérieur, mais qui s'énerve et s'inquiète de ce vacarme, de ces incursions sur son flanc et ses arrières et perd son moral.) (5e D.C.), qui venait des environs de Compiègne, direction ouest-est par la forêt de Villers-Cotterêts et qui, le 9 septembre, n'était qu'à 20-25 kilomètres de notre 10e D.C.
On prenait à revers l'armée von Kluck tout simplement !
Après la prise de Château-Thierry, on s'est bien aperçu le lendemain et les jours suivants, qu'il y avait un trou entre les Ire et IIe armées allemandes (trou de 20 à 25 kilomètres) et, hélas, un corps de cavalerie qui était fait pour ça n'a pas profité de cette belle aubaine !
Le 9 septembre 1914, le 15e Dragons est donc installé à Château-Thierry en cantonnement, oui, " en cantonnement ".
Le lendemain 10 septembre, plusieurs escadrons sont envoyés en découverte. Le 15e Dragons doit envoyer un escadron en découverte sur Fère-en-Tardenois. C'est le 4e escadron, le mien (de Léobardy). Nous marchons toute la journée sans rencontrer aucune résistance sérieuse, ce qui prouve qu'il existe bien une brèche entre les Ire et IIe armées allemandes (A lire ces notes du capitaine de Léobardy on ne peut se défendre d'un doute : que veut-il dire quand il écrit " ce qui prouve qu'il existe bien une brèche entre les Ire, et IIe armées allemandes ", ? L'a-t-il su, parce que Joffre en avait averti ses commandants d'armée et le général Conneau par son instruction spéciale du 8 septembre, que Conneau a reçue dans la nuit du 8 au 9 (l'avant-veille !) et qu'il a sans doute diffusée, comme il le devait, dans toutes ses unités ? Ou bien, Léobardy n'ayant rien su par cette voie, ce qui serait quand même un peu fort, veut-il dire que ce 10 septembre avançant, au matin sur le plateau au nord de Château-Thierry avec son escadron, il reçoit par lui-même confirmation de l'impression de vide qu'il avait ressentie personnellement la veille, à tombée de nuit, sur ce même plateau ? Le doute est permis....).
Deux incidents à signaler :
A quelques kilomètres au nord de Château-Thierry, un petit détachement de cyclistes embusqués derrière une meule de paille tirent sur nous et nous blessent trois chevaux. Ils s'éclipsent dès que nous arrivons.
Plus tard, pendant que l'escadron est installé dans un village pour faire reposer et manger bêtes et gens, arrive subitement une auto ennemie, qu'on a cru être une automitrailleuse, mais qui n'était en réalité qu'une auto ordinaire. Elle était occupée par deux officiers à l'arrière et devant par le conducteur et un soldat à côté de lui.
Dès que les Allemands s'aperçoivent que le village est occupé par des Français, ils font demi-tour à toute allure, si bien que nous n'avons pas le temps de capturer cette voiture, malgré que l'adjudant Baron ait lancé en travers de la route une herse qui oblige l'auto à heurter violemment un mur. Ce qui malheureusement ne l'empêche pas de repartir !
Par la suite, nous avons su que les occupants de cette auto, pensant que les Français n'étaient pas encore arrivés jusque-là, étaient venus tout simplement pour tâcher de dépanner un officier allemand blessé, caché dans une ferme et que nous avons trouvé, en effet, peu de temps après.
Le 11 septembre, le 15e Dragons est en liaison avec l'armée anglaise vers Coincy. Les chevaux sont très fatigués. Le 15e rejoint le soir la 10e division.
Elle a pour mission de continuer son mouvement en avant vers le nord, vers le camp de Sissonne.
Toutes mesurées qu'elles soient, de telles notes écrites sur un carnet de guerre sont accablantes pour le général Conneau, elles apportent témoignage de l'inaction du corps de cavalerie, au soir du 9 septembre, arrêté en plein élan, le nez sur la brèche, alors que l'heure sonnait, ou jamais, d'entreprendre une grande action de cavalerie dont les résultats (on le sait à présent) eussent été probablement décisifs.
Certaines phrases du capitaine de Léobardy sont, sans l'avoir voulu, cinglantes comme des coups de fouet :
" Plusieurs escadrons envoyés en avant-poste sur les hauteurs au nord de la ville ont pu s'installer tranquillement sans être inquiétés par l'ennemi et passer ainsi la nuit. "
Et plus loin :
" Après être entrés dans Château-Thierry, il était normal que nous eussions reçu l'ordre de continuer notre marche en avant. Les réactions sur les hauteurs au nord étaient insignifiantes."
Et ce cri de stupeur :
" Mais pas du tout ! La 1Oe D.C. reçoit l'ordre de s'arrêter et le 15e Dragons de cantonner à Château-Thierry, ce 9 septembre. " Il s'agissait bien de s'installer tranquillement pour passer la nuit !
Le clair de lune était magnifique. Le capitaine de Léobardy n'en parle pas, mais moi j'en parle. J'en parlerai plus loin encore et davantage lorsque j'évoquerai la charge à cheval en pleine nuit d'York et de von Kleist (les deux grands généraux de cavalerie de Blücher) exactement cent ans et six mois auparavant, le 10 mars 1814, contre le corps de Marmont lors du hurrah d'Athies.
Ah ! ils n'avaient pas peur, ces deux-là, d'engager une action à cheval dans l'obscurité, avec ou sans clair de lune !
Ce qui est grave pour Conneau, c'est cette concordance de témoignages dénonçant cette incroyable inaction de son corps de cavalerie, alors qu'il avait la possibilité de victoire dans la main, une victoire éclatante.
Fatigués, extrêmement fatigués, ses chevaux ? Ce sera la grande excuse, le leitmotiv des chefs et des états-majors du corps de cavalerie Conneau responsables à des degrés divers, mais tous responsables de la grande erreur du plateau de Fère-en-Tardenois.
Accuser la fatigue des chevaux était facile mais très exagérée. C'était pourtant le moment de mettre en action le précepte inscrit en lettres d'or au fronton de Saumur, temple de la cavalerie : Soigne ton cheval comme la prunelle de tes yeux, soigne-le comme s'il valait un million ! Mais le jour du combat jette-le sans hésiter sur le tapis, dépense-le comme s'il ne valait plus qu'un sou ! Il te donnera la victoire.
Le 10 septembre, il importait d'aller à la limite extrême de la résistance des chevaux, de la dépasser peut-être, mais avant tout de ne pas mollir, de ne pas faiblir, d'aller jusqu'au bout et à fond !
Le général Duffour est bien gentil, bien indulgent, dans sa critique de ces journées de la bataille de la Marne, lorsqu'il parle de la timidité du corps de cavalerie Conneau. Timidité n'est pas le terme qui convient.
Ce n'était pas la faute pourtant de cette pléiade de jeunes officiers qui ne rêvaient que plaies et bosses et de beaucoup aussi de leurs frères aînés, à l'esprit plus mûri, mais qui avaient gardé leur cœur de sous-lieutenant. Ce n'était pas la faute de cet admirable corps de sous-officiers de cavalerie, ces recalés de Saint-Cyr, ces étudiants qui s'engageaient directement dans les régiments, parce que, reçus à Saumur, ils étaient sûrs d'être un jour officiers de cavalerie à quoi ils tenaient par-dessus tout - alors que Saint-Cyr n'offrait pas la même garantie. Beaucoup étaient issus de ces vieilles familles de la vraie noblesse française, souvent ruinées, où se conserve jalousement l'esprit de chevalerie de jadis. Ces sous-officiers-là allaient fournir un réservoir précieux de cadres pour l'infanterie et l'aviation, aux pertes si lourdes. Le grade de maréchal des logis équivalait à celui d'officier. On ne reverra jamais plus dans aucune arme d'aucune armée au monde un corps de sous-officiers comparable à celui de la cavalerie française avant 1914.
Ce n'était pas non plus la faute de nos cavaliers de 2e classe, dont le cran était indiscutable, la fureur d'en découdre sans cesse sous pression depuis qu'ils avaient vu de leurs yeux ces fermes et ces villages sauvagement incendiés et pillés, chez nous, en France, ces fusillades inqualifiables de prisonniers de guerre et de civils.
Ce n'était pas non plus enfin la faute de nos chers chevaux qu'on avait tant fait souffrir par l'ignorance ou la négligence de chefs trop peu soucieux de les ménager. Chaque cheval aimait son maître, lequel l'aimait bien aussi, ne faisait qu'un avec lui, acceptant d'être sollicité, éperonné, pour passer à l'allure supérieure et pousser, s'il le fallait, jusqu'au bout de l'effort, jusqu'à la fin suprême.
A la 10e D.C., au soir de ce 9 septembre, on pouvait tout demander, l'atmosphère était à l'ivresse d'avoir vu de près, enfoncé et battu l'ennemi, enlevé ses barricades, fait des dizaines et des dizaines de prisonniers, tous des cavaliers comme nous, des dragons, des uhlans, des chevau-légers, des cuirassiers et des hussards de la Mort, tout l'échantillonnage pittoresque des corps Richthoffen et Marwitz.
Ils étaient plus fatigués que nous avec un moral assez bas, le moral des troupes en retraite. A chacun son tour !
Notre division, à nous, était pleine d'allant, on ne demandait qu'à continuer, à pousser loin et plus fort et puis subitement cet ordre de l'état-major de la division :
- Halte ! On ne va pas plus loin ! On cantonne.
Ordre incompréhensible, invraisemblable ! Ordre qui ne venait pas de la division, mais d'encore plus haut, du corps de cavalerie, lui-même.
FRANÇAIS ET ANGLAIS LAISSENT S'ECHAPPER VON KLUCK
Les journées des 11 et 12 septembre vont s'écouler sans incidents spectaculaires. Elles vont présenter cependant une importance capitale.
Malgré son énergique et méritoire entêtement à vouloir contenir la poussée de Maunoury à l'ouest de l'Ourcq et celle de French au nord de la Marne, entêtement qui le pousse à même chercher à déborder l'aile gauche de la VIe Armée, von Kluck est finalement acculé à décrocher. Il va, pour y parvenir, mettre à profit ces journées des 10 et 11 septembre.
Il bénéficie du miraculeux répit qu'on lui a gratuitement laissé. Il va faire passer toute sa Ire Armée au nord de l'Aisne, sous la protection de fortes arrière-gardes et flanc-gardes. Manœuvrant avec une rare habileté, il va réussir à la faire sortir de l'angle droit où Joffre espérait l'enfermer (Armée Maunoury, branche sud-nord, armée anglaise branche ouest-est).
Il va la faire défiler par échelons en vue d'Oulchy-le-Château, sous la protection de l'écran, ténu comme une toile d'araignée, des corps de cavalerie Richthoffen et Marwitz tenant tous les ponts (combien faiblement ! ) de la boucle de l'Ourcq.
Ceci, pour la bonne raison que Joffre n'est pas parvenu, comme il le voulait à jeter l'armée anglaise comme un coin (c'est sa propre expression) entre les armées von Kluck et Bülow).
C'est la faute, certes, à French et aux forces de cavalerie d'Allenby ( 3 brigades de cavalerie), mais la faute surtout au corps de Cavalerie Conneau qui n'a rien compris à la situation.
Il a perdu son temps à regrouper sa 10e D.C. chargée de fouiller et nettoyer les bois autour de Verdilly (on se demande pourquoi, car on était déjà beaucoup plus en avant !), perdu aussi son temps à attendre des fourgons de ravitaillement. Mais, Bon Dieu, on n'en était pas là ! On pouvait, pour une fois, bêtes et gens, se priver de boire et de manger ! Et marcher !
Tous ceux qui étaient capables de réfléchir (et il y en avait beaucoup) avaient l'intuition de perdre ainsi délibérément leur temps. Rester sur place pied à terre et inactifs constituait une grave erreur, une faute. Pourquoi nos grands chefs n'avaient-ils pas la même intuition, le même pressentiment ? ...
Autour de nous, le silence était saisissant. Une impression de vide. Sans doute, de grandes choses se passaient-elles ailleurs ? Alors, rester là, sans bouger ?
Joffre avait cependant pressé Conneau de percer en direction d'Oulchy-le-Château et d'ouvrir le débouché au 18e corps (général de Maud'huy), qu'il voulait jeter dans les jambes de von Kluck, en direction d'Hartennes.
Il semble vraiment que le général Conneau n'ait pas compris l'urgence qu'il avait à pousser vers le nord, même avec des chevaux fatigués. Et le général Grellet encore moins que lui. Pourquoi nous faisait-il battre avec autant de soin les taillis de chênes des bois de Barbillon et de Verdilly (aux portes mêmes de Château-Thierry ! ) à la recherche de quelques cavaliers attardés, aux chevaux fatigués ? C'était notre 10e D.C. qui s'attardait et se fatiguait en ces actions sans intérêt, sans profit !
Dans le même temps, le G.Q.G. français captait à Bar-sur-Aube des radios allemands fort instructifs sur l'état de l'armée von Kluck et des corps de cavalerie Marwitz et Richthoffen.
En voici deux exemples. Le premier :
Radio captée le 10 septembre (6 heures du soir). Ire armée allemande (von Kluck).
Mon armée est fortement épuisée et mise en désordre par cinq jours de combat ininterrompus et par la retraite qui a été ordonnée. Elle ne sera prête à reprendre le combat que le 12 au plus tôt.
Et voici le second :
Radio en clair, capté le 11 septembre (3 h 45 du matin). Quelle est la situation ? Où allons-nous ? Je suis incapable d'agir, car, par suite de l'encombrement des routes, la journée d'hier a été la quatrième où je n'ai eu de vivres ni pour les hommes ni pour les chevaux. Chez Schettow, (9e division de cavalerie) 167 chevaux sont tombés d'épuisement. En cas de passage de la rivière (l'Ourcq), il est nécessaire de nous faire recueillir par l'infanterie.
Voici donc, peints par eux-mêmes, l'état où se trouvent l'armée von Kluck et la cavalerie chargée de couvrir sa retraite. Nos adversaires sont dans une situation plus que pénible, périlleuse. Joffre le sait. Il ne cesse de pousser l'armée anglaise (placée exactement à l'entrée de la brèche) et en particulier ses divisions de cavalerie, assez fraîches, à aller de l'avant et à s'élever vers le nord le plus vite et avec le plus de force possible sur ce plateau entre La Ferté-Milon et Oulchy-le-Château.
Mais French s'aligne, sans vouloir le dépasser, sur le front tenu par l'aile gauche de la Ve Armée française et Allenby sur celui où est déployé le corps de cavalerie Conneau.
Cela nous conduit, nous l'avons vu, à ne pas dépasser la route de Villers-Cotterêts à Fère-en-Tardenois.
Von Kluck sera tranquille.
Comment devant l'Histoire le général Conneau expliquera-t-il l'inaction de son corps de cavalerie durant ces journées des 10 et 11 septembre ? Laissons-lui la parole.
Notons que le 10 septembre à 1 heure du matin, il lance de son quartier général établi à Chézy-sur-Marne, un ordre particulier prescrivant à ses divisions de se trouver rassemblées à 6 heures dans la région Bouresches-Chantemerle, couvertes par de fortes reconnaissances. Il leur définira les axes sur lesquels elles devront orienter leur " poursuite ".
Puis, dans son journal de marche, le général Conneau avoue loyalement que son corps de cavalerie n'a pu être rassemblé qu'à 9 heures (nécessité de ravitaillement, nous le savons).
Dans cet ordre particulier, Conneau a glissé cette phrase vibrante (nous le savons aussi) : Il importe de poursuivre l'ennemi avec l1i dernière énergie, sans lui permettre de souffler.
Il écrit, à la même heure, au général Franchet d'Espérey, qui le presse de foncer vers l'avant :
- J'ai eu l'honneur de vous signaler, il y a trois jours, que la limite extrême des forces des hommes et des chevaux était atteinte. Je crains qu'elle ne soit maintenant dépassée. Poursuite dès le jour et jusqu'à la nuit, retard dans les distributions de vivres et de munitions. Usure et même absence de ferrure, les effectifs fondent comme la neige. Ils sont réduits de moitié. Ma conscience ne me permet pas de cacher la réalité. Dans deux jours les divisions ne pourront plus avancer. Nous irons néanmoins jusqu'au dernier cheval.
Si nous faisons abstraction de la tournure quelque peu grandiloquente de cette dernière phrase (je ne pense tout de même pas que le général Conneau ait eu une réminiscence de la fière et célèbre réponse du général Margueritte, le 2 décembre 1870, au général de Galliffet qui, à Sedan, le pressait de charger et charger encore avec ses chasseurs d'Afrique pour rompre le cercle de fer de l'infanterie prussienne : - Tant que vous voudrez, mon général ! Tant qu'il en restera un !), il est quand même à remarquer que s'il était justifié de parler de la fatigue des chevaux, il ne l'était pas de celle des cavaliers. Pendant les six jours que durait la reprise de l'offensive, nos hommes (sauf à Château-Thierry) avaient passé le plus clair de leur temps pied à terre, à la tête de leurs chevaux, à battre la semelle et à bavarder entre eux, sans aucune fatigue.
Le 10 au soir, le P.C. du corps de cavalerie est installé à Oulchy-le-Château, où l'a rejoint la l0e D.C. du général Grellet, après que le général Conneau l'eut pressée d'en finir avec son nettoyage des environs de Verdilly et de marcher le plus vite possible en direction de Rocourt-Saint-Martin, Brény et Oulchy-le-Château, sur la route de Soissons.
Joffre sait maintenant sans discussion que le vide est absolu devant la droite anglaise et devant le corps Conneau. Il savait déjà qu'un hiatus s'était ouvert entre Kluck et Bülow, mais pas aussi large et à peine masqué par des éléments de cavalerie. Aussi lance-t-il à 6 heures du soir une nouvelle instruction particulière. Celle qui porte le n° 21.
Il y constate que l'armée von Kluck décroche devant l'armée anglaise, évacue la rive nord du ruisseau le Clignon et se retire dans une direction générale nord, nord-est.
Il prescrit à ce qui reste du corps de cavalerie Sordet ( Devenu corps de cavalerie Bridoux (le général Sordet ayant été relevé de son commandement).) (5e D.C. provisoire du général de Cornulier-Lucinière) d'accrocher l'aile droite de Kluck, pour la ralentir et de la harceler aux lisières de la forêt de Villers-Cotterêts, afin de lui couper la route en direction de Soissons.
Joffre suggère aux forces britanniques qu'elles pourraient ( admirons ce conditionnel, car elles ne sont pas sous ses ordres) poursuivre leur action victorieuse ( là encore Joffre est très poli, très gentil, car il n'y a pas eu d'action victorieuse, la Ire Armée allemande s'étant repliée d'elle-même).
Quant au corps Conneau, il reçoit l'ordre de pousser avec une vigueur accrue sur l'axe Chéry-Chartreuse-Fismes-Laon. Mission : attaquer partout l'ennemi et saisir toutes les occasions de le détruire.
Mais le C.C.C., tout en recevant ces directives, reste tout de même aux ordres de Franchet d'Espérey, chef de la Ve Armée. Celui-ci répète et prend à sen compte les directives de Joffre
commandant en chef au corps Conneau.
S'il est toujours précisé que le corps Conneau doit continuer d'assurer la flanc-garde de l'aile gauche de la Ve Armée, il n'est plus question de la fameuse liaison avec l'aile droite britannique. Cela va de soi. L'ennemi est en pleine retraite.
Von Kluck et Bülow sont, l'un et l'autre; bien trop occupés â colmater la déchirure béante qui les sépare.
La liaison franco-anglaise ne court aucun danger. Mais von Kluck s'est échappé...
Le gros de ses forces n'a pas encore franchi l'Aisne, mais se sera fait dans la soirée et dans la nuit de ce samedi 12 septembre, sous la protection de fortes arrière-gardes établies en partie sur la rivière la Vesle, affluent de la rive gauche de l'Aisne et à la lisière de la forêt de Villers-Cotterêts.
Le 20e Dragons cherche à forcer le passage de la Vesle à Fismes bourgade importante, dont le pont est intact.
Je reprends la lecture de mon carnet de route. Il fait revivre très exactement ce que fut cette journée du 12, où le corps de gauche de l'armée de von Kluck, renforcé d'un corps de la VIIe Armée allemande (Le 7e corps de réserve.), va sauver la situation au moment où Kluck va enfin atteindre le cours de l'Aisne, pour lui havre de salut :
Samedi 12 septembre.
J'écris ces quelques lignes dans le bourg de Fismes, sous une grêle d'obus. Et ceci n'est pas une simple image. Mon peloton est pied à terre dans la rue principale de Fismes conduisant au pont, les hommes à la tête des chevaux, le peloton collé contre les murs. Les shrapnells éclatent de tous côtés autour de nous. Des toitures crevées pleuvent sur nous des tuiles brisées. Des pans de murs s'abattent ça et là et nous couvrent de gravats. Nous sommes mal pris, je fais serrer encore davantage contre les façades. Il y a deux heures que cela dure. Nous sommes en plein dans le guêpier, à ce carrefour. L'ennemi veut visiblement nous interdire à tout prix de franchir la rivière. Il n'a pas le temps de faire sauter le pont, alors son artillerie le couvre de mitraille. Nous sommes trop dans l'axe du tir.
Le 18e corps (à qui nous ouvrons la route) envoie une batterie renforcer celle de nos volants, laquelle cherche à pousser une section de deux pièces, avec un cran magnifique, en avant de nous, à bras d'hommes. Cette section de deux pièces est commandée par le lieutenant Pépin de Bonnerive, du 14e d'artillerie. C'est un vieil ami d'enfance. Nous nous sommes retrouvés tout à l'heure avec surprise et une immense joie dans ces invraisemblables circonstances. Nous ne nous étions jamais revus, après avoir fait naguère nos études ensemble au collège de Saint-Thomas-d'Aquin des dominicains, à Oullins, près de Lyon. As des maths, Pépin de Bonnerive avait été reçu à Polytechnique. Il en était sorti l'année dernière, avec ses deux galons. Et presque aussitôt la guerre...
Nous retrouver ainsi sous une pluie d'obus !...
Il y a dix secondes, nous avons failli être tués par le même projectile. Quelle étrangeté du destin ! Après dix années d'interruption, nous ne nous serions retrouvés que pour être immédiatement frôlés ensemble par la mort.
J'enlève à Pépin de Bonnerive son képi, pour lui montrer qu'il a été traversé par une balle de shrapnell, les deux galons sont tout mâchés. Il ne s'en doutait pas. Il n'avait rien senti. Il rit. Un éclat encore tout chaud du même obus est venu me frapper à la cuisse, mais sans mal. Il était très faible. A peine une brûlure. Le projectile a éclaté à cinq mètres au-dessus de nous sur un réverbère fixé au mur. La carcasse du réverbère s'est écrasée à grand bruit, à nos pieds.
Mais puisqu'il est ici question d'artillerie, je ne veux pas laisser passer l'occasion d'exprimer toute l'admiration que j'ai eue pour elle au cours de la bataille de la Marne.
Il faut dire qu'à la fin du XIXe siècle et au début de notre XXe , l'Ecole polytechnique était vraiment une école militaire, où se cultivait le respect du patriotisme et de l'armée. En même temps que l'enseignement de l'artillerie on y recevait celui de l'honneur militaire. Il faut dire aussi que presque tous les officiers d'artillerie sortaient alors de Polytechnique, quelques-uns de Fontainebleau. Cela nous a valu d'avoir à la veille de 1914 la première artillerie du monde, sinon par la portée du moins par la manière dont elle était utilisée et commandée.
Grâce à la qualité des commandants de batterie, l'infériorité de portée de notre merveilleux canon de 75 par rapport aux 150 et 210 allemands, s'est trouvée souvent compensée. Notre artillerie de campagne a infligé de terribles pertes à l'ennemi, lequel la redoutait. Tous les prisonniers le déclaraient.
Revenons à Polytechnique :
Avant 1914, l'industrie française n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, avec cette multiplicité d'offres de postes d'ingénieurs dont elle a présentement besoin. Mais ce serait injustement diminuer la qualité de la mentalité du polytechnicien d'avant 1914 si l'on donnait à entendre qu'il acceptait de devenir officier d'artillerie à défaut de trouver place dans l'industrie.
La vérité était bien différente : le polytechnicien, sortant dans un bon rang après les Ponts et Chaussées ou les Mines, choisissait spontanément la carrière d'officier d'artillerie malgré la minceur de la solde, de préférence à un emploi bien rémunéré dans une entreprise industrielle. Un véritable prestige s'attachait à cette forme de carrière militaire, une sorte de noblesse dans le désintéressement. C'était un titre que recherchaient bien des jeunes gens issus de vieilles familles portant souvent de grands noms de l'armorial français. A la sortie de Polytechnique, dédaignant l'appât du gain, ils décidaient de devenir officiers de carrière. C'était une habitude, une coutume, on pourrait presque dire un rite, une mode de préparer Polytechnique à seule fin de devenir officier d'artillerie, comme on entrait à Saint-Cyr, Saumur ou Saint-Maixent pour devenir officier de cavalerie ou d'infanterie.
Les temps sont bien changés. A cette époque, on ne se préoccupait pas, comme aujourd'hui, de découvrir quel idéal on pourrait bien offrir à la jeunesse ? Il n'y en avait qu'un seul : reprendre à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine ! Toute la France était patriote. Je l'ai déjà rappelé, dans chaque demeure était épinglée contre une porte une carte de la France, où saignait en permanence la plaie béante de l'Alsace-Lorraine. Le mot de patrie ne faisait pas plisser les lèvres d'un sourire protecteur comme un mot périmé, dédoré. On y croyait en ce temps-là ! La France ne souhaitait peut-être pas la guerre, mais si celle-ci devait survenir, elle la trouverait moralement prête. Il était considéré comme impossible que sa silhouette funèbre n'apparût pas un jour sur l'horizon des Vosges.
Aussi, les candidats se pressaient-ils en foule pour entrer dans les écoles militaires, Saint-Cyr, Polytechnique, Navale et se voir admis dans l'armée.
Disons enfin qu'il y a toujours eu beaucoup d'amicales affinités entre artilleurs et cavaliers. La motorisation par tracteurs ou chenilles n'était pas encore utilisée. Alors, un trait d'union s'était établi : le cheval.
5 heures du soir.
La canonnade sur Fismes et la fusillade ne cessent pas. L'angle de la maison nous a heureusement protégés, Pépin de Bonnerive et moi. Les obus tombent sans arrêt. La bourgade de Fismes est reliée par voie ferrée à Reims, à l'est et à Soissons, à l'ouest. La voie court sur un haut talus. Au sud, tout le terrain est tenu par nos troupes. Au nord, il l'est par l'ennemi. Trente mètres à peine nous séparent. L'ennemi occupe aussi, sur la rive droite de la Vesle, une filature, aux murs épais, au ras de l'eau, tout à côté du pont, ce qui nous gêne beaucoup.
Le général Conneau survient, suivi de quelques officiers de son état-major. Il nous parle un instant. Je l'empêche de dépasser l'angle du mur, on est tiré au fusil de tout près. Conneau m'envoie en reconnaissance. Il veut savoir trois choses : 1° bien que la carte n'en mentionne pas, n'y a-t-il pas un autre pont plus à droite, par exemple à hauteur de la prochaine gare, celle de Breuil-les-Venteaux ? 2° Cette gare est-elle à nous, ou à l'ennemi ? La voie ferrée sur talus est-elle coupée, ou non, entre Fismes et cette gare ? Renseignements le plus vite possible, ici.
Je pars au galop avec Ma-Zaza, suivi de mon seul ordonnance Durousseau. Comme nous surgissons de la pénombre de la gare de Fismes, nous sommes accueillis par des coups de feu. L'ennemi veille. Impossible de suivre la voie ferrée au sommet de son talus, comme j'en avais l'intention. Même au galop, ce serait le casse-pipe certain.
Seule solution possible, suivre le sentier qui longe le bas du talus, côté tenu par nos troupes.
A proximité de la gare de Breuil-les-Venteaux, les zouaves (3e) me renseignent :
- N'avancez pas, mon lieutenant ! L'ennemi occupe la gare en force. Il faudrait un véritable assaut pour s'en emparer. Le colonel ne veut pas. On a assez de pertes. Les Boches ne vont pas tarder à foutre le camp !
Je reviens en arrière, à l'endroit où j'avais remarqué que la voie fait un coude. Peut-être qu'en grimpant là-haut ?...
Je jette les rênes de Ma-Zaza à Durousseau et lui confie mon casque, trop visible avec son couvre-casque en toile délavée. Son port obligatoire est stupide. Je monte à pied, en rampant. Endroit bien choisi. On ne peut m'apercevoir ni de la gare de Breuil, rapprochée, ni de celle de Fismes, trop éloignée. Par contre, je peux très bien observer. Le cours de la Vesle, qui est tout près, est marécageux, les eaux sont hautes. On voit miroiter le courant. Il y a deux ponts, un à Breuil, vers Montigny, l'autre près de Fismes, à Courlandon, tous deux non détruits mais sûrement tenus par l'ennemi. Enfin, la voie ferrée est intacte, coupée nulle part.
A Fismes, le général Conneau n'est plus là. Je le trouve à un kilomètre sur la route de Fère-en-Tardenois, avec la 10e D.C. pied à terre, en colonne, attendant toujours de pouvoir passer. Il paraît satisfait de mes renseignements. Mais ça ne conduit à rien. On ne fonce pas. Tout un corps d'armée et une division de cavalerie se laissent arrêter sur un pont... pendant des heures...
La journée avance. La canonnade et la fusillade ne cessent toujours pas. Les Allemands s'accrochent et nous retardent. Les hommes qui ne tiennent pas les chevaux entrent dans une maison et font cuire des pommes de terre pour tout le peloton. Par une fenêtre de cette maison, armé d'une carabine d'un de mes hommes, je tire sur des fantassins aperçus juste de l'autre côté de la Vesle, dans un verger. Je les vois s'enfuir.
Les obus allemands et français se croisent sur nos têtes. Pas un chat dans les rues. Des zouaves filtrent de maison en maison. Un toit et la façade qui le soutenait s'écroulent presque sur nous. Hommes et chevaux sont couverts de débris et de poussière. Pas de mal. Odeur âcre de mélinite. Je rassure les hommes et calme les chevaux, tous très émus.
Un autre obus tombe dans un jardin, à quelques pas de nous. C'est là que sont les deux pièces de 75 camouflées de Pépin de Bonnerive. Pépin, qui causait avec moi, se précipite. Trois de ses chevaux sont tués. On coupe les traits et on évacue à bras d'hommes les pièces et les caissons. Il faut changer de place. Les dragons aident. Un autre obus arrive, percute à côté de nous, dans le sol marécageux et, par chance, n'éclate pas, faisant fougasse.
Il pleut depuis deux heures.
Je continue d'écrire ces notes au rez-de-chaussée d'une maison. Le bruit est assourdissant. Les éclatements des 210 et des 150 allemands mêlés aux départs de nos 75 font un bruit d'enfer.
4 h du soir
La vacarme se ralentit, puis cesse subitement.
L'ennemi abandonnerait-il la partie ? On voit des fantassins gris monter dans les vignes. Fusillade nourrie.
Mon peloton y prend part. J'installe mes hommes aux fenêtres d'où j'ai tiré tout à l'heure. Mais cette fois, c'est plus loin. Hausse 1 000 m puis 1 200. Les fantassins ennemis courent, se couchent, repartent. Pas tous. Mes hommes sont enchantés, s'exclament et rigolent. Voir enfin l'ennemi si souvent invisible !
5 h du soir
C'est fini. On ne se bat plus. L'ennemi déménage. La 10e division arrive bientôt à cheval. Elle attendait de pouvoir avancer. Les habitants sortent des maisons et nous acclament. Les femmes nous distribuent du vin, des gâteaux, des fleurs (comme à Château-Thierry). Nous traversons Fismes. Les forces, que l'arrière-garde ennemie avait contenues, se précipitent, passent le pont de la Vesle et se ruent pour escalader la crête et rattraper le temps perdu.
Passent aussi deux escadrons de spahis marocains (escorte du général Conneau), la valeur de deux régiments d'infanterie, un régiment de tirailleurs algériens, que je n'avais encore jamais vu, un bataillon de chasseurs et une longue colonne d'artillerie de 75. Et alors le pont de Courlandon que j'ai signalé ?...
L'ennemi se retire partout, il bat en retraite, c'est vrai, mais il nous a fait perdre un temps précieux. Ce temps, lui, il l'a gagné. Ces Allemands, il n'y a pas à dire, savent se battre ! Mais nous aussi. Des deux côtés, on a fait des progrès.
S'il ne pleuvait pas ce serait la fête. Mais il pleut maintenant avec violence.
Et c'est bientôt la nuit.
Ordres, contrordres, hésitations se succèdent dans une navrante incohérence.
On a l'impression que rien n'a été prévu. On s'est laissé sur prendre par l'événement. On a eu pourtant le temps de réfléchir pendant cette attente interminable ! Chacun se souvient de Verdelot, c'est la même pagaille. Fatigue ? Incapacité ? Les deux à la fois ? Malade peut-être ? On le dit...
La nuit est venue. Les 15e et 20e dragons, séparés par plusieurs kilomètres, montent par des chemins différents et par nuit noire sur un vaste plateau, où se trouve un village où nous devons, paraît-il, cantonner et trouver de l'abri, le village de Romains. Alors commence un long calvaire.
Arrivés à Romains, nous tombons sur tout le 123e d'infanterie, déjà installé. Tohu-bohu indescriptible. Le 15e Dragons arrive à son tour, augmentant le désordre. Comment cela se fait-il ? Et la répartition du cantonnement ? Que fait l'état-major de la division ? C'est insensé !
Le général a disparu. On le retrouve à grand-peine dans une maison. Il accepte de venir discuter avec le colonel du 123e. Résultat : les dragons devront aller cantonner plus loin dans le prochain village, nommé Ventelay. Il faut repartir.
Le chemin est mauvais, incertain, il monte, descend et remonte à travers bois. Il pleut à torrents. C'est vraiment épouvantable ! Plus d'une demi-heure de marche. On n'y voit rien ! Les chevaux butent. Grand vent. On grelotte. Arrivé au prochain village, dont on ne voit pas les maisons tant il fait noir, le 20e Dragons se tasse sur le chemin. Pas une lumière. De l'Hermitte, qui assure l'avant-garde, sans descendre de selle, cogne à une porte, d'un coup de botte. Une vieille femme, affolée, sort sous la pluie et nous crie : " Sauvez-vous, c'est plein d'Allemands ici ! "
Une volée de coups de feu mal ajustés nous accueillent par une fenêtre. Les lueurs zèbrent la nuit. Trop haut ! Personne de touché ! A bout portant, c'est un miracle ! Le 15e Dragons survient. On s'interpelle dans le noir. Il veut aller vers un groupe d'autres maisons. Nouveaux coups de feu. Personne encore de touché ! Ordre du colonel : ne pas insister, ne pas aller plus loin, ne pas risquer d'avoir des pertes stupides. On passera la nuit ici, dehors, sous la pluie, tant pis, pied à terre, les hommes la bride au bras, colonel en tête. Il donne l'exemple. C'est bien. On ne mangera pas, ni gens ni bêtes. On attendra le jour. On fouillera alors le village. On verra bien !
L'aube est terriblement longue à venir, blafarde. La pluie s'est arrêtée, mais un grand vent s'est levé. Nous grelottons. Le village est fouillé avec prudence, maison par maison. Plus de cent prisonniers sont faits. Aucune résistance. Cette fois, pas un coup de feu.
Les Allemands ont compris. Parmi eux, plusieurs officiers. L'un d'eux pleure et dit devant moi, en français :
- Pauvre Allemagne, tout fini pour elle ! Nous sommes battus ! Le moral de tous Les prisonniers est lamentable. Ils sont vraiment à bas, certains à bout ! S'ils ont tiré hier, c'est qu'ils avaient peur. Ils ne voulaient f aire de mal à personne.
Je pourrais relever encore beaucoup de lignes de mon carnet, écrites vers 8 h du matin, au moment même, à Ventelay, cet affreux village où nous avons tellement souffert. Elles n'apprendraient rien de plus. Sautons des pages.
Nous arrivons à un passage plus important :
Le 20e Dragons est massé pied à terre sur le long plateau dénudé gui domine de très haut deux vallées parallèles, l'une au sud, la vallée de la Vesle (franchie hier au soir), l'autre au nord, très profonde, la vallée de l'Aisne.
Il ne pleut plus. Un pâle soleil brille. Nous avons été tellement mouillés cette nuit que nous fumons comme des soupes. Un instant inoubliable se grave dans ma mémoire : le colonel Gailhard-Bournazel réunit les officiers en cercle autour de lui. Il nous donne Lecture d'un message du général Joffre, en personne. C'est une proclamation adressée à tous les combattants. Je n'en ai malheureusement pas eu le texte. Mais elle commençait ainsi :
" Après huit jours de combats ininterrompus où chacun a fait son devoir... je vous félicite tous et je vous remercie. Je salue vos morts... "
Elle finissait par cette phrase :
" L'ennemi se retire, battu, vaincu. La bataille se termine par une incontestable victoire. "
Je reverrai longtemps le colonel Gailhard-Bournazel, avec sa moustache blanche, son casque recouvert de l'inévitable couvre-casque délavé, son grand manteau de cavalerie dont la pèlerine est secouée par le vent, lire d'une voix extatique, les yeux au ciel, les derniers mots de la proclamation. Il les répète en détachant les syllabes avec solennité : " La bataille se termine par une incontestable victoire, une in-con-tes-ta-ble vic-toire ! " Allez répéter ça à tous vos hommes ! Ils ont droit de le savoir et de l'entendre comme tous les autres.
Cette proclamation était datée du 13 septembre 1914, à 3 h.
Cette lecture avait gonflé sur le moment tous les cœurs de joie et de fierté. Nous n'en demandions pas autant. Certes, nous avions avancé, mais peut-être ne nous rendions-nous pas assez compte de l'ampleur de la victoire sur l'ensemble du front.
Le commandant en chef était mieux placé que nous pour en juger. Il fallait le croire.
En tout cas, cette proclamation, dont je garantis l'authenticité (pour l'avoir entendue de mes oreilles) n'eut pas de lendemain. Elle ne fut pas renouvelée. Les syllabes de Victoire de la Marne n'étaient pas encore forgées dans l'airain.
Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut se demander si une telle proclamation ne correspondait pas qu'en partie à la réalité ? Elle était en tout cas prématurée. Ce 13 septembre au matin, au moins sur la portion du front où nous nous trouvons, la bataille de la Marne est toujours en cours. Elle n'a pas trouvé sa conclusion. La trouvera-t-elle jamais ?
Certes, la victoire stratégique des premiers jours de la reprise de l'offensive, les 6, 7, 8 et même 9 septembre, est incontestable. La gigantesque faucille maniée par von Kluck, à l'aide de laquelle il se flattait - il était sûr - de moissonner notre armée d'aile gauche (la Ve) et du même coup la " méprisable petite armée anglaise " (L'expression a été, rappelons-le, du kaiser Guillaume II, comme celle de ridicule petit chiffon de papier, pour parler du traité garantissant la neutralité de la Belgique, traité qu'il avait solennellement signé lui-même avec le roi d'Angleterre.) de French, avait vu son tranchant d'acier ébréché, puis rendu inutilisable par l'attaque foudroyante, inattendue, lancée depuis Paris par Gallieni - Gallieni principal et véritable vainqueur de la Marne (Cette vérité n'est plus contestée par personne.).
Le résultat avait été extraordinaire, fabuleux, digne de la légende : en quatre jours, la victoire allemande, considérée par le monde entier comme déjà acquise, avait été clouée sur place, démantelée, mise en morceaux. On avait crié au miracle.
L'armée française, c'est-à-dire la France (qu'on me pardonne d'employer une expression vulgaire mais imagée) avait sauvé sa peau.
Les 10, 11, 12 et 13 septembre, l'armée allemande, c'est-à-dire l'Allemagne, était en train de sauver la sienne.
Ce serait le 14 septembre qui en déciderait...
Or, déjà le 10 elle avait été à un doigt de la perdre, à un doigt de connaître la défaite, l'écrasement définitif en rase campagne. Pourquoi y avait-elle échappé ?
La présence du chef.
Si je me permets de présenter dans ce livre quelques passages de mes carnets de guerre, d'évoquer parfois mes souvenirs personnels et de prendre la liberté de porter une appréciation sur la manière dont ont été conduites certaines des opérations de la bataille de la Marne, peut-être en ai-je quelques raisons.
Tout d'abord, j'étais présent et j'ai pris part à cette bataille historique (on le sait par la lecture du passage de mes carnets). Certes, je n'étais qu'un obscur petit sous-lieutenant de cavalerie et ne pouvais avoir que des vues très limitées et très vagues sur la situation générale, donc des vues de peu d'intérêt. Cependant, la tenue quotidienne de mes carnets de guerre apporte un témoignage parfois précieux sur ce qui se passait autour de moi. Il arrive que ce témoignage vienne compléter, confirmer - parfois infirmer et même contredire - des déclarations ou des rapports plus ou moins officiels sur les événements. Et ceci n'est pas dénué d'intérêt.
Ensuite, il me faut rappeler que notre génération, celle qui avait vingt-cinq ans en 1914, a été confrontée à tous les grands événements de l'époque. Elle en a été marquée. Plus que d'autres, elle a été amenée à réfléchir, à méditer, à s'interroger, à porter des jugements. Dans l'armée comme ailleurs.
En ce qui me concerne je ne suis plus aujourd'hui qu'un général à la retraite. Blanchi sous le harnais, j'ai dépassé, et même de très loin, l'âge qu'avait Joffre à la Marne. Cela m'ouvre-t-il le droit à des circonstances atténuantes à son égard, lorsque je le critique ? Je le pense.
Enfin, j'ai encore, je crois, un autre motif, celui d'avoir de très près vu à l'œuvre d'autres grands chefs, ses pairs. Il me faut m'expliquer :
Comme celles de la plupart de mes contemporains, ma carrière a été assez mouvementée, coupée d'incidents et de traverses. La trame en a été tissée de fils d'or, de couleurs brillantes, ou voilés de ténèbres. Je n'en regrette aucun. J'ai connu des périodes heureuses ou douloureuses, voire dramatiques ou glorieuses. Je les ai toutes acceptées.
Quelques mots seulement :
Au cours de la triste guerre de 1939-1940, j'avais commandé une aviation d'armée (VIIe Armée). Après l'armistice, le maréchal Pétain, qui ne me connaissait pas mais ayant connu mon action, m'avait convoqué à Vichy, pour m'offrir un poste important sous sa direction.
De mon refus il m'avait si peu voulu, que dans la quinzaine qui avait suivi, il m'avait fait accéder aux étoiles et promu général de brigade. Ce qui ne devait pas l'empêcher, deux ans plus tard, de me déchoir de la nationalité française, de me rayer des cadres de l'armée et de me radier de mes grades dans la Légion d'honneur, pour avoir rejoint à Alger le général Giraud, dissident et rebelle, afin de reprendre à ses côtés, les armes contre l'Allemagne et de participer avec lui à la libération de la France.
A mon tour, je n'en avais nullement voulu au maréchal Pétain. Il aurait fallu être franchement bête (ou intéressé), pour ne pas vouloir comprendre que le maréchal, lorsqu'il donnait une signature, c'était bien lui qui tenait la plume, mais l'Allemagne qui tenait le poignet. On s'expliquerait après la victoire entre gens propres et intelligents.
Si je reviens sur cette époque, c'est simplement parce que cela m'a valu de rencontrer de grands chefs militaires ayant exercé des commandements prestigieux, comme Giraud, Juin, de Lattre de Tassigny, Monsabert. Je les ai vus à l'œuvre, j'ai été souvent à leurs côtés en pleine action. Je les ai jugés et admirés. Giraud en Tunisie, en Italie, Juin au Garigliano, Monsabert à Castelforte, à la prise de Marseille, de Lattre de Tassigny au passage du Rhin.
A les voir agir, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup appris, beaucoup médité. En particulier sur le comportement du chef, si haut placé qu'il soit, au cours d'opérations de guerre.
Je ne veux rappeler ici que deux faits, deux exemples :
Le 12 mai 1944, Juin, commandant en chef de l'armée française d'Italie, n'a pas hésité à sortir de son P.C. de Sessa-Aurunca, pour venir sur le front s'entretenir avec ses généraux commandants de division, ses colonels de régiments, des raisons du demi-échec de la nuit précédente. Non seulement il a pris l'avis des commandants de division et de régiments, mais il a été sur le front, en première ligne, presque au-delà de la première ligne (il a fallu l'empêcher de commettre des imprudences), pour parler avec les officiers, les soldats. On s'était battu sauvagement toute la nuit. Les gains de terrain étaient infimes, la troupe était fatiguée, mais, comme les chefs, ne demandait qu'à continuer, qu'à reprendre l'attaque.
La présence de Juin avait vite été connue. Les hommes tendaient le cou pour l'apercevoir. Rien que de le savoir là, de constater que le grand patron s'occupait d'eux, parlait avec eux, prenait leur avis avait suffi. Les soldats, les cadres étaient comme remis à neuf, transportés.
La présence du général en chef avait suffi. Et le lendemain 13 mai 1944 avait vu se lever l'aurore de la grande victoire du Garigliano. Un an plus tard ou presque, le 31 mars 1945, le général de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la Ire Armée française en Allemagne, était sorti de son P.C. pour venir à celui de Monsabert, commandant le 2e corps d'armée. Le P.C. de Monsabert était installé dans une petite maison isolée, à proximité du Rhin, rive gauche. Il faisait nuit. Pas d'électricité. On s'éclairait à l'aide de bougies et de chandelles fichées dans des goulots de bouteilles.
De Lattre avait, à son accoutumée, fait irruption dans la pièce, le regard brillant, le ton saccadé. Les syllabes se précipitaient sur ses lèvres :
- L'armée américaine va passer le Rhin demain ! Il ne sera pas dit que l'armée française restera en arrière ! C'est impossible ! " Je sais que nous n'avons rien, aucun moyen, aucun bateau.
Les Américains me refusent tout, ils disent qu'ils n'ont déjà pas assez de moyens pour eux ! On passera quand même ! Je veux que nous passions quand même et en même temps qu'eux ! Vous entendez, tous, on passera quand même ! Je le veux ! Qu'on se débrouille ! (Il avait dit un autre mot que les soldats français comprennent bien.) Monsabert, avec ses yeux bleus et sa petite moustache blanche avait fait chorus.
Toute la nuit, on avait travaillé d'arrache-pied. La moindre barque de riverain trouvée sur place est aussitôt saisie, le moindre canot pneumatique, le moindre rafiot, le moindre radeau valable avait été aménagé, réparé, rafistolé. Tout ce qui pouvait porter un homme, une mitrailleuse, un fusil, la plus petite coquille de noix, avait été utilisé, mis à flot.
Et cette même nuit du 31 mars 1945 à 2 h 30, dans les ténèbres. les premiers éléments de la Ire Armée française avaient passé le Rhin en même temps que les Américains ! En deux points différents en amont de Spire. Ainsi, ce qui, les jours précédents, avait été étudié et déclaré impossible sans le prêt par les Américains d'une partie de leur matériel prévu pour le franchissement des fleuves, en particulier du Rhin, avait été tout de même réalisé.
Le sergent Bartoux, avec un commando de dix hommes du corps franc du lieutenant Bouda, transporté sur un canot, mû à la pagaie, c'est-à-dire à la main, du 83e bataillon du génie de la 3e D.I.A., avait été le premier à mettre le pied sur la rive droite du Rhin. Le reste avait suivi.
La volonté du commandant en chef et surtout sa présence, à l'heure cruciale, au milieu de la troupe avaient suffi à galvaniser tout le monde et à permettre d'accomplir, sur le Rhin comme sur le Garigliano, l'impossible exploit.
Si je cite ces deux exemples, c'est qu'on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec ce qui s'est passé trente ans auparavant, au moment capital de la bataille de la Marne, la nuit du 9 au 10 et la journée du 10 septembre.
Si nous avions eu comme général commandant en chef un Juin ou un de Lattre de Tassigny, les choses se fussent certainement passées de tout autre manière. Il a manqué à Oulchy-le-Château un animateur, un fédérateur, un chef d'orchestre, un détonateur pour faire exploser la victoire. Joffre n'a pas été celui-là.
Certes, il n'y a pas lieu de remonter jusqu'à Napoléon et de faire une comparaison entre la place que Napoléon occupait comme commandant en chef, à cheval au plus près de ses troupes, armé de sa seule longue-vue, les soldats autour de lui s'élançant aux cris de Vive l'Empereur ! et la place choisie par Joffre dans sa cellule de moine aux cordeliers de Châtillon-sur-Seine à cent cinquante kilomètres du front, pour conduire la bataille de la Marne. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux époques.
Fallait-il en déduire qu'avec l'immensité des fronts actuels, il était impossible à Joffre de se rendre sur un point déterminé, où sa présence aurait pu, avec l'éclair de son regard et la chaleur de sa voix, faire jaillir l'étincelle capable de mettre le feu aux poudres ? Joffre ne l'avait pas fait.
Fallait-il alors se contenter de suivre de loin le cours de la bataille sans toutefois renoncer à en assurer la direction à l'aide d'instructions particulières ou générales successives, voire de messages téléphonés en clair, comme Joffre l'avait fait ?
Ecrire et téléphoner n'est pas suffisant. Certes, le commandant en chef doit être en permanence au centre de sa toile, où chacun sait le trouver en cas d'urgence, mais il doit, aussi être en mesure de se jeter de sa personne là où il y a nécessité d'intervenir sur place et s'il le faut de créer l'impulsion, le choc moral, qui emporte la décision.
Cette heure avait sonné dans la matinée du 10 septembre. Joffre voyait très clair dans la situation générale ? Il savait parfaitement et il l'avait signalé à ses commandants d'armée que, par l'indiscipline de Kluck se refusant de céder devant Maunoury, une brèche de trente-cinq kilomètres s'était ouverte entre les Ire et IIe armées allemandes, l'armée anglaise se trouvant juste en face de la déchirure. Joffre avait l'intention d'enfoncer l'armée anglaise comme une coin entre Kluck et Bülow (selon sa propre expression) ; tout le monde devant accompagner le mouvement en fonçant vers le nord.
Mais personne ne fonçait. Chacun regardait son voisin et s'alignait sur lui, sans avoir la volonté de le dépasser, cette volonté qui seule donne son vol à la victoire.
L'infanterie anglaise (avec ses 5 divisions) prétendait s'aligner sur la gauche de la Ve Armée française, c'est-à-dire sur le 18e corps (général de Maud'huy).
Alors que se passe-t-il ?
Le 9 septembre au soir, le général Franchet d'Espérey estime un peu vite que la victoire est acquise, que l'armée allemande est en retraite précipitée devant lui. Il adresse même une proclamation aux troupes de son armée. (Ordre général de la Ve Armée du 9 septembre 1914.) " Il les félicite des résultats obtenus et les encourage pour les dures épreuves qu'il leur reste à subir. "
Ainsi, on souffle à la Ve armée. C'est tout juste si l'on ne met pas sac à terre pour former les faisceaux. Alors que l'heure presse et qu'il faudrait marcher au pas de chasseur.
Quant à la cavalerie anglaise, forte d'une division et demie, autrement dit de trois brigades, aux ordres des généraux Allenby et Gough, elle est relativement fraîche par rapport à la cavalerie française, d'abord parce qu'elle a moins marché et ensuite parce que son harnachement est meilleur, plus intelligent, blessant moins le cheval. (Songeons à la selle anglaise.) Eh bien, cette cavalerie, qui aurait pu aller de l'avant, galoper, foncer d'elle-même, décide, sans doute par politesse, de ne pas dépasser le corps de cavalerie français Conneau. C'est plus délicat et plus confortable.
Cette heure aurait pu être l'heure de Joffre. Par excellence. Au lieu de se borner à rappeler ses instructions particulières 19 et 20 des 8 et 9 septembre (Celle du 9 si importante diffusée à 22 h sous le n° 4 450.) et d'en lancer une nouvelle sous le n° 21 le 10 à 3 heures, il eût été certainement mieux inspiré de faire appeler son chauffeur et de partir en voiture en direction d'Oulchy-le-Château. Il aurait vu à leurs P.C. French, Franchet d'Espérey et Conneau. Ils avaient, tous trois, besoin d'être poussés par les épaules. Un Juin, un de Lattre ne seraient sûrement pas restés les pieds sous leur bureau.
Les instructions spéciales ou particulières numéros 19, 20 et surtout 21 n'étaient-elles donc pas suffisantes ? Ne disaient-elles pas bien ce qu'elles voulaient dire ?
Certes, toutes ces instructions étaient excellentes et parfaitement rédigées. C'était du bon général Berthelot, du bon commandant Gamelin. Rien n'y manquait, pas un paragraphe, pas un alinéa, pas une virgule. Mais tout ça c'était trop bien, trop devoir d'Ecole de guerre, trop compassé, trop conventionnel, pas assez chaud, pas assez vivant. Il y manquait la parole, la voix, l'accent, la poignée de main.
Joffre n'aimait guère à se déplacer, c'est vrai. Il n'était pas de première jeunesse (Napoléon avait trente-cinq ans à Austerlitz.), il était méditatif, taciturne, il avait les défauts de ses qualités. Il ne correspondait tout de même pas au portrait sévère, injuste, partisan et méchant qu'a tracé de lui dans son ouvrage le lieutenant-colonel breveté H.M. (lequel n'a pas eu le courage de signer son livre autrement que par ses initiales) (La vérité sur la guerre de 1914-1918, Albin-Michel, édit.). Le lieutenant-colonel H.M. le voit " gros mangeur, gros dormeur, trapu, lourd, affaissé, descendant avec peine de son auto, se déplaçant sur des jambes arquées, incertaines, comme ces enfants des campagnes qu'on a mis trop tôt sur leurs pieds ".
Un tel portrait ne peut être plus inconvenant, plus grossier, plus sectaire (cela se sent à la lecture du livre) à l'égard d'un homme, d'un grand chef, dont le visage, (qu'on le veuille ou non) restera attaché à la victoire de la Marne.
Joffre, il faut le reconnaître, a trop tendance à rester à son Q.G., à son bureau, à tout diriger de loin par téléphone (il fait téléphoner et ne téléphone que très rarement lui-même).
Cependant, il lui arrive d'aller prendre certains contacts lorsqu'il le juge nécessaire. N'est-il pas allé, le 5 septembre, veille de l'offensive (sur les instances, il est vrai, du colonel Huguet, assurant la liaison avec l'armée W ) rendre visite au maréchal French, à Melun. French avait déclaré que l'armée britannique ne pourrait pas participer à l'offensive générale fixée au lendemain 6. French avait décidé de laisser encore deux jours à ses troupes pour se refaire avant l'attaque.
C'était catastrophique ! Huguet avait déclaré à Joffre :
- Mon général allez tout de suite voir French. Il n'y a que vous, en personne, qui pourrez le décider à attaquer.
Joffre était allé à Melun. Il avait vu French. L'entretien avait pris une tournure dramatique, pathétique.
Le maréchal French ne voulait rien entendre, rien savoir ! Sans doute avait-il encore dans l'oreille les dernières recommandations de lord Kitchener, chef du War Office (Ministre de la Guerre.) lorsqu'il avait quitté l'Angleterre, à la tête du corps expéditionnaire anglais pour la France :
On vous confie les plus précieuses forces de l'Empire, les meilleures troupes de l'armée anglaise. Ménagez-les ! L'Angleterre peut en avoir besoin un jour pour sa propre sécurité.
Rappelez-vous qu'à aucun moment vous ne devez être sous les ordres des Français.
French était buté, ancré dans son refus d'attaquer le lendemain. Il était encadré par les généraux Murray et Wilson. Murray nettement hostile, défavorable à la pensée de prendre l'offensive le 6 aux côtés des Français, Wilson, plus intelligent, plutôt favorable.
Joffre ne parlant pas l'anglais, le général Wilson servait d'interprète.
Joffre, à la fin exaspéré par les refus réitérés du maréchal French, par son souci d'en trouver quand même de mauvaises raisons, avait fini par se laisser emporter au point de frapper un coup violent sur la table, en s'écriant :
- Monsieur le Maréchal, l'honneur de l'Angleterre est en jeu ! Un lourd silence avait suivi. French était devenu tout rouge (rouge brique, devait dire le colonel Huguet) puis il avait pris enfin la parole d'un ton grave, presque à voix basse :
- I will do all my possible.
Wilson avait traduit aussitôt, en arrangeant un peu avec un sourire :
- Le maréchal a dit oui.
L'atmosphère s'était aussitôt détendue. On s'était assis et on avait servi immédiatement le thé qui était tout prêt et dont le poing de Joffre avait fait trembler les tasses.
Aujourd'hui 10 septembre, cinq jours après, Joffre se souvient sûrement de cette entrevue de Melun, qui lui a laissé une impression profonde. Il ne veut à aucun prix en revivre de semblables. Il n'ira pas voir le maréchal French. Et cependant, il voudrait bien le pousser, apprendre de lui que ses cinq divisions d'infanterie et ses trois brigades de cavalerie sont déjà en train de " pénétrer comme un coin entre les Ire et IIe armées allemandes ". Bah ! ses instructions particulières n° 20 et 21, dont French est destinataire, suffiront bien à l'éclairer ! Il sait qu'on arrive - qu'on est déjà - dans la phase de l'exploitation et de la poursuite. Il n'ira pas harceler French, il faut le laisser tranquille.
Il n'ira pas non plus - malheureusement - voir ni Franchet d'Espérey ni Conneau.
Il laissera Franchet d'Espérey rédiger, à son P.C., ses bulletins de victoire et ses proclamations, car d'Espérey croit sincèrement à la grande victoire. Il a battu nettement la IIe Armée allemande. Il a fait plier les genoux à Bülow à Montmirail et à Marchais-en-Brie. Il voit devant lui des symptômes de déroute, des régiments d'infanterie mélangés, en désordre. Selon lui, cela va s'aggraver jusqu'aux frontières. Encore deux jours, trois jours et il n'y aura plus un seul Allemand en France. On se battra en Allemagne. C'est une grande victoire, peut-être la victoire décisive (Franchet d'Espérey n'a pas complètement tort. En face à Luxembourg, le généralissime von Moltke (l'homologue de Joffre) est mortellement inquiet. Il écoute le rapport verbal du lieutenant-colonel Hentsch, qu'il a envoyé dès hier au soir, muni des pleins pouvoirs au nom de la Direction Suprême, faire la tournée du front, parler avec les commandants d'armée, juger de la situation d'ensemble et, s'il le faut, obliger von Kluck à se conformer au mouvement de retraite générale. Hentsch a été très impressionné par ce qu'il a vu à la IIe Armée, Bülow pessimiste (ce n'est pas son genre), très occupé à porter deux de ses corps en crochet défensif face à l'est. Il est persuadé qu'il va subir dès cette nuit une très puissante attaque de la part des Franco-Anglais en train de se glisser dans la brèche ouverte entre Kluck et lui. Ce n'est pas possible autrement ! Bülow a peur de ne pouvoir résister à cette attaque. Hentsch est tellement impressionné par le spectacle de l'aile droite de la IIe Armée en retraite désordonnée sous les coups de la Ve Armée française qu'il emploie une expression péjorative à l'égard de l'armée Bülow : " Ce n'est plus qu'un troupeau, un débris, nur noch eine schlacke ! " Guillaume II, chef suprême des armées venu à Luxembourg, assiste à l'entretien. Il connaît Hentsch et sa valeur, sa clarté de vues. Comme Moltke, Guillaume II est suffoqué par de telles nouvelles, il est en plein désarroi. La contre-offensive française, alors qu'il se voyait déjà à Paris, a été un coup très dur pour lui. Il ne s'en est pas encore remis. II ne s'en remettra jamais.). On a le droit de souffler, de penser à manger, à boire un café.
Quant à Conneau, Joffre n'ira pas le voir non plus. Il l'a assez poussé ! " Percez à tout prix à Oulchy-le-Château, poussez jusqu'à Soissons ! "
Conneau est maintenant à Oulchy-la-Ville. Il sait ce qu'il fait ! Cette nuit, il va laisser se reposer ses chevaux, extrêmement fatigués, et nul doute que demain au point du jour le C.C.C. ne reparte en avant pour le rush final. Il sait (on l'a prévenu) qu'en face de lui, la cavalerie allemande est encore plus fatiguée.
- Nous irons jusqu'au dernier cheval ! Joffre avait confiance. Il avait tort.
Relisons von Poseck : von der Marwitz, de même que von Bülow, ne peut croire que le 11 au matin les cavaleries française et anglaise ne vont pas se jeter sur lui et déchirer le dérisoire rideau qu'il a réussi à tendre tant bien que mal avec ses escadrons fantômes.
Demain matin ? Pourquoi pas tout à l'heure ? Pourquoi pas tout de suite ? Il fait un clair de lune superbe, comme hier au soir à Château-Thierry. Et cependant, hier, les Français n'avaient pas attaqué. Ils ne commettraient pas deux fois la même faute.
Marwitz, sur le front de bandière, avait essayé de dénombrer les feux de bivouac de la cavalerie française. Ils étaient innombrables. Ils couvraient le plateau du Tardenois. Conneau était là, avec ses trois divisions, cette fois rassemblées dans un mouchoir de poche. Ses sept mille chevaux soufflaient aux naseaux de ceux de ses régiments de chevau-légers, de uhlans, de hussards de la Mort dont les montures recrues de fatigue tremblaient debout sur leurs jambes.
Comment espérer que Conneau n'attaquerait pas ?
Et cependant pour la seconde fois Conneau n'avait pas été l'homme de la situation, le 11. Il aurait pu, à lui seul, empêcher von Kluck d'exécuter son mouvement de retraite en direction de Soissons et de Fismes.
Si je me reporte à mes carnets de route, je constate que cette journée du vendredi 11 septembre, il ne s'est rien passé d'important au corps Conneau.
Au 20e Dragons, on a ressellé les chevaux à 5 heures (on avait donc dessellé - tant mieux ! -) pas question d'attaque de nuit, comme le redoutait Marwitz.
Dans la journée, le groupe d'artillerie canonne un convoi allemand, à trois kilomètres. Les chasseurs cyclistes s'en emparent et font plus de cent prisonniers.
A gauche, la 4e D.C. reçoit quelques obus de 210, destinés à l'intimider, à la ralentir.
N'oublions pas que le corps Conneau dispose d'un régiment entier d'infanterie (le 45e R.I.) en autobus, force offensive considérable. Mon carnet ne mentionne pas qu'il ait été engagé ce jour-là.
Mais il est fait mention, à gauche du corps Conneau de la cavalerie anglaise qui, comme lui, " se contente d'avancer au pas et au trot, avec de longs arrêts, dès que siffle le moindre obus, comme nous. "
Le temps s'est gâté. Il y a parfois de belles éclaircies. La nuit venue, le 20e Dragons cantonne ce 11 au soir, partie dans le village de Chéry, partie au bivouac, à proximité du village.
J'écris encore : Nuit paisible. On cause autour des feux. Je couche côte à côte avec de Montmorin, sur une botte de paille, à la belle étoile. Il fait très froid.
Et c'est tout, tragiquement tout, pendant cette journée du 11 et cette nuit du 11 au 12 durant lesquelles il ne se passe rien. Nuit paisible. Von Kluck est bien tranquille avec ses longues colonnes de troupes en retraite et ses bagages. Et von der Marwitz, avant le jour, aura replié et roulé son rideau. Il aura décroché et se sera éloigné au pas, mission accomplie.
Ce sont ces jours-là, 11 et 12 et nuit du 11 au 12 septembre, qu'aurait dû être livré un grand combat dans l'intervalle, le trou, qui séparait les Ire et IIe armées allemandes. Ce combat aurait eu des conséquences incalculables. Nous avions tout pour le gagner. Nous disposions à ce moment d'une supériorité numérique écrasante.
Plus tard, Joffre dans ses Mémoires sera très sévère pour French et pour ses lieutenants Franchet d'Espérey, de Maud'huy et surtout, à juste titre, Conneau.
Trop tard. Ne devait-il pas aussi faire son mea culpa ? Je maintiens que sa présence personnelle au point critique, dans la journée du 10 était nécessaire, indispensable. Il aurait galvanisé tout le monde, les chefs, les troupes, tout emporté et la victoire avec.
Compter pour y parvenir sur ses seules instructions particulières ou spéciales, était un leurre, une illusion, rien ne remplace la présence. Il faut voir et se faire voir. Le général Joffre oubliait-il le vieux précepte militaire taillé dans le roc et immuable à travers les siècles dans toutes les armes, aussi bien dans le génie que dans les autres : donner un ordre n'est rien, s'assurer de son exécution est tout.
En vérité, le 10 septembre Joffre a eu en poche l'option de la victoire, il lui suffisait de la lever. Mieux encore, il a eu la victoire clefs en main. Il n'avait qu'à pousser la porte, entrer, s'asseoir et poser son képi sur la table. Il était chez lui. C'était fini.
Quel malheur que Gallieni n'eût pas été là. Ou un Juin, ou un de Lattre de Tassigny (Sait-on que depuis le 2 août (jour de la mobilisation) au ministère de la Guerre, était tenue en instance permanente une lettre de commandement stipulant qu'en cas de disparition de Joffre ou de son impossibilité de remplir ses fonctions, Gallieni le remplaçait automatiquement. Joffre et Gallieni avaient chacun connaissance de cette lettre.) ! ...
LA VERITE SUR LES EFFECTIFS AYANT PRIS PART A LA BATAILLE DE LA MARNE
Ce chapitre sera très court.
Jusqu'alors j'ai évité de fatiguer le lecteur par trop de chiffres. J'en ai donné le moins possible, mais il importe cette fois de rétablir la vérité sur l'exactitude des chiffres des forces engagées de part et d'autre au cours de la bataille de la Marne. On a laissé s'installer dans l'esprit du public l'idée que les effectifs allemands avaient été numériquement très supérieurs à ceux des Alliés, des Français et des Anglais réunis. On a laissé, ou fait courir ce bruit. On l'a dit ou laissé dire, on l'a même écrit, ou laissé écrire, dans nombre d'études, d'articles, ou même de livres sur la guerre de 1914-1918.
A ma connaissance, - en dehors tout au moins des textes officiels - il n'y a jamais eu en aucun écrit (ou alors je n'ai pas su le découvrir), de la part des innombrables auteurs ayant parlé de la bataille de la Marne, le souci de rectifier dans l'opinion l'erreur (évidemment flatteuse pour les Français et les Anglais) que nous avions combattu contre une armée allemande jouissant d'une supériorité numérique manifeste.
Or, la vérité oblige à déclarer que ce n'est pas là l'image de la réalité. Elle oblige même à préciser que, s'il y a eu entre les adversaires une différence d'effectifs à la bataille de la Marne, ce fut à l'avantage des Français. Ce livre de vérité a formulé déjà assez de critiques à l'égard de certains chefs, et non des moindres (et il se propose d'en taire encore de nouvelles) pour laisser s'accréditer plus longtemps cette erreur dans l'esprit des lecteurs. Cette étude perdrait toute force et toute valeur.
Français et anglais avaient 56 divisions
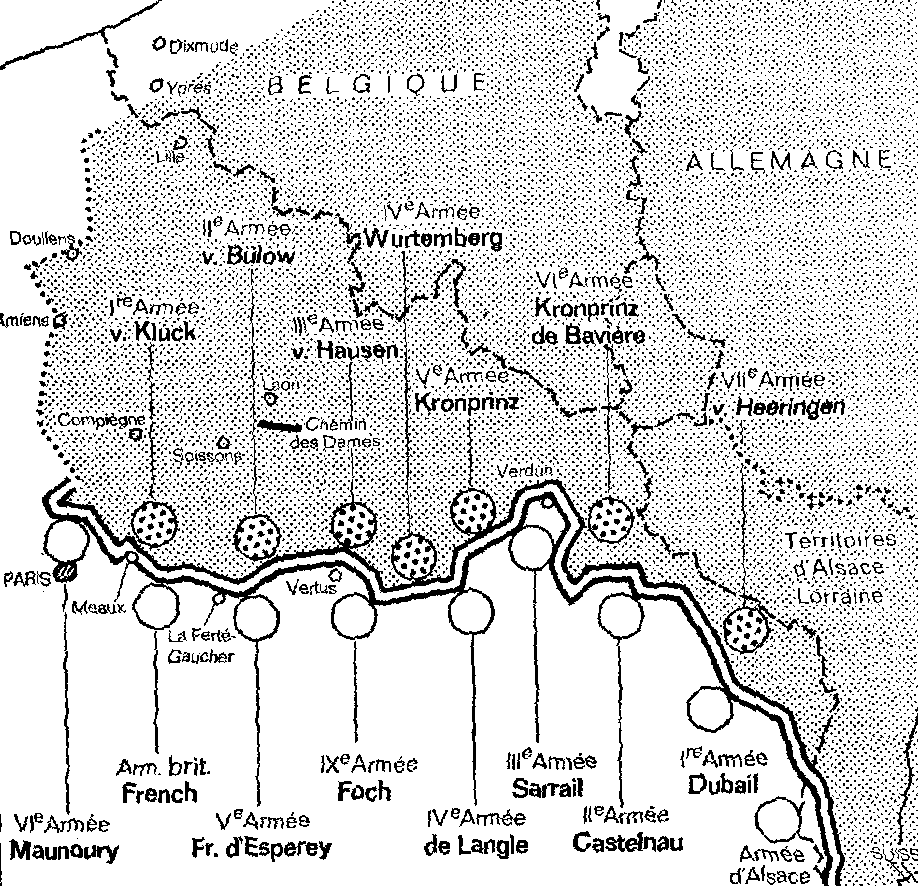
d'infanterie et 10 divisions et demie de cavalerie. Les Allemands 54 divisions d'infanterie et 7 de cavalerie. Donc légère supériorité numérique pour les Franco-Anglais.
Mais une démonstration s'impose. Je vais m'y employer. Peu de chiffres y suffiront.
Mais pour bien nous comprendre élargissons, cependant le débat aux dimensions du front occidental. On ne peut prétendre écrire quelque chose de valable sans faire d'abord connaître les chiffres d'effectifs d'ensemble d'avant la bataille de la Marne proprement dite.
Lorsque le 3 août 1914 l'Allemagne a déclaré la guerre à la France, l'armée française comprenait à la mobilisation :
|
84 divisions d'infanterie |
47 d'actives |
|
25 de réserve |
|
|
12 territoriales |
10 de cavalerie
soit au total environ 1 860 000 hommes.
Le corps expéditionnaire anglais, prévu pour venir immédiatement combattre sur le continent aux côtés des Français (le reste de l'armée britannique restant en métropole pour assurer éventuellement sa propre défense et sa souveraineté au sein de son vaste empire d'outremer), comprenait :
5 divisions d'infanterie :
1 division et demie de cavalerie.
Ainsi, sur le front français, l'armée française et l'armée anglaise réunies allaient pouvoir aligner côte à côte :
89 divisions d'infanterie
11 divisions et demie de cavalerie.
Seulement, de cet ensemble il fallait d'entrée de jeu déduire 12 divisions françaises qui ne comptaient pas (les territoriales, préposées à la défense du camp retranché de Paris et de la Basse-Seine et à la surveillance des côtes).
Restait donc comme divisions vraiment combattantes sur le front français :
77 divisions d'infanterie
11 divisions et demie de cavalerie.
En face, quels étaient les chiffres de l'armée allemande ? L'Allemagne ayant déclaré la guerre à la Russie, puis à la France, allait avoir à combattre à la fois sur deux fronts, un front occidental (en France) et un front oriental (en Russie).
L'état-major allemand avait décidé de jeter tout de suite le maximum de ses forces sur le front occidental, afin de régler son compte à l'adversaire le plus redoutable, la France. Une seule grande bataille de quelques jours en rase campagne y suffirait (dixit von Schlieffen). Après quoi, on se retournerait avec toutes les divisions revenant victorieuses de France contre la Russie impériale et on l'écraserait à son tour.
Le haut commandement allemand, intitulé Direction Suprême, avait pour chef à l'échelon le plus élevé le kaiser Wilhelm II, en personne, qui avait pris le titre de Oberkriegsherr (ce qui peut se traduire par le terme pompeux et prétentieux de Seigneur de la guerre). Au-dessous de lui, exerce le commandement effectif des armées et des opérations, le généralissime von Moltke (homologue de notre commandant en chef, le général Joffre).
Von Moltke, neveu du grand Moltke de 1870, le vainqueur de Sedan le 2 septembre, avait succédé en 1905 au fameux von Schlieffen, auteur du plan de guerre qui porte son nom et restait valable en 1914, avec de légères retouches de la part de von Moltke.
La Direction Suprême comptait sur l'allié autrichien pour contenir à l'est une offensive russe éventuelle mais peu probable en Prusse-Orientale, tandis que le gros des forces allemandes serait occupé à liquider la France.
Cependant, l'Autriche risquait fort d'avoir affaire à l'indomptable Serbie sur le front du Danube. Il fallait donc agir très vite sur le front occidental et se débarrasser au plus tôt des forces françaises, anglaises et belges. Tout s'enchaînait.
Alors, quels étaient les chiffres dont disposait au départ la Direction Suprême allemande sur le front occidental ? (le seul front dont nous ayons à nous occuper).
Ces forces s'élevaient à :
34 corps d'armée, dont 22 actifs (celui de la garde compris), soit au total:
45 divisions d'infanterie d'active , 23 divisions d'infanterie de réserve, 2 de réserve pour la défense mobile de Metz et de Strasbourg, c'est-à-dire 70 divisions d'infanterie et 10 divisions de cavalerie (Bien que cela soit hors de notre sujet, disons que von Moltke avait confié la défense du front russe à trois corps actifs et un corps de réserve, celui-ci à trois divisions, au total à quinze divisions dont quatorze divisions d'infanterie, le reste comprenant deux divisions indépendantes et deux D.C.. A l'armée autrichienne incombait la défense du front de Galicie.)
Sur ce total la Direction Suprême s'était constituée une masse de manœuvre, réservée à ses ordres directs. Elle comprenait 6 D.I. indépendantes et 1 corps de réserve.
Ramenons maintenant le problème aux dimensions du front de la bataille de la Marne, qui n'est lui-même qu'une portion du front occidental.
Topographiquement, il est admis que le front de la Marne doit se mesurer (dans le sens ouest-est), depuis les rives de l'Ourcq jusqu'à la place forte de Verdun. Ce sont les deux môles entre lesquels tout s'est joué (Entre lesquels tout aurait dû s'achever. Mais n'anticipons pas sur la conclusion de ce livre.). C'est donc sur cette dimension, que nous allons établir la balance des forces. Car il est bien évident que pour Français et Allemands le front se continuait au-delà de Verdun, jusqu'à la Suisse.
L'Allemagne a toujours su, au moment opportun, admirablement camoufler ses chiffres et ses intentions. Aujourd'hui, on les connaît, ce n'est plus que de l'Histoire.
Ayant divisé ses forces en deux masses distinctes, l'une appelée la masse principale, l'autre la masse secondaire, la première était affectée à l'action principale, c'est-à-dire au front de la bataille entre l'Ourcq et Verdun, la seconde à l'action, devenue secondaire, entre Verdun et la Suisse.
La masse principale, celle de la bataille de la Marne, avait été articulée en 5 armées comprenant 26 corps d'armée, soit 52 divisions d'infanterie et 7 divisions de cavalerie.
La masse secondaire, appelée aussi garde-flanc, avait été articulée en 2 armées comprenant huit corps d'armées, soit 16 divisions d'infanterie et 3 divisions de cavalerie.
Ceci donnera au total pour les Allemands sur le front occidental : 68 D.I. et 10 D.C.
II est intéressant de voir comment étaient constituées les cinq armées allemandes engagées sur le front de la Marne et quels en étaient les chefs.
Voici la composition du corps de bataille allemand (de l'aile droite à l'aile gauche).
|
ARMÉE |
COMMANDANT EN CHEF |
COMPOSITION |
CAVALERIE |
|
Ire |
Colonel Général von Kluck |
Corps actifs II, III, IV,V Corps de réserve III, IV soit : 12 D.I |
Corps de cavalerie von der Marwitz 3 D.C.: 2e D.C., 4e D.C., 9e D.C. |
|
IIe |
Colonel Général von Bülow |
Corps actifs VII, X, 2 garde-corps de réserve VII, X, Garde soit 12 D.I. |
Corps de cavalerie von Richthoffen D.C. de la Garde, 5e D.C. |
|
IIIe |
Colonel Général von Hausen |
Corps actifs XI, XII, XIV, Corps de réserve XII soit 8 D.I. |
" |
|
IVe |
Duc de Wurtemberg |
Corps actifs VI, VIII, XVIII, Corps de réserve : VIII, XVIII soit 10 D.I. |
" |
|
Ve |
Kronprinz impérial |
Corps actifs V, XIII, XVI Corps de réserve V, VI soit 10 D.I. |
IVe , corps de cavalerie 2 D.C. : 3e D.C., 6e D.C. |
Total des D.I. = 52 + 2 D.I. investissant Maubeuge libres à partir du 8 septembre
Total des D.I. = 54 Total des D.C. = 7
Les deux armées allemandes constituant la masse secondaire de Verdun à la Suisse n'entrent pas dans le cadre de cette étude. Nous ne les citons que pour mémoire : la VIe armée du prince Rupprecht de Bavière (nous avons eu affaire à elle en Lorraine, durant le mois d'août, on s'en souvient) et la VIIe Armée, aux ordres du colonel général von Heeringen, déployée en Alsace.
Au regard de l'ordre de bataille allemand, il nous reste à établir l'ordre de bataille français, sans oublier les Anglais. La comparaison sera facile. Les chiffres parleront d'eux-mêmes.
Dans le dispositif initial choisi par le général Joffre, c'était la droite ( Ire armée du général Dubail et 2e armée du général de Castelnau) qui avait bénéficié au début de la structure la plus puissante, en vue de la démonstration offensive que devaient prendre ces deux armées en Lorraine et Basse-Alsace.
Le grand mérite de Joffre aura été de reconnaître que les données du problème avaient été bouleversées par le succès stratégique obtenu par la droite allemande (Ire Armée von Kluck, IIe Armée von Bülow). Tout en laissant à Dubail et à Castelnau des forces suffisantes pour contenir la contre-offensive de Rupprecht de Bavière en Lorraine, il leur avait enlevé une part importante de leurs moyens au profit de l'aile gauche (VIe Armée de formation récente, aux ordres du général Maunoury, et Ve Armée qui venait de changer de chef, Franchet d'Espérey ayant remplacé Lanrezac).
Joffre avait en même temps cédé aux demandes pressantes de Gallieni réclamant que les forces mobiles du camp retranché fussent considérablement augmentées.
Pour faire face à ces deux obligations, Joffre avait dû faire des ponctions profondes dans la masse de manœuvre qu'il s'était réservée à ses ordres directs. La bataille de la Marne n'était pas encore commencée que déjà cette masse de manœuvre était dangereusement amenuisée. Elle subirait encore de tels prélèvements successifs au cours des opérations, que Joffre, commandant en chef, n'aurait plus rien (comme nous l'avons vu) dans les mains au jour utile du 10 septembre.
Et cependant il avait largement calculé. Sa masse de manœuvre comprenait au départ :
- 4 divisions d'active d'infanterie (3 provenant d'Afrique du Nord, les 37e, 38e et 45e D.I.A. et une, la 44e, constituée de régiments alpins provenant des 14e et 15e régions) ;
- 6 divisions de réserve d'infanterie
- 3 divisions de cavalerie de réserve,
- 2 groupements d'artillerie lourde dont 1 d'A.L.G.P. (artillerie lourde à grande puissance).
Ceci équivalait (en dehors de l'artillerie lourde) à :
- 2 corps actifs d'infanterie
- 3 corps de réserve d'infanterie
- 1 corps de cavalerie de réserve,
ce qui était considérable.
Nous avons avancé, et c'est terriblement justifié que Galliéni a été le premier et principal auteur de la victoire de la Marne. C'est lui qui a décidé et pour ainsi dire forcé Joffre à déclencher la grande contre-offensive du 6 septembre. C'est lui qui a lancé avant tout le monde la première attaque (de la brigade marocaine du général Ditte, à Monthyon) à l'heure qu'il fallait dans le flanc de von Kluck.
Si l'on peut élever des réserves sur la manière trop statique dont Joffre a conduit les opérations depuis sa table de travail de Châtillon-sur-Seine, s'il a négligé d'aller insuffler une impulsion indispensable à certains de ses lieutenants qui en avaient bien besoin, en allant se faire voir, et voir par lui-même ce qui se passait sur le terrain au point critique (inertie du corps de cavalerie Conneau), il faut cependant rendre à César ce qui appartient à César et ne pas lui enlever sa part dans le mérite de la victoire de la Marne. Cette part est capitale. Le nier serait d'une injustice absurde.
D'abord, c'est lui qui a porté la responsabilité, toute la responsabilité, du formidable coup de poker engagé à l'aube du 6 septembre (Rappelons cette phrase de lui, bien connue : "Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais si elle avait été perdue, je sais bien que c'est moi qui l'aurais perdue.) .
Ensuite, c'est à lui que revient le grand mérite d'avoir renversé la situation de sa droite à sa gauche, d'avoir constamment suivi les fluctuations de la bataille, d'avoir compris la bataille et de s'être arrangé pour que selon le jour, l'heure et les possibilités des transports par voies ferrées la balance des forces fût toujours en sa faveur.
Il a jonglé avec ses divisions. Il a puissamment renforcé les moyens de Maunoury, fait droit aux demandes de Gallieni réclamant des divisions d'active supplémentaires pour l'armée de Paris, créant de toutes pièces le détachement d'armée (9e) aux ordres de Foch et l'insérant en pleine bataille entre la droite de Franchet d'Espérey et la gauche de Langle de Cary.
Joffre a pris de graves risques, et, seul à son échelon, des décisions lourdes de conséquences, il est resté calme, impavide, même lorsque les nouvelles plongeaient ses proches collaborateur; dans l'angoisse. Il n'a jamais molli. Joffre s'est révélé comme un véritable stratège, ayant la force d'âme d'un grand capitaine. Mais il est infiniment regrettable (nous l'avons déjà dit, n'y insistons donc pas) qu'il n'ait pas eu la pensée d'apporter sur place l'étincelle, la flamme personnel le qui aurait mis le feu aux poudres sur le plateau du Tardenois.
Mais voici l'ordre de bataille français, qui, après l'ordre de bataille allemand, met en lumière la balance des forces sur le front de la bataille de la Marne.
De la gauche à la droite :
|
ARMÉE |
COMMANDANT EN CHEF |
COMPOSITION |
CAVALERIE |
|
VIe |
Gal Maunoury |
7e corps 55e et 56e D.I. de réserve renforcées des 61e et 62e D.I. de réserve. Brigade marocaine du Gal Ditte (effectif égal à une D.I.). T. = 11 D.I. |
3 D.C. (1re, 3e, 5e) Corps Sordet |
|
Ve |
Gal Franchet d'Esperey |
5 corps actifs (1er, 2e, 3e, 10e, 11e) reçoit en renfort le 18e corps actif, 2 divisions de réserve (52e et 60e) T. = 13 D.I. |
1 D.C. |
|
Détachement de IXe armée |
Gal Foch |
10e corps prêté le 8 septembre par la Ve armée T. = 8 D.I. |
1 D.C. |
|
IVe |
Gal de Langle de Cary |
3 corps actifs (12e, 17e, corps colonial) reçoit en renfort le 21e corps actif, 58e et 63e D.I. réserve. T. = 9 D.I. |
1 D.C. |
|
IIIe |
Gal Sarrail |
3 corps actifs (4e, 5e, 6e), en renfort 15e corps 3 D.R. (54e, 55e, 56e) T. = 10 D.I. |
1 D.C. (la 7e) |
|
Armée anglaise W |
Mal French |
T. = 5 D.I. |
1 D.C. 1/2 |
Total des D.I. = 56 Total des D.C. = 10 1 /2
Les Français, avec l'appoint du corps expéditionnaire anglais, disposaient donc de deux divisions d'infanterie et de trois divisions et demie de cavalerie de plus que les Allemands sur le front de la bataille de la Marne. Même en comptant les deux divisions d'infanterie allemandes occupées à assiéger Maubeuge (Maubeuge, notre seule place forte du Nord, barrait la trouée de la Sambre. Attaquée le 26 août, elle a capitulé le 7 septembre. Ses forts, sauf le fort bétonné Bourdiau, étaient en mauvais état, c'est vrai, mais la place aurait pu offrir une meilleure résistance. L'ennemi, pour en avoir plus vite raison, bombarda la ville même. La population se montra incapable de supporter longtemps ce bombardement et vint, municipalité en tête, sommer le colonel-gouverneur (dont l'Histoire de France a effacé le nom) de capituler. Ce colonel obtempéra... Maubeuge, par manque de force d'âme, a failli à son rôle d'arrêt en pleine bataille de la Marne. Elle a perdu l'occasion d'attacher la gloire à son nom et de l'illustrer autrement que par ses clairs de lune.) et qui ne seront cependant disponibles que le 8 septembre dans la journée. Tels sont les chiffres réels.
La différence n'est pas considérable, mais elle ne permet pas de travestir la vérité.
L'ETRANGE NUIT DE SISSONNE LA BATAILLE DE SISSONNE AURA-T-ELLE LIEU ?
Sur ce plateau dénudé le vent d'ouest souffle avec violence. Nous ne nous en plaignons pas, il nous sèche. Il ne pleut plus. Encore une heure et on pourra rouler les manteaux sur les troussequins.
Toute la brigade est là, pied à terre, maintenant rassemblée, au lieu-dit l'Arbre de Romain qui marque le sommet du plateau. Le 15e Dragons est venu nous rejoindre. Comme nous il a passé la nuit, la bride au bras, hommes et officiers, assis sur la terre humide, faisant le gros dos sous la pluie. On en rit maintenant, mais ça a été très dur. C'est la guerre.
On attend les ordres.
Le général Chêne réunit autour de lui le maximum possible d'entre nous, c'est-à-dire la moitié (un homme sur deux restant à la tête des chevaux) et nous entendons lecture pour la seconde fois de l'ordre du jour du général Joffre. Le 15e Dragons ne le connaissait pas encore.
A propos d'ordres du jour, j'apporte ici ma modeste contribution à la controverse qui s'est ouverte à propos de la diffusion de

A propos d'ordres du jour, j'apporte ici ma modeste contribution à la controverse qui s'est ouverte à propos de la diffusion de l'autre ordre du jour de Joffre, le célèbre et même historique ordre du jour de la veille de la contre-offensive.
La veille ? Entendons-nous, il paraît établi que cet ordre a été signé par Joffre à Châtillon-sur-Seine, dans sa cellule des cordeliers, le 6 septembre à 7 h 30 du matin, c'est-à-dire au moment même où se déclenchait l'attaque. Non la veille. Quant à sa diffusion dans la troupe, je me demande comment elle aura pu se faire (A titre d'exemple, rappelons que la VIe Armée du général Maunoury (lancée par Gallieni, car elle est à ses ordres) est en pleine offensive depuis la veille 5 septembre. La brigade marocaine livre les premiers combats de la bataille de la Marne à Penchard et Monthyon, les colonels d'infanterie, chefs de bataillon et capitaines commandants ne compagnie attaquant, aussi invraisemblable que cela soit à la tête de leurs hommes à cheval, derrière le drapeau déployé et se faisant, bien entendu, presque tous tuer. Prendre l'offensive et voir l'ennemi étaient une telle fête !) ?
En tout cas, le 20e Dragons n'en a jamais eu connaissance, ni avant ni pendant ni après l'offensive. Même longtemps plus tard je m'en porte garant ! Mon carnet de guerre ne le mentionne pas, alors que le 6 au matin il fait état d'une proclamation enflammée de Franchet d'Espérey, commandant la Ve Armée.
Je rappelle ici le texte bien connu de l'ordre du jour de Joffre :
Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts devront être employés à attaquer et à refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée !
Un tel texte ne peut s'oublier. Si le 20e Dragons l'avait connu, il figurerait en belle place dans mon carnet de route. Or, il est muet. La controverse est double :
1 ° l'ordre du jour signé de Joffre a-t-il eu le temps d'atteindre la troupe avant l'offensive ?
2° Joffre est-il bien l'auteur de cet ordre du jour ?
A la première question on peut sans risque d'erreur répondre par la négative. L'ordre du jour, même diffusé par message téléphoné à chaque armée, n'a pas eu le temps de descendre jusqu'à la troupe, jusqu'au combattant proprement dit. Sa diffusion a été tardive et irrégulière. Certaines unités ne le recevront que six jours plus tard, alors que sur l'Aisne seront tirés les derniers coups de canon de la Marne. D'autres n'en auront jamais connaissance.
Il est curieux de savoir qu'il n'en sera pas de même pour les Allemands. Dès le 9 septembre, un envoyé spécial du général von Hausen, commandant la IIIe Armée allemande, remettra, à Luxembourg, au général de Moltke, à la Direction Suprême, un exemplaire de l'ordre du jour de Joffre. Il aura été trouvé, au cours d'une contre-attaque, sur un sous-officier d'infanterie français grièvement blessé, relevé par des ambulanciers allemands. Ce sous-officier appartenait à un régiment du 12e corps de la IVe Armée. Ceci prouvait qu'au moins à cette armée la diffusion avait pu être correctement assurée.
Ce qui est pittoresque, c'est ce qu'a révélé plus tard un des nombreux officiers de la Direction Suprême. L'ordre du jour de Joffre avait été unanimement apprécié et admiré. Tous avaient mesuré sa fermeté militaire, son patriotisme, son souffle.
Quelqu'un aurait même murmuré dans le dos de Moltke :
- Il est vraiment dommage que notre patron, à nous, n'ait pas été capable de pondre (legen) un ordre du jour pareil ! Ça fait défaut à notre troupe !
Répondre à la deuxième question est moins aisé : Qui est l'auteur de l'ordre du jour de Joffre ? Joffre lui-même, ou l'un de ses proches collaborateurs ! Berthelot, l'aide-major général ?... Non, pas le général Berthelot. Il n'avait pas été, au moins au début, tellement chaud pour attaquer dès le 6. Il voulait, on s'en souvient, que la retraite se prolongeât jusqu'à la Seine et même derrière l'Aube. Optimiste, oui, mais pas téméraire (Non, pas Berthelot. Plus de deux ans après, alors qu'il était chef de la mission militaire française en Roumanie, j'ai eu l'occasion de l'approcher, de le connaître. Dans sa façon de parler à la troupe, même aux officiers et soldats roumains aimant le panache, ce n'était pas sa manière, son style.). Il jugeait l'offensive téméraire, tout en ayant confiance dans son issue.
Alors un autre ? Quelqu'un de son 3e bureau ? Beaucoup ont voulu l'attribuer au commandant Gamelin, le futur et infortuné généralissime de 1940.
Mais pourquoi ne pas le laisser à Joffre en personne ? Il paraît que le manuscrit porte plusieurs ratures. De sa main ? On ne sait pas...
En tout cas, ce manuscrit, le jour où il sortira de la collection privée où il est conservé, aura une jolie valeur.
LE RAID DE CAVALERIE DE SISSONNE
( première journée)
Quel va être notre rôle aujourd'hui ? Il paraît que nous sommes vainqueurs ? Fort bien...
Mais ce n'est pas fini... Là-haut, de l'autre côté de l'Aisne, sur les falaises escarpées du Chemin des Dames, à Craonne et Craonnelle (joie d'avoir une carte) la canonnade s'est réveillée au point du jour. Nous voyons les obus fusants éclater sans interruption sur Craonne et Craonnelle, ils sont incontestablement allemands. Donc, les deux bourgades sont à nous. C'est signé.
Ça va. Ça va bien !
Desjobert revient de liaison auprès de la division. Les nouvelles sont excellentes. L'ennemi bat toujours en retraite. Pas seulement devant nous mais partout. Sur tout le front.
Desjobert affirme que cette fois on va marcher. Il faut d'abord passer l'Aisne.
Grand jour pour la cavalerie. Sûrement !
Nous partons. La pente en descente est très rude. Nous suivons un étroit chemin dans des taillis, dont les branches mouillées de la pluie de cette nuit nous aspergent d'eau. Si nous descendons par là, c'est pour laisser le passage à l'artillerie et à l'infanterie sur les meilleurs chemins. Cette vallée de l'Aisne est très encaissée.
Le 15e Dragons passe devant nous. C'est aujourd'hui son tour d'assurer l'avant-garde. Nous sommes à l'abri du vent. Je suis frappé par l'horrible odeur que devant nous dégage la colonne. Hélas, je ne la reconnais que trop ! Elle provient de tous ces malheureux chevaux avec les plaques suppurantes de leurs dos blessés. Une odeur écœurantes de pus qui remplit les narines et flottent sur nous. C'est à peine croyable. Pauvres bêtes, il faut quand même les seller et aller de l'avant ! Joffre nous a fait prévenir que c'est bien pire dans la cavalerie allemande. Il paraît que les chevaux tombent comme des mouches. On a capté des radios allemands en clair qui le disent.
Et cette canonnade à Craonne qui ne cesse pas... Et aussi là-bas, loin dans la direction de Reims, à notre droite.
Une fusillade là, dans le fond, éclate soudain. Ses échos montent jusqu'à nous. Nous saurons tout à l'heure que c'est le 15e Dragons. Il a trouvé sur l'Aisne le pont où nous devons passer, le pont de Pontavert (non détruit), tenu par des cavaliers ennemis, des chevau-légers. Ceux-ci se sont vite repliés quand le 15e est arrivé en colonne sur le pont et a bousculé à cheval leur barricade assez dérisoire. Ils ont sauté en selle et sont partis au galop, sans demander leur monnaie.
Un bon point au général Grellet, commandant la division. Il était là. Il paraît qu'il s'est avancé au trot tandis que sifflaient les balles. Il a été l'un des premiers à passer le pont.
Il semble qu'il ait voulu effacer par ce geste la défaillance de cette nuit et faire oublier le désordre du fameux pont de Verdelot. Il sait ce qu'on pense de lui. Ses officiers d'état-major disent qu'il est cependant très gentil, et qu'en temps de paix il était très bien, très aimé, mais que maintenant il est sûrement malade.
Passé le pont, nous collaborons avec le 15e Dragons pour nettoyer le terrain de tout ennemi. Mais il n'y a plus rien. Tout a disparu. C'est le vide. Nous marchons vers le nord.
12 h. - Nous atteignons le village de La Ville-aux-Bois, situé, comme son nom l'indique, au débouché d'un grand bois-taillis, sur la route de Reims à Laon.
Pied à terre à deux cents mètres plus loin ! Faire manger les hommes et les chevaux !
Passé l'Aisne, le terrain a curieusement changé (A partir d'ici je cesse pour un moment de citer mon carnet. Mais j'ai gardé des souvenirs très précis et des images vivantes inoubliables de cette journée. Je n'hésite pas à les rappeler ici.) . Il n'y a plus d'escarpements ni de collines. Devant nous, s'ouvre une plaine indéfinie, parfaitement plate. Il y a là une petite rivière qui serpente, un ruisseau plutôt, bordée de peupliers : la Miette. On peut faire boire les chevaux. L'endroit est idyllique. Le soleil daigne sourire. Les officiers se réunissent, quelques-uns, pour absorber, assis à l'ombre, leur sommaire repas, l'éternel bifteck froid plié dans un bout de journal, où les caractères sont restés imprimés sur la viande, et le trentième de fromage de Hollande, le morceau de pain de l'intendance vieux de huit jours, boire un coup de gnole et attendre le dîner du soir, avec son potage salé, en sachet, et (neuf fois sur dix) son poulet sauté chasseur, aux pommes de terre frites.
Saudin, le cuistot des officiers du 3e escadron, chaque soir à l'arrivée au cantonnement, quelle que soit l'heure, 2 heures du matin parfois, n'a pas son pareil pour sauter à bas de son cheval, armé de sa seule lèchefrite pendue en permanence à sa poche à fers, et se mettre en chasse.
Il est très rare que le dernier poulet (qu'importe l'âge et le sexe), unique survivant de la guerre franco-allemande, ne soit pas débusqué dans son suprême retranchement, égorgé, plumé à l'eau bouillante et aussitôt jeté en morceaux dans la poêle.
Toutes opérations pour lesquelles trente minutes suffisent et ne sont jamais dépassées. Ça se mange. C'est bon. Rendons ici, au passage, hommage au souvenir de Saudin.
- Mon capitaine est servi.
A quoi le capitaine de Langlois fait écho : - Messieurs, à table !
Souvent il n'y a pas de table, rarement des chaises, jamais d'assiettes. Toujours des verres. Pour ça, les verres, Saudin n'est jamais en défaut. Mais nous avons tous notre argenterie personnelle, notre assiette d'aluminium, notre couvert pliant de poche en métal chromé et notre quart de fer-blanc.
Fréquemment je vais manger avec mes hommes, les écouter, leur parler, les mettre au courant de ce que je sais et leur expliquer ce qui se passe. On ne le fait jamais assez. Où dînerons-nous ce soir ?
Grand hourvari autour de nous. Le groupe de chasseurs cyclistes de la division est venu nous rejoindre. Ils se sont assis près de nous, leurs bicyclettes déposées en file dans les fossés, des deux côtés de la route. Le lieutenant Morel-Deville, si charmant, si chic type, si brave au feu (que de fois il l'a prouvé en Lorraine !) est venu faire un brin de causette avec nous. Il n'en sait pas plus que nous sur ce que nous allons faire. On s'attend à un grand coup.
Le bataillon du 45e d'infanterie affecté à notre division nous a rejoints, lui aussi. Ses nombreux autobus sont arrêtés à proximité.
Les hommes sont descendus pour se dégourdir les jambes. Nous les voyons courir, ils ont l'air de jouer aux barres.
Mais le grand mouvement se fait à la sortie de La Ville-aux-Bois, où nous avons passé nous-mêmes il y a une heure : un groupe de chevaux, gris pour la plupart, trois ou quatre voitures automobiles de tourisme sorties de l'ombre de la forêt et brillant au soleil. C'est certainement le général Conneau, son état-major et les deux escadrons de goumiers de son escorte.
Tout cela très visible, trop visible. Montmorin ne décolère pas : - Pour une fois qu'il se montre ! C'est idiot, tout ce monde, comme le nez dans la figure ! II n'entend pas, non, qu'on se bat
toujours à Craonne ? Ils ne pourraient pas rester dans la forêt ? Mais voilà Desjobert qui arrive au grand trot de là-bas (il ne galope pas, il ménage son cheval), cherche le colonel, le trouve, saute à terre et lui parle avec animation.
Il y a du nouveau. On monte à cheval. Enfin ! Entre-temps, j'ai mesuré sur la carte la distance nous séparant de Craonne qu'on voit là, à notre gauche, sorte d'éperon rocheux où se découpent sur le ciel des maisons étagées en terrasses. Il est couvert de fumées d'obus. On s'y bat violemment depuis hier après-midi. C'est l'aile gauche de notre Ve Armée, avec le 18e corps, qui s'y accroche. C'est sûrement très dur. Distance à vol d'oiseau : six kilomètres.
Desjobert chevauche un instant botte à botte avec le capitaine de Langlois, en tête de l'escadron. Je n'y tiens plus, je pousse ma jument pour les rejoindre. De l'Hermite fait de même.
- Qu'est-ce qu'on fait ? Où va-t-on ?
- A Sissonne, c'est le vide absolu devant nous, paraît-il. On est en plein dans le trou, toujours le même depuis huit jours, entre les deux armées allemandes, Ire et IIe.
Nous sommes aux portes du bourg d'Amifontaine. Deux coups de feu, très près dans le village, tirés du sommet du talus de la voie ferrée, nous arrêtent un instant. Un éclaireur du 15e Dragons vient d'être tué à vingt pas. Ce sont deux chevau-légers oubliés en grand-garde. L'un est pris, l'autre réussit à s'enfuir à cheval. Le prisonnier déclare qu'ils sont seuls, qu'il n'y a personne avec eux. On les avait oubliés en vedettes fixes. Ils ont tiré pour pouvoir se sauver. Leur régiment est parti très loin, vers Laon.
On repart. Mais derrière nous, La Ville-aux-Bois subit une violente canonnade. Montmorin l'avait bien dit ! A force de se faire voir ! Les deux escadrons de goumiers marocains avec leurs chevaux gris, leurs burnous bleus doublés de blanc sont en plein sous le feu. On entend crier les hommes, invoquer Allah. Ils subissent de lourdes pertes. Pauvres gens ! Pauvres petits chevaux barbes, si intelligents !
Nous voyons des obus explosifs éclater juste à l'endroit où nous avons déjeuné. Le sol est bouleversé, creusé d'entonnoirs. Il était temps !
- Ils ont été bien gentils d'attendre qu'on ait fini de bouffer avant de tirer la nappe, bougonne l'Hermite, sarcastique.
On continue face au nord.
Nous trottons en plein vide. Le soleil commence à baisser. Allure : deux kilomètres de trot, pour un de pas, comme aux manœuvres. Aucune alerte. C'est le désert. Pas un être vivant. Nous passons près d'une grosse ferme (La ferme de Fleuricourt.). Elle est tout de même habitée. Deux femmes nous regardent passer. Interrogées, elles confirment qu'à leur connaissance il n'y a dans les environs aucun élément de troupes allemandes. Depuis l'autre semaine, elles n'ont vu personne.
- Et à Sissonne ?
- Ça, on ne sait pas. C'est loin, Sissonne. - Combien de kilomètres ?
- Sissonne-Village, sept kilomètres. Le camp, c'est plus près. Ça commence juste là derrière.
On continue. Toujours le vide. Des bois de sapins de diverses étendues, rectangulaires, comme en Champagne pouilleuse. Terrain pauvre.
Les chasseurs cyclistes nous ont rejoints et pédalent à côté de nous. Je les interroge. Ils étaient encore là-bas lorsque les premiers obus sont arrivés à l'endroit où nous étions avec eux. Des gros noirs explosifs. Des 21, sûr. Et tirés de loin. Pas de pertes. Un miracle !
- Vous parlez si on a levé le camp en vitesse ! - Et les autres ?
- Un massacre ! Les goumiers, les chevaux, ça se sauvait dans toutes les directions !
- Et les autobus ? Ils étaient en pleine vue.
- Le 45 aussi en a pris un coup avec ses omnibus. Rien de grave. Des éclats. Vous parlez qu'ils ont pas été longs à mettre les moteurs en route et les bouts de bois, pour filer se camoufler à Juvincourt derrière les maisons. Des lapins !
Les chasseurs rigolent. On jalouse quelque peu les fantassins du 45e en renfort des divisions de cavalerie. On les blague. Ils se prélassent sur les coussins de Madeleine-Bastille sans s'en faire. Les veinards. C'est la bonne planque. Presque des embusqués.
Je pense aux goumiers marocains, à leurs petits chevaux. Venir de si loin, n'être pour rien dans cette guerre avec l'Allemagne et se faire mettre en pièces ici, en France, qui n'est même pas leur patrie... Tout ceci par la faute de ces officiers d'état-major à brassards, qui ne comprennent rien à rien et circulent à cheval pendant des heures, vont et viennent.
Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous les vues de l'ennemi ? Ils ne comprennent rien à la guerre, non ? Ils n'ont aucune notion de l'utilisation du terrain. Ils attirent les obus. Ce n'est pas la première fois que je fais cette remarque. Aujourd'hui, c'est flagrant. Bien réussi ! Conneau était sûrement avec eux.
17 h. - Il fait encore grand jour quand nous touchons aux lisières du bourg de Sissonne. Un jalonneur, laissé par la division, nous arrête. On est arrivés. Tout le monde pied à terre ! Le 15e Dragons, toujours en avant-garde, va reconnaître et fouiller Sissonne et les nombreux baraquements avoisinants. Après, on verra...
Les bruits de la bataille sont loin maintenant derrière nous. Ils semblent d'ailleurs s'affaiblir à l'approche du soir. Nous sommes à vol d'oiseau à vingt et un kilomètres de Craonne, à trente-huit de Reims, les deux points chauds où roule toujours la canonnade. Nous sommes en plein dans les lignes ennemies, en situation aventurée. Et après ? Que risquons-nous ? Avec trois divisions de cavalerie (les deux autres nous talonnent évidemment) avec tous leurs moyens en artillerie, leurs trois groupes de chasseurs cyclistes et les trois bataillons du 45e d'infanterie (tout le régiment) nous représentons une force offensive considérable.
Une demi-heure se passe. On est toujours pied à terre à mille cinq cents mètres des premières maisons de Sissonne. Le colonel Gailhard-Bournazel fait passer l'ordre de ne faire aucun bruit, d'empêcher les chevaux de hennir. Il a raison. Nous sommes chez l'ennemi. Il peut nous entendre.
Qu'attend-on ? Sans doute le général Conneau ? Il va arriver. La situation est si tendue, si brûlante, qu'il va prendre sa décision. Nous avons réussi presque miraculeusement à nous glisser sans avoir été éventés à vingt-cinq kilomètres dans le dos de l'ennemi, il faut en profiter ! On ne va pas s'en tenir là. Il faut attaquer, ça urge pour créer la surprise, la panique, la déroute chez les troupes allemandes ! Surtout aux approches du soir, à tombée de nuit. Ils ne nous soupçonnent pas là. L'heure est idéale, c'est l'heure des loups. Mais la situation peut évoluer à tout instant, la moindre reconnaissance de cavalerie peut nous découvrir et jeter l'alerte. Alors la surprise, facteur essentiel de la victoire en rase campagne, n'existera plus.
Les heures qui passent valent leur pesant d'or. Pas une minute à perdre!
Un remous là-bas, vers le colonel. Sans doute, le général Conneau vient-il d'arriver ?
Non, ce n'est pas le général Conneau, c'est... l'ordre de stationnement pour la nuit donné par le général de division. Un planton vient de l'apporter. Incroyable mais vrai.
Ainsi, on va cantonner ! On ne va pas se jeter avant la nuit sur ce massif de Laon couvert de villages que nous avons déjà aux deux tiers contourné et qui doit être farci de troupes allemandes au cantonnement, ou au bivouac (il fait beau temps maintenant), bien tranquilles et ne se doutant de rien. Voilà justement des feux de bivouac qui commencent à s'allumer. On n'attaque pas, on cantonne ! C'est fou !
Mais où est Conneau ? ...
Voilà Desjobert qui vient nous rejoindre. Il était avec le colonel, en train de discuter. Il va nous renseigner. Par lui on va savoir ! Desjobert est très calme, parfaitement tranquille. Il n'est pas comme le capitaine de Langlois, de l'Hermite, Gougis et moi, qui rongeons notre frein. Il nous annonce que l'escadron est privilégié. Il va cantonner, très bien installé, dans le bourg de Sissonne, avec tout le 15e Dragons, privilégié lui aussi. Les autres escadrons du 20e (1er, 2e et 4e) ainsi que tous les autres régiments de la division, l'artillerie, les chasseurs cyclistes et le bataillon du 45e R.I., tout ce monde cantonnera dans les baraquements du camp, très bien aménagés. On pourra allumer des lumières et même du feu, mais seulement à l'intérieur des baraquements construits en dur et munis de poêles. Interdiction formelle à l'extérieur !
Le G.Q.G. est en pleine euphorie, ajoute Desjobert. L'armée allemande est toujours en pleine retraite. Dans deux jours il n'y aura plus un seul Allemand en France !
- Mais depuis deux jours on se bat à Reims et à Craonne. Ça a l'air très dur.
- Combats d'arrière-garde. On a capté un ordre de Moltke : tenir jusqu'à la mort. L'armée allemande est éreintée. Assurer à tout prix sa retraite ! Moltke a l'air de craindre la débâcle.
De là la grande confiance du G.Q.G. Franchet d'Espérey déclare que demain matin il fera son entrée solennelle et triomphale à Reims.
- Et nous alors qu'est-ce qu'on fout ? Quels sont les ordres ? - Justement, ordre général d'intercepter partout les colonnes en retraite, de ramasser le maximum de prisonniers et de matériel de guerre. A propos, vous ne savez pas ? Tout à l'heure, le 15e Dragons, en visitant Sissonne pour le cantonnement, a fait des prisonniers dont deux officiers qui se ravitaillaient dans une épicerie. Ce sont les habitants qui ont prévenu les dragons. On a cueilli ces messieurs au nid, parmi eux un officier de très haut rang. Ils n'en revenaient pas de voir les Français déjà à Sissonne. Ils étaient sidérés ! Le 15e voulait garder la voiture, mais c'est la division qui l'a trustée.
- Alors nous, on n'attaque pas à présent ? On va se coucher ? - Oui, on va se coucher. La division dit qu'il n'y a que ça à faire. Comme d'ailleurs le général Grellet. Il est très fatigué. On pense qu'il va falloir l'évacuer demain matin, ou même cette nuit.
" Allons venez avec moi, je vais vous montrer où nous cantonnons, cantonnement d'alerte évidemment. Mais il n'y a pas à s'en faire, à ce qu'il paraît. Il faut en profiter et se reposer. On est à vingt-cinq kilomètres chez l'ennemi, mais il n'y a rien à craindre. - Paraît-il...
- Oui, paraît-il... L'ennemi est épuisé, il y a dans certaines de ses unités des signes de décomposition. Rien à craindre de lui.
- Qui l'a dit ?
- Le corps de cavalerie.
- Comment le sait-il ? Il n'a rien vu, on n'a pas fait de reconnaissances. C'est nous qui sommes le plus au contact.
- On a fait des prisonniers à la Ve Armée, à Reims et à Craonne. Desjobert tient un papier froissé à la main.
- On vient de recevoir par la voiture de liaison du C.C.C. un bulletin de renseignements.
- Comment, la voiture de liaison du C.C.C. ? Il n'est pas là, le C.C.C. ? Conneau n'est pas là ?
Nous apprenons avec stupéfaction (et une réprobation indignée) que le corps de cavalerie n'a pas suivi, que les 4e et 8e divisions n'ont pas suivi. Nous sommes seuls à Sissonne.
Pas de commentaires... pour le moment.
Je reprends ici quelques lignes de mon carnet de route et comme toujours sans en changer un mot : Cantonnement excellent. Habitants très aimables. Les chevaux sont à peu près tous logés et peuvent manger du foin et de l'avoine.
Les cinq officiers de l'escadron dînent chez un très brave homme qui nous demande, à tous, nos noms et nos adresses, pour nous écrire après la guerre (C'est un retraité des P.T.T. Il ne se tient pas de joie, ainsi que sa femme, de revoir des Français des officiers sous leur toit. Ils sont restés quinze jours sous la botte allemande. Les voilà délivrés maintenant. Hélas, ils se trompent de quatre ans et deux mois ! Demain soir ils se retrouveront sous l'oppression ennemie.).
Lundi 14 septembre.
Réveil tardif . (Je continue à l'encre, ayant une plume à ma disposition.)
Notre situation est tout de même invraisemblable. Notre division est en plein dans les lignes allemandes, à vingt-cinq kilomètres en avant de nos troupes qui sont restées sur l'Aisne. A notre gauche, le plateau de Craonne est occupé par l'ennemi. A notre droite, toute la partie au nord de Reims est occupée de même.
Or, il est 8 h du matin et nous vaquons tranquillement aux mille détails de la vie journalière. Les fourgons du train régimentaire sont là, un miracle ! On distribue du pain, du vrai, du sucre, du café. Les forges de campagne descendues sur le sol, on ferre les chevaux. Et l'ennemi est à deux pas de nous ! Nous sommes chez lui ! La frontière du Luxembourg est à quarante-huit kilomètres.
Et toujours pas d'ordres. Que fait-on ? Que de temps perdu ! 10 h. - Ordre de rassemblement de la 10e D.C. au lieu-dit Moulin-Neuf (S.-O. de Sissonne). Enfin !
On ne voit pas le général Grellet, mais voici quand même les ordres de la division : L'ennemi étant toujours en retraite vers le nord-est, on va lui couper ses axes de marche, toutes ses routes de retraite.
C'est ainsi que notre escadron (le 3e du 20e Dragons, rappelons-le, aux ordres du capitaine de Langlois) est désigné pour aller à Marchais tendre un barrage. Marchais est un village à cinq kilomètres de Laon. où l'ennemi se trouve certainement. L'escadron sera renforcé d'un peloton de chasseurs cyclistes mis aux ordres du capitaine de Langlois.
Notre :mission est magnifique : on prévoit que les troupes allemandes, lorsqu'elles cesseront leur combat d'arrière-garde à Craonne vont remonter vers le nord-est en passant forcément par Marchais.
On y jettera le désordre, en leur infligeant le maximum de pertes. Ce qui est inquiétant, c'est que vers Craonne la canonnade s'est réveillée au point du jour. Elle dure toujours, plus violente que jamais. C'est le troisième jour. C'est long pour un combat d'arrière-garde.
Et c'est la même chose, toujours beaucoup plus loin, vers Reims.
A partir d'ici les pages de mon carnet de route prennent un caractère particulier. Elles ont été écrites au lendemain même de la lamentable et terrible affaire de Sissonne qui, commencée dans la joie et la fierté, s'est achevée dans la honte et l'humiliation.
Que s'est-il donc passé ? Je vais le dire.
Ayant eu, sur l'instant, conscience de la gravité des heures que nous venions de vivre, et de la façon dont elles ne manqueraient pas d'être interprétées dans l'avenir et sans doute déformées par l'Histoire, j'ai décidé d'en écrire, sinon sur place du moins dès que je le pourrais, une relation exacte et aussi détaillée que possible.
Il s'agit non seulement du témoignage vivant d'un simple témoin, mais d'un acteur qui, si modeste que fût peut-être son rôle, s'est tout de même trouvé au lieu géométrique, au cœur, on pourrait dire à l'épicentre de l'événement.
Le hasard avait voulu qu'ensuite, dès le 14 au soir, après notre scandaleux retour derrière l'Aisne, nous fussions mis au cantonnement de repos pour trois jours, les 15, 16 et 17, dans le petit village de Merval (à douze kilomètres de Pontavert, où nous avions retraversé l'Aisne). Ceci nous ramenait à proximité de la petite ville de Fismes, où l'avant-veille 12 nous avions chaudement combattu pour franchir la rivière la Vesle.
J'avais pu ainsi dans les meilleures conditions de tranquillité mais de très relatif confort (toute la brigade du Quinze-Vingt était entassée dans ce même village) entreprendre la rédaction de la relation de notre raid à Sissonne. L'ayant achevée, j'avais pu descendre à Fismes et trouver une dactylo d'occasion qui avait bien voulu se charger d'en taper à la machine les nombreuses pages en deux exemplaires.
Je tenais beaucoup à ce texte. L'ayant relu longtemps après, je dois dire que je n'en ai pas été autrement fier, je m'excuse de sa très médiocre qualité, de ses redites, de la longueur de certains détails sans intérêt, de son mauvais français, de son accent parfois juvénile et passionné, de son ton de péremptoire conviction. J'étais très jeune alors. Mon texte a tous les défauts de la jeunesse, cela saute aux yeux. J'aurais pu le corriger, le retoucher, l'expurger, l'élaguer. Je ne l'ai pas voulu, car il a au moins une qualité au milieu de tous ses défauts : il est l'expression de l'exacte vérité. Rédigé à chaud, la vérité y palpite à chaque ligne, à chaque mot. Il restitue, je crois, très fidèlement l'atmosphère du moment, les sentiments qui furent les nôtres, les états d'esprit successifs par lesquels nous avions passé, allant de la joie, de l'exaltation, de l'espoir, à la déception, à l'amertume, à la colère, à l'indignation.
Ironie du sort, le village de Merval était accroché au bord supérieur de la vallée très encaissée où miroitait le lit de l'Aisne. De l'autre côté, sur la rive droite courait, haut perchée sur le ciel, la crête du Chemin des Dames, jalonnée par les positions de Cerny-en-Laonnois, ferme Hurtebise, Oulches-la-Vallée, Craonnelle, Craonne et à son extrémité dans la plaine d'où nous venions, Corbeny, toutes positions tenues encore le matin du 13 par le 18e d'infanterie du 18e corps (On se souvient certainement de ma rencontre avec des éléments d'une compagnie du 18e d'infanterie dans le petit village de Rupéreux, au nord de la Seine, le 5 septembre, veille de l'attaque. - Brave 18e je te connais ! Les hommes. les officiers étaient à bout, morts de fatigue. Le clairon de l'assaut les avait remis debout, ressuscités. Je ne les avais pas revus. Dix jours après. je tes retrouvais se battant à Craonne. à 120 kilomètres plus au nord. C'étaient les mêmes. Les ailes de la Victoire les portaient...), mais qu'il avait dû abandonner le 14 en fin de journée à la suite de violentes contre-attaques.
On s'y battait toujours. Les artilleries française et allemande s'y acharnaient tour à tour. Nous étions aux premières loges pour tout voir. On s'y battrait encore dans quatre ans.
Le haut commandement français avait dû revenir de ses illusions et de ses appréciations concernant la retraite générale jugée parfois en certains points désordonnée, de l'ennemi. La retraite allemande était finie et bien finie. L'ennemi s'accrochait. La Direction Suprême avait déterminé d'un bout à l'autre du front la ligne sur laquelle elle avait décidé de se rétablir et de continuer la guerre, puisqu'on le lui permettait.
La bataille de la Marne, brillante victoire de l'offensive française, s'achevait par la bataille de l'Aisne, brillante victoire de la défensive allemande.
Et cependant le dimanche 13 septembre et même encore le lundi 14 avant midi tout était encore possible. Si le corps de cavalerie Conneau s'était engagé, tout pouvait alors finir par une victoire décisive française.
Au texte de ma relation fait suite une critique rédigée longtemps après, lorsqu'on a pu avoir en main tous les éléments de source française ou allemande permettant de porter un jugement sûr.
Il existe, je l'ai dit, deux exemplaires de ma relation dactylographiée à Fismes les 15 et 16 septembre 1914. J'ai gardé le premier. bien entendu, et c'est lui qui m'a permis d'écrire une partie de ce livre. Je l'ai porté longtemps sur moi en permanence, tant que je suis resté dans la cavalerie, c'est-à-dire jusqu'au 22 novembre 1914, date à laquelle j'ai passé dans l'aviation. La Course à la Mer était finie, nous étions arrivés à Ypres, le rôle de la cavalerie à cheval était de toute évidence terminé. Mes camarades savaient, si j'étais tué ou gravement blessé, ce qu'ils avaient à faire, prendre dans les poches intérieures de ma tunique, pour les envoyer à ma mère dont j'avais donné l'adresse, mes carnets de route, y compris l'exemplaire de ma relation sur le raid de Sissonne.
L'autre exemplaire, je l'avais confié à mon meilleur ami au 20e Dragons, le lieutenant de Montmorin Saint-Hérem (je l'ai cité à plusieurs reprises dans mes carnets de route). Le 14 au soir, au pont de Pontavert, Montmorin (il était au 1er escadron, on s'en souvient) avait longuement attendu que le 3e, sur le sort duquel on était mortellement inquiet, eût enfin rejoint.
Quand il m'avait vu, Montmorin s'était hâté vers moi :
- Ah ! Vous voilà ! Dieu soit loué ! Vous nous avez fait peur, vous savez ! On vous croyait, avec votre escadron, tous coupés derrière les lignes ennemies.
- A Dieu plaise ! C'eût été tellement mieux !
Nous avions ensuite, Montmorin et moi, chevauché botte à botte pendant l'étape de Pontavert à Merval. Montmorin m'avait trouvé dans un état d'indignation et d'exaspération que rien n'avait pu calmer. Il était beaucoup plus mesuré, plus pondéré que moi (comme toujours). J'admirais son sang-froid en toutes circonstances, au feu comme dans les choses ordinaires de la vie. Il me disait toujours la même phrase.
- Du calme, Chambe, du calme ! Ne vous en faites pas ! Tout va s'éclaircir, ça ira bien, vous verrez !
Nous pensions toujours de même. Nous étions deux optimistes. Mais que pensait-il de notre raid avorté de Sissonne ?
- Ce n'est pas permis de gâcher une occasion pareille ! Tout le monde est furieux, sauf ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, les imbéciles et les froussards.
Montmorin pensait donc comme moi, j'en étais sûr ! Et encore il n'avait pas vu tout ce que j'avais vu moi-même. Je le lui apprendrais.
C'était donc à lui que j'avais confié le second exemplaire de ma relation sur l'affaire de Sissonne.
Depuis, nos carrières avaient bifurqué. J'étais resté dans l'aviation. Certes, nous nous étions revus le plus souvent possible, mais nous n'avions pas eu les mêmes garnisons.
Montmorin est mort, hélas, prématurément, encore bien jeune. Je n'ai pas eu le temps de lui parler de ce second exemplaire de ma relation sur Sissonne. Peut-être est-il resté dans ses papiers de famille, dans ses souvenirs de guerre ? ...
Je ne sais, peu importait. J'avais réussi à sauvegarder le mien. C'était là l'important.
![]()
CHAPITRES SUIVANTS DE L'OUVRAGE DU GENERAL CHAMBE : ADIEU CAVALERIE
![]()
MENU DE LA BATAILLE DE LA MARNE VUE PAR LE GENERAL CHAMBE
![]()
MENU DES RESPONSABLES ET ECRIVAINS FRANÇAIS
![]()
RETOUR VERS LE MENU DES BATAILLES DANS LA BATAILLE
![]()
![]()